-
Manuel d’économie politique
- Première partie — Les modes de production précapitalistes
- Chapitre 1 — Le mode de production de la communauté primitive
- Chapitre 2 — Le mode de production fondé sur l’esclavage
- Chapitre 3 — Le mode de production féodal
- Deuxième partie — Le mode de production capitaliste
- A. — Le capitalisme prémonopoliste
- Chapitre 4 — La production marchande — La marchandise et la monnaie
- Chapitre 5 — La coopération capitaliste simple et la manufacture
- Chapitre 6 — La phase du machinisme sous le capitalisme
- Chapitre 7 — Le capital et la plus-value — La loi économique fondamentale du capitalisme
- Chapitre 8 — Le salaire
- Chapitre 9 — L’accumulation du capital et la paupérisation du prolétariat
- Chapitre 10 — Le cycle et la rotation du capital
- Chapitre 11 — Le profit moyen et le prix de production
- Chapitre 12 — Le capital commercial et le profit commercial
- Chapitre 13 — Le capital de prêt et l’intérêt de prêt la circulation monétaire
- Chapitre 14 — La rente foncière — Les rapports agraires en régime capitaliste
- Chapitre 15 — Le revenu national
- Chapitre 16 — La reproduction du capital social
- Chapitre 17 — Les crises économiques
- B — Le capitalisme monopoliste ou impérialisme
- Chapitre 18 — L’impérialisme, stade suprême du capitalisme — La loi économique fondamentale du capitalisme monopoliste
- Chapitre 19 — Le système colonial de l’impérialisme
- Chapitre 20 — La place historique de l’impérialisme
- Chapitre 21 — La crise générale du capitalisme
- Chapitre 22 — L’aggravation de la crise générale du capitalisme après la deuxième guerre mondiale
- A. — Le capitalisme prémonopoliste
- Première partie — Les modes de production précapitalistes
-
Par Pcautunois le 28 Avril 2011 à 12:18
Chapitre 1 — Le mode de production de la communauté primitive
1.1. L’apparition de la société humaine.
L’homme est apparu au début de la période actuelle de l’histoire de la Terre, dite période quaternaire, qui compte selon les savants un peu moins d’un million d’années. Dans différentes régions d’Europe, d’Asie et d’Afrique au climat chaud et humide vivait une espèce très évoluée de singes anthropomorphes dont l’homme est descendu à la suite d’une longue évolution qui passe par toute une série de stades intermédiaires.
L’apparition de l’homme a marqué un tournant décisif dans le développement de la nature. Ce tournant s’est opéré lorsque les ancêtres de l’homme se sont mis à confectionner des instruments de travail. L’homme commence à se distinguer foncièrement de l’animal au moment où il se met à fabriquer des instruments, aussi simples soient-ils. On sait que les singes se servent souvent d’un bâton ou d’une pierre pour abattre les fruits de l’arbre ou se défendre quand ils sont attaqués. Mais jamais aucun animal n’a confectionné même l’outil le plus primitif. Les conditions d’existence incitaient les ancêtres de l’homme à fabriquer des instruments. L’expérience leur suggéra qu’ils pouvaient utiliser des pierres aiguisées pour se défendre en cas d’attaque ou pour chasser. Ils se mirent à confectionner des outils de pierre en frappant une pierre contre une autre. Ceci marque le début de la fabrication des outils. Et c’est par la fabrication des outils que le travail a commencé.
Grâce au travail, les extrémités des membres antérieurs du singe anthropomorphe sont devenues les mains de l’homme, ainsi qu’en témoignent les restes du pithécanthrope (être intermédiaire entre le singe et l’homme) trouvés par les archéologues. Le cerveau du pithécanthrope était beaucoup moins développé que celui de l’homme, mais déjà sa main se distinguait relativement peu de la main humaine. La main est donc l’organe, mais aussi le produit du travail.
À mesure que les mains se déchargeaient de tout emploi autre que le travail, les ancêtres de l’homme s’habituaient de plus en plus à la station verticale. Quand les mains furent prises par le travail, s’accomplit le passage définitif à la station verticale, ce qui joua un rôle très important dans la formation de l’homme.
Les ancêtres de l’homme vivaient en hordes, en troupeaux ; les premiers hommes aussi. Mais entre les hommes un lien était apparu, qui n’existait pas, et ne pouvait pas exister, dans le règne animal ; ce lien, c’était le travail. C’est en commun que les hommes fabriquaient des outils, en commun qu’ils les mettaient en œuvre. Par conséquent, l’apparition de l’homme a aussi marqué le début de la société humaine, le passage de l’état zoologique à l’état social.
Le travail en commun a entraîné l’apparition et le développement du langage articulé. Le langage est un moyen, un instrument à l’aide duquel les hommes communiquent entre eux, échangent leurs idées et parviennent à se faire comprendre. L’échange des idées est une nécessité constante et vitale ; sans elle les hommes ne pourraient se concerter pour lutter ensemble contre les forces de la nature, la production sociale elle-même ne pourrait exister.
Le travail et le langage articulé ont exercé une influence déterminante sur le perfectionnement de l’organisme de l’homme, sur le développement de son cerveau. Les progrès du langage sont étroitement solidaires des progrès de la pensée. Dans le processus du travail, l’homme étendait le champ de ses perceptions et de ses représentations, il perfectionnait ses organes des sens. À la différence des actes instinctifs des animaux, les actes de l’homme au travail prirent peu à peu un caractère conscient.
Ainsi, le travail est la condition fondamentale première de toute vie humaine, et il l’est à un point tel que, dans un certain sens, il nous faut dire : le travail a créé l’homme lui-même.
( F. Engels, « Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme », Dialectique de la nature, p. 171,
Éditions sociales, Paris, 1952. )C’est grâce au travail que la société humaine est née et qu’elle a commencé à se développer.
1.2. Les conditions de la vie matérielle dans la société primitive. Le perfectionnement des instruments de travail.
L’homme primitif dépendait dans une très large mesure de la nature environnante ; il était complètement écrasé par les difficultés de l’existence, de la lutte contre la nature. Ce n’est qu’avec une extrême lenteur qu’il est parvenu à dompter les forces de la nature, par suite du caractère rudimentaire de ses instruments de travail. Une pierre grossièrement taillée et un bâton ont été ses premiers outils. Ils continuaient en quelque sorte artificiellement les organes de son corps, la pierre prolongeant le poing et le bâton le bras tendu. Les hommes vivaient en groupes comptant au plus quelques dizaines de membres : un nombre plus élevé d’individus n’aurait pu trouver à se nourrir ensemble. Quand deux groupes se rencontraient, des conflits éclataient parfois entre eux. Beaucoup de ces groupes mouraient de faim ou devenaient la proie des bêtes féroces. Aussi le travail en commun était-il pour les hommes la seule possibilité et une nécessité absolue.
Longtemps l’homme primitif a surtout vécu de la cueillette et de la chasse effectuées collectivement à l’aide des instruments les plus simples. Les fruits du travail en commun étaient de même consommés en commun. La précarité de la nourriture explique l’existence chez les hommes primitifs du cannibalisme. Au cours des millénaires, les hommes ont appris en quelque sorte à tâtons, par une expérience très lentement accumulée, à fabriquer les instruments les plus simples, propres à frapper, à couper, à creuser et à exécuter les autres actions peu compliquées auxquelles se réduisait alors presque toute la production.
La découverte du feu a été une grande conquête de l’homme primitif en lutte contre la nature. Il a d’abord appris à se servir du feu allumé fortuitement : il voyait la foudre enflammer un arbre, il observait les incendies de forêt et les éruptions des volcans. Le feu obtenu par hasard était longuement et soigneusement entretenu. Ce n’est qu’après des millénaires que l’homme perça le secret de la production du feu. À un stade plus avancé de la fabrication des instruments, il nota que le feu s’obtenait par le frottement, et il apprit à le produire.
La découverte et l’usage du feu permirent aux hommes de dominer certaines forces de la nature. L’homme primitif se détacha définitivement du règne animal ; la longue période de la formation de l’homme avait pris fin. La découverte du feu modifia profondément les conditions de sa vie matérielle. D’abord, le feu lui servit à préparer les aliments et à en augmenter ainsi le nombre : il put désormais se nourrir de poisson, de viande, de racines et de tubercules féculents, etc., en les faisant cuire. Ensuite, le feu commença à jouer un rôle important dans la fabrication des instruments de production ; d’autre part il protégeait du froid, ce qui permit aux hommes de se répandre sur une partie plus étendue du globe. Enfin, il permettait de mieux se défendre contre les bêtes féroces.
Longtemps la chasse resta la principale source de moyens d’existence. Elle procurait aux hommes les peaux dont ils se vêtaient, les os dont ils faisaient des outils, une nourriture carnée qui influa sur le développement ultérieur de l’organisme humain, et surtout du cerveau. À mesure qu’il se développait physiquement et intellectuellement, l’homme devenait capable de produire des instruments de plus en plus perfectionnés. Il se servait pour chasser d’un bâton à bout aiguisé. Puis il fixa à ce bâton une pointe de pierre. Il eut ensuite des lances à pointe de pierre, des haches, des racloirs, des couteaux, des harpons et des crochets de pierre, instruments qui permirent de chasser le gros gibier et de développer la pêche.
La pierre est restée très longtemps la principale matière dont on faisait les outils. On a donné le nom d’âge de la pierre à l’époque où prédominent les instruments de pierre, et qui s’étend sur des centaines de milliers d’années. Plus tard l’homme apprit à fabriquer des outils en métal, en métal natif pour commencer, et d’abord en cuivre (mais le cuivre, métal mou, ne pouvait être largement utilisé pour la fabrication d’outils), puis en bronze (alliage de cuivre et d’étain) et ensuite en fer. À l’âge de la pierre succède l’âge du bronze, puis l’âge du fer.
Les traces les plus anciennes de la fonte du cuivre remontent, dans l’Asie antérieure, aux 5e-4e millénaires avant notre ère ; dans l’Europe méridionale et centrale, aux 3e-2e millénaires. Les premiers vestiges du bronze datent en Mésopotamie du 4e millénaire avant notre ère.
Les traces les plus anciennes de la fonte du fer ont été découvertes en Égypte et en Mésopotamie et se situent 2 000 ans avant notre ère. En Europe occidentale, l’âge du fer commence environ 1 000 ans avant notre ère.
L’invention de l’arc et des flèches marqua une importante étape dans l’histoire du perfectionnement des instruments de travail. Désormais la chasse fournit en quantités accrues les moyens d’existence indispensables. Les progrès de la chasse donnèrent naissance à l’élevage primitif. Les chasseurs se mirent à domestiquer les animaux : le chien d’abord, puis la chèvre, les bovidés, le porc et le cheval.
L’agriculture primitive constitua un nouveau progrès considérable dans le développement des forces productives de la société. En récoltant les fruits et les racines, les hommes primitifs avaient remarqué des milliers de fois, sans comprendre pourquoi, que les graines tombées à terre se mettaient à germer. Mais un jour arriva où leur esprit établit un rapport entre ces faits, et ils commencèrent à cultiver les plantes. Ce fut le début de l’agriculture. Longtemps les procédés de culture restèrent des plus primitifs. On ameublissait le sol au moyen d’un simple bâton, et plus tard, d’un bâton à bout recourbé : la houe. Dans les vallées des cours d’eau, on jetait les semences sur le limon déposé par les crues. La domestication des animaux permit d’utiliser le bétail comme force de trait. Par la suite, quand les hommes apprirent à fondre les métaux, l’emploi d’outils en métal rendit le travail agricole plus productif. L’agriculture reçut une base plus solide. Les tribus primitives devinrent progressivement sédentaires.
1.3. Les rapports de production dans la société primitive. La division naturelle du travail.
Les rapports de production sont déterminés par le caractère, l’état des forces productives. Dans la communauté primitive, la propriété commune des moyens de production constitue la base des rapports de production. La propriété commune correspond alors au caractère des forces productives, les instruments de travail étant trop primitifs pour permettre aux hommes de lutter isolément contre les forces de la nature et les bêtes féroces.
Ce type primitif de la production collective ou coopérative, écrit Marx, fut, bien entendu, le résultat de la faiblesse de l’individu isolé,
et non de la socialisation des moyens de production.( « Brouillon d’une lettre de Marx à Véra Zassoulitch » dans K. Marx et F. Engels Œuvres, t. 27, p. 681 (éd. russe). )D’où la nécessité du travail collectif, de la propriété commune de la terre et des autres moyens de production, ainsi que des produits du travail. Les hommes primitifs n’avaient pas la notion de la propriété privée des moyens de production. Seuls quelques instruments de production, qui constituaient en même temps des moyens de défense contre les bêtes féroces, étaient leur propriété individuelle et étaient utilisés par certains membres de la communauté.
Le travail de l’homme primitif ne créait aucun excédent par rapport au strict nécessaire, autrement dit aucun produit supplémentaire ou surproduit. Il ne pouvait donc exister ni classes ni exploitation de l’homme par l’homme. La propriété sociale ne s’étendait qu’à de petites communautés plus ou moins isolées les unes des autres. Ainsi que l’a fait observer Lénine, le caractère social de la production n’englobait que les membres d’une même communauté. Le travail, dans la société primitive, reposait sur la coopération simple. La coopération simple, c’est l’emploi simultané d’une quantité plus ou moins grande de force de travail pour exécuter des travaux du même genre. La coopération simple permettait déjà aux hommes primitifs de s’acquitter de tâches qu’il aurait été impossible à un homme seul d’accomplir (par exemple, la chasse aux grands fauves).
Le niveau extrêmement bas des forces productives imposait la division d’une maigre nourriture en parts égales. Toute autre méthode de partage était impossible, les produits du travail suffisant à peine à satisfaire les besoins les plus pressants : si un membre de la communauté avait reçu une part supérieure à celle de chacun, un autre aurait été condamné à mourir de faim. Ainsi la répartition égalitaire des produits du travail commun était une nécessité.
L’habitude de tout diviser en parts égales était profondément ancrée chez les peuples primitifs. Les voyageurs qui ont séjourné dans les tribus se trouvant encore à un stade inférieur du développement social ont pu le constater. Il y a plus d’un siècle le grand naturaliste Darwin, accomplissant un voyage autour du monde, rapportait le fait suivant : on avait fait cadeau d’un morceau de toile à des indigènes de la Terre de Feu ; ils le déchirèrent en parties absolument égales pour que chacun en eût autant.
La loi économique fondamentale du régime de la communauté primitive consiste à assurer aux hommes les moyens d’existence nécessaires à l’aide d’instruments de production primitifs, sur la base de la propriété communautaire des moyens de production, par le travail collectif et par la répartition égalitaire des produits. Le développement des instruments de production entraîne la division du travail dont la forme la plus simple est la division naturelle du travail d’après le sexe et l’âge : entre les hommes et les femmes, entre les adultes, les enfants et les vieillards.
Le célèbre explorateur russe Mikloukho-Maklaï, qui a étudié la vie des Papous de la nouvelle-Guinée dans la seconde moitié du 19e siècle, décrit ainsi le travail collectif dans l’agriculture. Quelques hommes alignés enfoncent profondément des bâtons pointus dans le sol, puis d’un seul coup soulèvent un bloc de terre. Derrière eux, des femmes s’avancent à genoux et émiettent à l’aide de bâtons la terre retournée par les hommes. Viennent ensuite les enfants de tout âge qui triturent la terre avec leurs mains. Quand le sol a été ameubli, les femmes pratiquent des trous à l’aide de bâtonnets et y enfouissent les graines ou les racines des plantes. Le travail a donc un caractère collectif et est divisé d’après le sexe et l’âge.
Avec le développement des forces productives, la division naturelle du travail s’affermit et se stabilise. La chasse est devenue la spécialité des hommes, la récolte des aliments végétaux et le ménage celle des femmes, d’où un certain accroissement de la productivité du travail.
1.4. Le régime de la « gens ». Le droit maternel. Le droit paternel.
Tant que l’humanité ne s’était pas entièrement détachée du règne animal, les hommes vivaient en troupeaux, en hordes, comme leurs ancêtres immédiats. Par la suite, quand une économie primitive se fut constituée et que la population eut augmenté peu à peu, la société s’organisa en « gentes » 1.
Seuls des hommes unis par les liens du sang pouvaient, à cette époque, se grouper pour travailler ensemble. Le caractère primitif des instruments de production ne permettait au travail collectif de s’exercer que dans le cadre restreint d’un groupe d’individus liés entre eux par la consanguinité et la vie en commun. L’homme primitif considérait d’ordinaire comme un ennemi quiconque n’était pas lié à lui par la parenté consanguine et la vie en commun au sein de la gens. La gens s’est d’abord composée de quelques dizaines d’individus unis par les liens du sang. Chacune de ces gentes vivait repliée sur elle-même. Avec le temps, l’effectif du groupe augmenta et atteignit plusieurs centaines d’individus ; l’habitude de la vie en commun se développa ; les avantages du travail collectif incitèrent de plus en plus les hommes à rester ensemble.
Morgan qui a étudié la vie des primitifs, décrit le régime gentilice encore en vigueur chez les Indiens Iroquois au milieu du siècle dernier. Les principales occupations des Iroquois étaient la chasse, la pêche, la cueillette des fruits et la culture. Le travail était divisé entre les hommes et les femmes. La chasse et la pêche, la fabrication des armes et des outils, le défrichement, la construction des cases et les travaux de fortification étaient le lot des hommes. Les femmes s’acquittaient des principaux travaux des champs, levaient et rentraient la récolte, cuisaient la nourriture, confectionnaient les vêtements et les ustensiles d’argile, cueillaient les fruits sauvages, les baies et les noisettes, récoltaient les tubercules. La terre était la propriété de la gens. Les gros travaux : coupe du bois, essouchage, grandes chasses, étaient exécutés en commun. Les Iroquois vivaient dans ce qu’ils appelaient de « grandes maisons » pouvant abriter vingt familles et plus. Chaque groupe de ce genre avait ses entrepôts communs où étaient déposées les provisions. La femme qui se trouvait à la tête du groupe distribuait la nourriture entre les familles. En cas de guerre, la gens élisait un chef militaire qui ne bénéficiait d’aucun avantage matériel et dont le pouvoir prenait fin en même temps que les hostilités.
Au premier stade du régime gentilice, la femme occupait une situation prépondérante, ce qui découlait des conditions de la vie matérielle d’alors. La chasse à l’aide d’instruments des plus primitifs, qui était alors l’affaire des hommes, ne pouvait assurer entièrement l’existence de la communauté, ses résultats étant plus ou moins aléatoires. Dans ces conditions, les formes même embryonnaires de la culture du sol et de l’élevage (domestication des animaux) acquéraient une grande importance économique. Elles étaient une source de subsistance plus sûre et plus régulière que la chasse. Or, la culture et l’élevage primitifs étaient surtout le lot des femmes restées au foyer pendant que les hommes allaient à la chasse. La femme joua pendant une longue période le rôle prépondérant dans la société gentilice. C’est par la mère que s’établissait la filiation. C’était la gens matriarcale, la prédominance du droit maternel.
Avec le développement des forces productives, quand l’élevage nomade (pâturage) et l’agriculture plus évoluée (culture des céréales), qui étaient l’affaire des hommes, commencèrent à jouer un rôle déterminant dans la vie de la communauté primitive, la gens matriarcale fut remplacée par la gens patriarcale. La prépondérance passa à l’homme qui prit la tête de la communauté. C’est par le père que s’établit désormais la filiation. La gens patriarcale a existé au dernier stade de la communauté primitive.
L’absence de propriété privée, de division en classes et d’exploitation de l’homme par l’homme rendait impossible l’existence de l’État.
Dans la société primitive […], on n’observe pas d’indices d’existence de l’État. On y voit régner les coutumes, l’autorité, le respect, le
pouvoir dont jouissaient les anciens du clan ; ce pouvoir était parfois dévolu aux femmes — la situation de la femme ne ressemblait pas alors à ce qu’elle est aujourd’hui, privée de droits, opprimée ; mais nulle part une catégorie spéciale d’hommes ne se différencie pour gouverner les autres et mettre en œuvre d’une façon systématique, constante, à des fins de gouvernement, cet appareil de coercition, cet appareil de violence […]( V. Lénine, « De l’État », Œuvres, t. 29, p. 478. )Notes1. Nom latin de la communauté réunissant des membres unis par les liens du sang. Au pluriel : « gentes » ; de là l’adjectif : gentilice. (N. d. T.)1.5. Les débuts de la division sociale du travail et de l’échange.
Avec le passage à l’élevage et à la culture du sol apparut la division sociale du travail : diverses communautés, puis les différents membres d’une même communauté commencèrent à exercer des activités productrices distinctes. La formation de tribus de pasteurs a marqué la première grande division sociale du travail.
En se livrant à l’élevage, les tribus de pasteurs réalisèrent d’importants progrès. Elles apprirent à soigner le bétail de manière à obtenir plus de viande, de laine, de lait. Cette première grande division sociale du travail entraîna à elle seule une élévation sensible pour l’époque de la productivité du travail.
Toute base d’échange fit longtemps défaut entre les membres de la communauté primitive : le produit était tout entier créé et consommé en commun. L’échange naquit et se développa d’abord entre les gentes et garda durant une longue période un caractère accidentel.
La première grande division sociale du travail modifia cette situation. Les tribus de pasteurs disposaient de certains excédents de bétail, de produits laitiers, de viande, de peaux, de laine. Mais elles avaient aussi besoin de produits agricoles. À leur tour, les tribus qui cultivaient le sol réalisèrent avec le temps des progrès dans la production des denrées agricoles. Agriculteurs et pasteurs avaient besoin d’objets qu’ils ne pouvaient produire dans leur propre exploitation. D’où le développement des échanges.
À côté de l’agriculture et de l’élevage, d’autres activités productrices prenaient leur essor. Les hommes avaient appris à fabriquer des récipients en argile dès l’âge de la pierre. Puis apparut le tissage à la main. Enfin, avec la fonte du fer, il fut possible de fabriquer en métal des instruments de travail (araire à soc de fer, hache de fer) et des armes (épées de fer). Il s’avérait de plus en plus difficile de cumuler ces formes de travail avec la culture ou l’élevage. Peu à peu se constitua au sein de la communauté une catégorie d’hommes exerçait des métiers. Les articles produits par les artisans : forgerons, armuriers, potiers, etc., devenaient de plus en plus des objets d’échange. Les échanges prirent de l’extension.
1.6. Apparition de la propriété privée et des classes. La désagrégation de la communauté primitive.
Le régime de la communauté primitive atteignit son apogée à l’époque du droit maternel ; la gens patriarcale renfermait déjà les germes de la désagrégation de la communauté primitive.
Les rapports de production, dans la communauté primitive, correspondirent jusqu’à une certaine époque au niveau de développement des forces productives. Il n’en fut plus de même au dernier stade de la gens patriarcale, après l’apparition d’outils plus perfectionnés (âge du fer). Le cadre trop étroit de la propriété commune, la répartition égalitaire des produits du travail commencèrent à freiner le développement des nouvelles forces productives.
Jusque là, l’effort collectif de quelques dizaines d’individus permettait seul de cultiver un champ. Dans ces conditions, le travail en commun était une nécessité. Avec le perfectionnement des instruments de production et l’élévation de la productivité du travail, une famille à elle seule était déjà capable de cultiver un terrain et de s’assurer les moyens d’existence dont elle avait besoin. L’amélioration de l’outillage permit donc de passer à l’exploitation individuelle, plus productive dans les nouvelles conditions historiques. La nécessité du travail en commun, de l’économie communautaire se faisait de moins en moins sentir. Si le travail en commun entraînait nécessairement la propriété commune des moyens de production, le travail individuel requérait la propriété privée.
L’apparition de la propriété privée est inséparable de la division sociale du travail et du progrès des échanges. Ceux-ci se firent au début par l’entremise des chefs des communautés gentilices (anciens, patriarches) au nom de la communauté qu’ils représentaient. Ce qu’ils
échangeaient appartenait à la communauté. Mais avec le développement de la division sociale du travail et l’extension des échanges, les chefs des gentes en vinrent peu à peu à considérer le bien de la communauté comme leur propriété.Le principal article d’échange fut d’abord le bétail. Les communautés de pasteurs possédaient de grands troupeaux de moutons, de chèvres, de bovins. Les anciens et les patriarches, qui jouissaient déjà d’un pouvoir étendu dans la société, s’habituèrent à disposer de ces troupeaux comme s’ils étaient à eux. Leur droit effectif de disposer des troupeaux était reconnu par les autres membres de la communauté. De la sorte le bétail, puis peu à peu tous les instruments de production devinrent propriété privée. C’est la propriété commune du sol qui se maintint le plus longtemps.
Le développement des forces productives et la naissance de la propriété privée entraîna la désagrégation de la gens. Celle-ci se décomposa en un certain nombre de grandes familles patriarcales. Du sein de ces dernières se dégagèrent par la suite certaines cellules familiales qui firent des instruments de production, des ustensiles de ménage et du bétail leur propriété privée. Avec les progrès de la propriété privée les liens de la gens se relâchaient. La communauté rurale, ou territoriale, se substitua à la gens. À la différence de celle-ci, elle se composait d’individus qui n’étaient pas forcément liés par la consanguinité. L’habitation, l’exploitation domestique, le bétail étaient la propriété privée de chaque famille. Les forêts, les prairies, les eaux et d’autres biens restèrent propriété commune, de même que, pendant une certaine période, les terres arables. Celles-ci, d’abord périodiquement redistribuées entre les membres de la communauté, devinrent à leur tour propriété privée.
L’apparition de la propriété privée et de l’échange marqua le début d’un bouleversement profond de toute la structure de la société primitive. Les progrès de la propriété privée et de l’inégalité des biens déterminèrent chez les divers groupes de la communauté des intérêts différents. Les individus qui exerçaient les fonctions d’anciens, de chefs militaires, de prêtres mirent leur situation à profit pour s’enrichir. Ils s’approprièrent une partie considérable de la propriété commune. Les hommes qui avaient été investis de ces fonctions sociales, se détachaient de plus en plus de la grande masse des membres et formaient une aristocratie dont le pouvoir se transmettait de plus en plus par hérédité. Les familles aristocratiques devenaient aussi les plus riches, et la grande masse des membres de la communauté tombait peu à peu, d’une manière ou d’une autre, sous leur dépendance économique.
Grâce à l’essor des forces productives, le travail de l’homme, dans l’élevage et l’agriculture, lui procura plus de moyens d’existence qu’il n’en fallait pour son entretien. Il devint possible de s’approprier le surtravail ou travail supplémentaire et le surproduit ou produit supplémentaire, c’est-à-dire la partie du travail et du produit qui excédait les besoins du producteur. Il était donc profitable de ne pas mettre à mort les prisonniers de guerre, comme auparavant, mais de les faire travailler, d’en faire des esclaves. Les esclaves étaient accaparés par les familles les plus puissantes et les plus riches. À son tour, le travail servile aggrava l’inégalité existante, car les exploitations utilisant des esclaves s’enrichissaient rapidement. Avec les progrès de l’inégalité des fortunes, les riches se mirent à réduire en esclavage non seulement les prisonniers de guerre, mais aussi les membres de leur propre tribu appauvris et endettés. Ainsi naquit la première division de la société en classes : la division en maîtres et en esclaves. Ce fut le début de l’exploitation de l’home par l’homme, c’est-à-dire de l’appropriation sans contre-partie par certains individus des produits du travail d’autres individus.
Peu à peu les rapports de production propres au régime de la communauté primitive se désagrégeaient et étaient remplacés par des rapports nouveaux, qui correspondaient au caractère des nouvelles forces productives. Le travail en commun fit place au travail individuel, la propriété sociale à la propriété privée, la société gentilice à la société de classes. Désormais l’histoire de l’humanité sera, jusqu’à l’édification de la société socialiste, l’ histoire de la lutte des classes.
Les idéologues de la bourgeoisie prétendent que la propriété privée a toujours existé. L’histoire dément cette assertion ; elle atteste que tous les peuples ont passé par le stade de la communauté primitive, qui est fondée sur la propriété commune et ignore la propriété privée.
Les représentations sociales à l’époque primitive.
À l’origine, l’homme primitif, accablé par le besoin et les difficultés de la lutte pour l’existence, ne s’était pas encore entièrement détaché de la nature environnante. Il n’eut pendant longtemps aucune notion cohérente ni de lui-même, ni des conditions naturelles de son existence.
Ce n’est que peu à peu qu’apparaissent chez lui des
représentations très limitées et primitives sur lui-même et sur les conditions de sa vie. Il ne pouvait encore être question de conceptions religieuses, que les défenseurs de la religion prétendent inhérentes de toute éternité à la conscience humaine. C’est seulement par la suite que l’homme primitif, incapable de comprendre et d’expliquer les phénomènes de la nature et de la vie sociale, se mit à peupler le monde d’êtres surnaturels, d’esprits, de forces magiques. Il animait les forces de la nature. C’est ce qu’on a appelé l’animisme (du latin animus : âme). De ces notions confuses sur l’homme et la nature naquirent les mythes primitifs et la religion primitive où l’on retrouvait l’égalitarisme du régime social. L’homme, qui ignorait la division en classes et l’inégalité des fortunes dans la vie réelle, ne hiérarchisait pas non plus le monde imaginaire des esprits. Il divisait ceux-ci en esprits familiers et étrangers, favorables et hostiles. La hiérarchisation des esprits date de l’époque de la désagrégation de la communauté primitive.L’homme se sentait intimement lié à la gens ; il ne se concevait pas en dehors de celle-ci. Le culte des ancêtres communs était le reflet idéologique de cet état de choses. Il est significatif que les mots « moi » et « mon » n’apparaissent qu’assez tard dans la langue. La gens exerçait sur chacun de ses membres un pouvoir extraordinairement étendu. La désagrégation de la communauté primitive s’accompagna de la naissance et de la diffusion de notions centrées sur la propriété privée, ce dont témoignent éloquemment les mythes et les idées religieuses. À l’époque où s’établirent les rapports de propriété privée et où l’inégalité des fortunes commença à s’affirmer, on prit l’habitude dans de nombreuses tribus, de conférer un caractère sacré (« tabou ») aux biens que s’étaient attribués les chefs des familles riches (dans les îles du Pacifique le mot « tabou » s’applique à tout ce qui est frappé d’interdiction, soustrait à l’usage général). Avec la désagrégation de la communauté primitive et l’apparition de la propriété privée, l’interdit religieux consacra les nouveaux rapports économiques et l’inégalité des fortunes.
Résumé du chapitre 1
-
C’est grâce au travail que les hommes se sont dégagés du règne animal et que la société humaine a pu se constituer. Le travail humain est avant tout caractérisé par la confection d’instruments de production.
-
Les forces productives de la société primitive se trouvaient à un niveau extrêmement bas, les instruments de production étaient extrêmement primitifs. D’où la nécessité du travail collectif, de la propriété sociale des moyens de production et de la répartition égalitaire. Sous le régime de la communauté primitive, l’inégalité des fortunes, la propriété privée des moyens de production, les classes et l’exploitation de l’homme par l’homme étaient inconnues. La propriété sociale des moyens de production était limitée au cadre restreint de petites communautés plus ou moins isolées les unes des autres.
-
La loi économique fondamentale du régime de la communauté primitive consiste à assurer aux hommes les moyens d’existence nécessaires à l’aide d’instruments de production primitifs, sur la base de la propriété communautaire des moyens de production, par le travail collectif et par la répartition égalitaire des produits.
-
Pendant longtemps les hommes, qui travaillaient en commun, accomplirent le même genre de travail. L’amélioration progressive des instruments de production contribua à l’établissement de la division naturelle du travail selon le sexe et l’âge. Le perfectionnement ultérieur des instruments de production et du mode d’obtention des moyens d’existence, le développement de l’élevage et de l’agriculture firent apparaître la division sociale du travail et l’échange, la propriété privée et l’inégalité des fortunes, entraînèrent la division de la société en classes et l’exploitation de l’homme par l’homme. Ainsi, les forces productives accrues entrèrent en conflit avec les rapports de production ; en conséquence, le régime de la communauté primitive fit place à un autre type de rapports de production, à la société esclavagiste.
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par Pcautunois le 27 Avril 2011 à 12:50
Chapitre 2 — Le mode de production fondé sur l’esclavage
2.1. La naissance de l’esclavage.
L’esclavage est, historiquement, la première et la plus grossière forme d’exploitation. Il a existé chez presque tous les peuples.
Le passage du régime de la communauté primitive à celui de l’esclavage s’est d’abord produit dans les pays d’Orient. Le mode de production fondé sur l’esclavage était prépondérant en Mésopotamie (Sumérie, Babylonie. Assyrie, etc.), en Égypte, dans l’Inde et en Chine du 4e au 2e millénaire avant notre ère. Au 1er millénaire avant notre ère, il régnait en Transcaucasie (Ourartou) ; depuis les 8e et 7e siècles avant notre ère jusqu’aux 5e et 6e siècles de notre ère, il a existé au Khorezm un puissant État esclavagiste. La civilisation des pays de l’Orient antique, où régnait l’esclavage, exerça une influence considérable sur les peuples européens.
En Grèce, l’apogée du mode de production basé sur l’esclavage se situe aux 5e et 4e siècles avant notre ère. Par la suite, l’esclavage se développa en Asie mineure, en Égypte, en Macédoine (du 4e au 1er siècle avant notre ère). Il atteignit son plus haut degré de développement à Rome, du 2e siècle avant notre ère au 2e siècle de notre ère.
L’esclavage revêtit d’abord un caractère patriarcal, domestique. Les esclaves étaient relativement peu nombreux. Le travail servile ne constituait pas encore la base de la production et ne jouait qu’un rôle auxiliaire dans l’économie dont le but restait de subvenir aux besoins de la grande famille patriarcale qui n’avait presque pas recours aux échanges. Le maître avait déjà sur ses esclaves un pouvoir illimité, mais le champ d’application du travail servile restait limité.
Le passage de la société au régime de l’esclavage s’explique par le progrès des forces productives, le développement de la division sociale du travail et des échanges. Le passage des outils de pierre aux outils de métal ouvrit au travail humain des domaines nouveaux. L’invention du soufflet de forge permit de fabriquer des instruments de fer d’une solidité encore inconnue. La hache de fer rendit possible le défrichement des terrains couverts de forêts et de buissons et leur mise en culture ; l’araire à soc de fer permit de cultiver des superficies relativement étendues. L’économie primitive fondée sur la chasse céda la place à la culture et à l’élevage. Les métiers firent leur apparition.
Dans l’agriculture, qui restait la principale branche de la production, les procédés de culture et d’élevage s’améliorèrent. De nouvelles plantes furent cultivées : vigne, lin, plantes oléagineuses, etc. Les troupeaux s’accrurent rapidement dans les familles riches. L’entretien du bétail réclamait toujours plus de bras. Le tissage, l’art de traiter les métaux, la poterie et les autres métiers se perfectionnèrent. Le métier, qui était auparavant une occupation annexe pour le cultivateur et l’éleveur, devint pour beaucoup une activité autonome. Le métier se détacha de l’agriculture.
Ce fut la deuxième grande division sociale du travail.
Avec la division de la production en deux branches essentielles : l’agriculture et le métier, apparaît la production directe pour l’échange, sous une forme encore peu développée, il est vrai. L’élévation de la productivité du travail augmenta la masse du surproduit, ce qui, en raison de l’existence de la propriété privée des moyens de production, permit à une minorité de la société d’accumuler des richesses et, grâce à elles, d’assujettir la majorité laborieuse à la minorité exploiteuse, de réduire les travailleurs en esclavage.
Dans les conditions de l’esclavage, l’économie était avant tout une économie naturelle. On entend par économie naturelle une économie dans laquelle les fruits du travail ne font pas l’objet d’échange et sont consommés dans l’exploitation même. Mais en même temps l’échange se développait. Les artisans produisirent d’abord sur commande, puis pour le marché. Beaucoup, du reste, continuèrent longtemps encore à cultiver de petits lopins de terre pour subvenir à leurs besoins. Les paysans, qui vivaient pour l’essentiel en économie naturelle, se voyaient pourtant obligés de vendre une partie de leurs produits sur le marché pour acheter des articles aux artisans et payer les impôts. Ainsi une partie des produits du travail des artisans et des paysans se transforma peu à peu en marchandises.
La marchandise est un produit fabriqué non pour être directement consommé, mais pour être échangé, vendu sur le marché. La production pour l’échange caractérise l’économie marchande. Ainsi, la séparation du métier d’avec l’agriculture, l’apparition du métier comme activité autonome marquaient la naissance de la production marchande.
Tant que l’échange ne fut qu’occasionnel, on échangeait directement un produit du travail contre un autre. Mais quand les échanges prirent de l’extension et devinrent réguliers, une marchandise se dégagea peu à peu, contre laquelle on échangeait volontiers toute autre marchandise. C’est ainsi qu’apparut la monnaie. La monnaie est la marchandise universelle qui sert à évaluer toutes les autres marchandises et joue le rôle d’intermédiaire dans les échanges.
Le développement du métier et de l’échange eut pour conséquence la formation des villes. Celles-ci sont apparues dès la plus haute antiquité, à l’aube du mode de production esclavagiste. La ville se distingua d’abord fort peu du village. Mais peu à peu le métier et le commerce s’y concentrèrent. Par le genre d’occupation de leurs habitants, par leur mode de vie, les villes se différencièrent de plus en plus de la campagne. Ainsi commença la séparation de la ville et de la campagne et se dessina leur opposition.
À mesure que la masse des marchandises à échanger augmentait, les limites territoriales de l’échange s’élargissaient elles aussi. Des marchands apparurent qui, pour réaliser un gain, achetaient les marchandises aux producteurs, les amenaient sur des marchés parfois assez éloignés du lieu de la production, et les revendaient aux consommateurs.
L’extension de la production et des échanges accrut l’inégalité des fortunes. La monnaie, les animaux de trait, les instruments de production, les semences s’accumulaient entre les mains des riches. De plus en plus souvent les pauvres étaient obligés de recourir à ces derniers pour obtenir un prêt, la plupart du temps en nature, mais parfois aussi en argent. Les riches prêtaient instruments de production, semences, argent, assujettissant leurs débiteurs qu’ils réduisaient en esclavage et dépouillaient de leur terre en cas de non-remboursement de la dette. Ainsi naquit l’usure. Elle apporta aux uns un surcroît de richesses, aux autres la sujétion du débiteur.
La terre, à son tour, devint propriété privée. On se mit à la vendre et à l’hypothéquer. Si le débiteur ne pouvait rembourser l’usurier, il devait abandonner sa terre, vendre ses enfants et se vendre lui-même comme esclaves. Parfois, sous un prétexte quelconque, les gros propriétaires fonciers s’emparaient de prairies et de pâturages appartenant aux communautés rurales.
C’est ainsi que la propriété foncière, l’argent et la masse des esclaves se concentrèrent entre les mains de riches propriétaires. La petite exploitation paysanne se ruinait de plus en plus alors que l’économie fondée sur l’esclavage se renforçait, s’élargissait et s’étendait à toutes les branches de la production.
L’accroissement constant de la production, et avec elle de la productivité du travail, accrut la valeur de la force de travail humaine ; l’esclavage qui, au stade antérieur, était encore à l’origine et restait sporadique, devient maintenant un composant essentiel du système social ; les esclaves cessent d’être de simples auxiliaires ; c’est par douzaines qu’on les pousse au travail, dans les champs et à l’atelier.
( F. Engels, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, p. 149, Éditions sociales, Paris, 1954. )C’est sur le travail servile que repose désormais l’existence de la société. Celle-ci se divise en deux grandes classes antagonistes : celle des esclaves et celle des propriétaires d’esclaves.
Ainsi se constitua le mode de production fondé sur l’esclavage.
Sous le régime de l’esclavage, la population se divisait en hommes libres et en esclaves. Les hommes libres jouissaient de tous les droits civiques, politiques et de propriété (sauf les femmes réduites en fait à la condition d’esclaves). Les esclaves étaient privés de ces droits et l’accès de la classe des hommes libres leur était interdit. Les hommes libres, à leur tour, se divisaient en deux classes : les grands propriétaires fonciers, qui étaient en même temps de grands propriétaires d’esclaves, et les petits producteurs (paysans, artisans) dont les plus aisés utilisaient également le travail servile et possédaient des esclaves. Les prêtres, qui jouaient un rôle important à l’époque de l’esclavage, se rattachaient par leur situation à la classe des grands propriétaires de terres et d’esclaves.
Outre la contradiction de classe entre maîtres et esclaves, il en existait une autre : entre grands propriétaires fonciers et paysans. Mais étant donné qu’avec le développement du régime esclavagiste le travail servile, qui était le moins coûteux, s’étendit à la plupart des branches d’activité et finit par constituer la principale base de la production, la contradiction entre maîtres et esclaves devint la contradiction fondamentale de la société.
La division de la société en classes rendit nécessaire la formation de l’État. Avec les progrès de la division sociale du travail et le développement de l’échange, les gentes et les tribus se rapprochèrent, s’unirent en confédérations. Le caractère des institutions gentilices se modifia. Les organes du régime gentilice perdirent de plus en plus leur caractère populaire. Ils se transformèrent en organes de domination sur le peuple, en organes ayant pour objet de spolier et d’opprimer leurs propres tribus et les tribus voisines. Les anciens et les chefs militaires des gentes et des tribus devinrent des princes et des rois. Ils devaient autrefois leur autorité à leur qualité d’élus de la gens ou d’une fédération de gentes. Ils usèrent dorénavant de leur pouvoir pour défendre les intérêts des couches possédantes, pour tenir en bride leurs concitoyens en train de se ruiner, pour réprimer les esclaves. C’est aussi à quoi servirent les détachements armés, les tribunaux, les organismes punitifs.
Ainsi naquit le pouvoir d’État.
C’est seulement quand l’esclavage, première forme de division de la société en classes, est apparu ; quand une classe d’hommes, en s’adonnant aux formes les plus rudes du travail agricole, a pu produire un certain excédent, et que cet excédent qui n’était pas absolument indispensable à l’existence extrêmement misérable de l’esclave, était accaparé par les propriétaires d’esclaves, c’est alors que cette dernière classe s’est affermie ; mais pour qu’elle pût s’affermir, il fallait que l’État apparut.
( V. Lénine, « De l’État », Œuvres, t. 29, p. 482-483. )L’État a surgi pour tenir en bride la majorité exploitée dans l’intérêt de la minorité exploiteuse. L’État esclavagiste a joué un rôle considérable dans le développement et la consolidation des rapports de production de la société fondée sur l’esclavage. Il maintenait dans l’obéissance les foules d’esclaves. Il grandit, se ramifia et devint un vaste appareil de domination et de violence dirigé contre les masses populaires. Les démocraties de la Grèce et de la Rome antiques, qu’exaltent les manuels d’histoire bourgeois, n’étaient au fond que des démocraties de propriétaires d’esclaves.
2.2. Les rapports de production de la société esclavagiste. La situation des esclaves.
La propriété du maître non seulement sur les moyens de production, mais aussi sur les producteurs, les esclaves, formait la base des rapports de production de la société esclavagiste. L’esclave était considéré comme une chose ; son maître avait sur lui un pouvoir absolu. Il n’était pas seulement exploité ; on pouvait le vendre et l’acheter comme du bétail, ou même le tuer impunément. Si, à l’époque de l’esclavage patriarcal, il était regardé comme un membre de la famille, avec le développement du mode de production esclavagiste, il cessa même d’être considéré comme un homme.
L’esclave ne vendait pas sa force de travail au possesseur d’esclaves, pas plus que le bœuf ne vend le produit de son travail au paysan. L’esclave est vendu, y compris sa force de travail, une fois pour toutes à son propriétaire.
( K. Marx, Travail salarié et capital, suivi de Salaire, prix et profit, p. 32, Éditions sociales. )Le travail servile avait un caractère de contrainte non dissimulé. On obligeait les esclaves à travailler par les moyens les plus brutaux. On les poussait au travail à coups de fouet, on les punissait férocement à la moindre peccadille. On les marquait pour les retrouver plus facilement s’ils s’enfuyaient. Beaucoup portaient jour et nuit un collier de fer sur lequel était inscrit le nom de leur maître.
Celui-ci s’appropriait la totalité des fruits du travail servile. Il ne donnait aux esclaves qu’un minimum de moyens d’existence, juste assez pour qu’ils ne meurent pas de faim et puissent continuer à travailler pour lui. Il s’attribuait le surproduit, mais aussi une grande partie du produit nécessaire.
Le développement du mode de production fondé sur l’esclavage s’accompagnait d’une demande d’esclaves toujours accrue. Dans certains pays les esclaves, en règle générale, n’avaient pas de famille. Une exploitation brutale entraînait leur usure rapide. Il en fallait sans cesse de nouveaux. La guerre était la grande pourvoyeuse d’esclaves. Les États esclavagistes de l’Orient ancien étaient sans cesse en guerre pour conquérir d’autres peuples. L’histoire de la Grèce antique est pleine des guerres que se livraient les cités entre elles, les métropoles et les colonies, les États grecs et orientaux. Rome fit constamment la guerre ; à son apogée, elle soumit la plus grande partie du monde alors connu. On réduisait en esclavage non seulement les soldats faits prisonniers, mais encore une grande partie de la population des pays conquis.
Les provinces et les colonies fournissaient également des esclaves. Elles procuraient cette « marchandise vivante » au même titre que toute autre marchandise. Le commerce des esclaves était une des branches de l’activité économique les plus lucratives et les plus florissantes. Il existait à cet effet des centres spéciaux, des marchés où vendeurs et acheteurs, venus de lointains pays, se rencontraient.
Le mode de production esclavagiste ouvrait de plus larges possibilités à l’accroissement des forces productives que la communauté primitive. La concentration d’un grand nombre d’esclaves entre les mains de l’État esclavagiste et des propriétaires d’esclaves permettait d’appliquer la coopération simple sur une très large échelle. En témoignent les ouvrages gigantesques réalisés dans l’antiquité par les peuples de la Chine, de l’Inde, de l’Égypte, de l’Italie, de la Grèce, de la Transcaucasie, de l’Asie Centrale, et d’autres encore : systèmes d’irrigation, routes, ponts, fortifications, monuments.
La division sociale du travail se développait, elle aboutissait à la spécialisation dans l’agriculture et les métiers, et par suite à une augmentation de la productivité du travail.
En Grèce, la main-d’œuvre servile était largement employée dans les métiers. De grands ateliers (ergasteries) firent leur apparition, où des dizaines d’esclaves travaillaient ensemble. Le travail servile était également utilisé dans la construction, l’extraction du minerai de fer, de l’argent et de l’or. À Rome, il était très répandu dans l’agriculture. L’aristocratie romaine possédait des latifundia, vastes domaines où peinaient des centaines et des milliers d’esclaves. Ces latifundia avaient été constitués par l’accaparement des terres paysannes et par des usurpations sur le domaine public.
Le bon marché du travail servile et les avantages de la coopération simple permettaient aux latifundia de produire du blé et d’autres denrées agricoles à meilleur compte que les petites exploitations des paysans libres. La petite paysannerie était évincée, réduite en esclavage, ou allait à la ville grossir les rangs des couches misérables de la population.
L’opposition entre la ville et la campagne, qui était apparue dès le passage du régime de la communauté primitive au régime esclavagiste, s’accroissait de plus en plus. Les villes deviennent les centres de rassemblement de l’aristocratie esclavagiste, des marchands, des usuriers, des fonctionnaires de l’État esclavagiste, qui tous exploitaient les masses de la population paysanne.
Grâce au travail servile, le monde antique atteignit un degré de développement économique et culturel remarquable Mais un régime fondé sur l’esclavage ne pouvait créer les conditions d’un progrès technique de quelque importance. Le travail servile était caractérisé par un rendement extrêmement bas. L’esclave ne portait aucun intérêt à son travail. Il avait en haine le labeur auquel il était astreint. Souvent sa protestation et son indignation se traduisaient par des détériorations d’outils. Aussi ne lui confiait-on que des instruments grossiers qu’il eût été difficile de détériorer.
La production restait à un niveau technique très bas. Malgré un certain développement des sciences naturelles et des sciences exactes, celles-ci n’étaient presque pas appliquées dans la production. Si quelques inventions techniques étaient utilisées, c’était uniquement pour la guerre et dans la construction. Au cours des siècles que dura sa domination, le mode de production esclavagiste se contenta d’instruments manuels empruntés au petit cultivateur et à l’artisan, il ne dépassa jamais le stade de la coopération simple. La principale force motrice restait la force physique de l’homme et des animaux domestiques.
L’emploi généralisé de la main-d’œuvre servile permit aux possesseurs d’esclaves de se décharger sur ces derniers de tout travail physique. Les propriétaires d’esclaves méprisaient le travail, qu’ils regardaient comme une activité indigne d’un homme libre, et menaient une existence de parasites. À mesure que l’esclavage se développait, des masses de plus en plus considérables de la population libre tournaient le dos à toute activité productrice. Seule une partie de la couche privilégiée des propriétaires d’esclaves et du reste de la population libre s’occupait des affaires publiques, de science et d’art. Ceux-ci atteignirent un important développement.
Le régime de l’esclavage a engendré l’opposition entre le travail manuel et le travail intellectuel, a creusé entre eux un fossé.
L’exploitation des esclaves par leurs maîtres est le trait essentiel des rapports de production de la société esclavagiste. Mais dans chaque pays le mode de production fondé sur l’esclavage présente des particularités.
Dans l’Orient antique, la prédominance de l’économie naturelle était encore plus accusée que dans le monde gréco-romain. Le travail servile était largement utilisé dans les domaines de l’État, des grands propriétaires d’esclaves et des temples. L’esclavage domestique était très répandu. Dans l’agriculture chinoise, indienne, babylonienne et égyptienne, les membres des communautés paysannes étaient exploités en masse parallèlement aux esclaves. L’esclavage pour dettes prit une grande extension. Le membre de la communauté rurale, qui ne s’était pas acquitté de sa dette envers l’usurier ou n’avait pas payé son fermage au propriétaire foncier, se voyait contraint de travailler pendant un certain temps dans les domaines de ces derniers en qualité d’esclave débiteur.
Dans les pays d’esclavage de l’Orient ancien, la terre appartenait souvent à la communauté ou à l’État. Ces formes de propriété étaient liées au système d’agriculture, fondé sur l’irrigation. Dans les vallées fluviales, l’agriculture irriguée exigeait de grands travaux pour la construction de digues, de canaux et de réservoirs, pour l’assèchement des marais. D’où la nécessité de centraliser la construction et l’exploitation des systèmes d’irrigation à l’échelle de vastes territoires.
L’irrigation artificielle y constitue la première condition de l’agriculture, et ceci est l’affaire des communautés, des provinces ou du gouvernement central.
( Lettre de Friedrich Engels à Karl Marx, du 6 juin 1853. Correspondance K. Marx-F. Engels, t. 3. )Avec le développement de l’esclavage, les terres des communautés se concentrèrent de plus en plus entre les mains de l’État. Le roi, qui exerçait un pouvoir absolu, devint le propriétaire suprême du sol. Monopolisant la propriété de la terre, l’État esclavagiste accablait les paysans d’impôts, faisait peser sur eux toutes sortes de charges, les réduisant ainsi à la condition d’esclaves. Les paysans continuaient à faire partie de leurs communautés. Mais la terre se trouvant aux mains de l’État esclavagiste, la communauté formait la base permanente du despotisme oriental, c’est-à-dire d’un pouvoir monarchique absolu et sans contrôle. L’aristocratie sacerdotale jouait un rôle important dans les pays d’Orient où dominait l’esclavage. Les vastes domaines appartenant aux temples reposaient sur le travail servile.
Sous le régime de l’esclavage, la majeure partie du travail servile et de son produit était, dans tous les pays, dépensée par les propriétaires d’esclaves de façon improductive pour satisfaire des caprices individuels, amasser des trésors, construire des ouvrages militaires et mettre sur pied des armées, bâtir et entretenir des palais et des temples somptueux. Les pyramides d’Égypte sont un exemple frappant de ces énormes dépenses de travail improductives. Seule une partie infime du labeur servile et de son produit était consacrée à l’extension de la production dont le développement, de ce fait, était très lent. Les guerres dévastatrices entraînaient la destruction des forces productives, l’extermination d’une grande partie de la population non combattante et la disparition de civilisations entières.
La loi économique fondamentale du régime de l’esclavage réside dans la production d’un surproduit pour la satisfaction des besoins des possesseurs d’esclaves en exploitant brutalement les esclaves sur la base de la propriété complète des moyens de production et des esclaves par les possesseurs d’esclaves, par la ruine et l’asservissement des paysans et des artisans, ainsi que par la conquête et l’asservissement des peuples des autres pays.
2.3. Le développement de l’échange. Le capital commercial et le capital usuraire.
L’économie esclavagiste restait pour l’essentiel une économie naturelle. Ce qu’elle produisait était surtout destiné à être directement consommé par le propriétaire d’esclaves, ses nombreux parasites et sa valetaille, et non à être échangé. L’échange joua pourtant un rôle de plus en plus marquant, surtout à l’apogée du régime esclavagiste. Dans certaines branches de la production, une partie des produits était régulièrement vendue sur le marche, autrement dit convertie en marchandises.
Avec le progrès des échanges, le rôle de la monnaie s’accrut. D’ordinaire, c’était la marchandise le plus fréquemment échangée qui devenait monnaie. Chez de nombreux peuples, notamment ceux qui s’adonnaient à l’élevage, le bétail remplit d’abord cet office. Ailleurs, ce fut le sel, le blé, les fourrures. Peu à peu ces différentes formes de monnaie furent remplacées par la monnaie métallique.
Les premières monnaies métalliques firent leur apparition dans l’Orient antique où elles circulèrent sous forme de lingots de bronze, d’argent et d’or dès les 3e et 2e millénaires avant notre ère, et sous forme de monnaies frappées à partir du 7e siècle avant notre ère. Des monnaies de fer avaient cours en Grèce huit siècles avant notre ère. Aux 5e et 4e siècles avant notre ère, Rome ne connaissait encore que la monnaie de cuivre. Par la suite, l’argent et l’or remplacèrent le fer et le cuivre en qualité de monnaie.
Les cités grecques entretenaient un commerce assez actif, notamment avec leurs colonies dispersées le long du littoral de la Méditerranée et de la mer Noire. Les colonies fournissaient régulièrement des esclaves, principale force de travail, des matières premières et des moyens d’existence : peaux, laine, bétail, blé, poisson.
Outre le commerce des esclaves et d’autres marchandises, le commerce des objets de luxe jouait un rôle important à Rome comme en Grèce. Ces
objets étaient fournis par les peuples d’Orient, principalement à titre de tribut. Le commerce s’accompagnait du pillage, de la piraterie et de l’asservissement des colonies.Sous le régime de l’esclavage, l’argent n’était pas seulement un moyen d’acheter et de vendre des marchandises. Il servait aussi à s’approprier le travail d’autrui par le commerce et l’usure. L’argent dépensé pour s’approprier le surtravail et son produit devient capital, c’est-à-dire un moyen d’exploitation. Le capital commercial et le capital usuraire ont été, historiquement, les premières formes de capital. Le capital commercial est le capital engagé dans la sphère de l’échange des marchandises. En achetant et en revendant, les marchands s’appropriaient une importante partie du surproduit créé par les esclaves, les petits paysans et les artisans. Le capital usuraire est le capital utilisé sous forme de prêts d’argent, de moyens de production ou d’objets de consommation pour s’approprier le surtravail des paysans et des artisans par le prélèvement d’intérêts élevés. Les usuriers prêtaient également de l’argent à l’aristocratie et avaient ainsi part au surproduit que fournissait à celle-ci le travail de ses esclaves.
2.4. L’aggravation des contradictions du mode de production esclavagiste.
L’esclavage a été une étape nécessaire dans l’histoire de l’humanité.
Ce fut seulement l’esclavage qui rendit possible sur une assez grande, échelle la division du travail entre agriculture et industrie et, par suite, l’apogée du monde antique, l’hellénisme. Sans esclavage, pas d’État grec, pas d’art et de science grecs ; sans esclavage, pas d’Empire romain. Or, sans la base de l’hellénisme et de l’Empire romain, pas non plus d’Europe moderne.
( F. Engels, Anti-Dühring, p. 213. )C’est sur les ossements de générations d’esclaves que s’est épanouie la civilisation qui a été à la base des progrès ultérieurs de l’humanité. De nombreuses branches du savoir : mathématiques, astronomie, mécanique, architecture, ont atteint dans le monde antique un degré de développement remarquable. Les objets d’art, les chefs-d’œuvre de la littérature, de la sculpture et de l’architecture que nous a légués l’antiquité, font à jamais partie du trésor de la culture humaine.
Mais le régime esclavagiste était déchiré par des contradictions insolubles, qui le conduisirent finalement à sa perte. La forme d’exploitation qu’était l’esclavage détruisait la principale force productive de la société : les esclaves. La lutte de ces derniers contre l’exploitation féroce dont ils étaient les victimes, se traduisait de plus en plus fréquemment par des révoltes. L’afflux ininterrompu de nouveaux esclaves, leur bon marché, était la condition d’existence de l’économie esclavagiste. La guerre était la grande pourvoyeuse d’esclaves. La puissance militaire de la société esclavagiste reposait sur la masse des petits producteurs libres : paysans et artisans, qui composaient l’armée et supportaient le poids principal des impôts nécessités par la guerre. Mais la concurrence de la grande production fondée sur le travail servile meilleur marché, et les charges écrasantes ruinaient les paysans et les artisans. L’antagonisme irréductible entre les latifundia et les exploitations paysannes ne cessait de s’aggraver.
La disparition de la paysannerie libre sapait la puissance économique, mais aussi la puissance militaire et politique des États esclavagistes, et notamment de Rome. Aux victoires succédèrent les défaites, aux guerres de conquête des guerres défensives. La source était tarie, qui fournissait jadis sans arrêt des esclaves à bon compte. Les côtés négatifs du travail servile se manifestaient avec toujours plus de netteté. Les deux derniers siècles de l’Empire romain furent marqués par un déclin général de la production. Le commerce fut désorganisé ; des contrées autrefois riches s’appauvrirent ; la population diminua ; les métiers dépérirent ; les villes se vidèrent.
Les rapports de production fondés sur le travail servile étaient devenus des entraves pour les forces productives accrues de la société. Le travail des esclaves, aucunement intéressés à la production, avait épuisé ses possibilités. Il était devenu historiquement nécessaire de remplacer les rapports de production fondés sur l’esclavage par d’autres rapports, qui permettraient de modifier la situation sociale des masses laborieuses, principale force productive. La loi de la correspondance nécessaire entre les rapports de production et le caractère des forces productives exigeait que les esclaves fussent remplacés par des travailleurs ayant quelque intérêt aux résultats de leur travail.
Comme la grande production fondée sur l’esclavage avait cessé d’être rémunératrice, le maître affranchissait en masse ses esclaves, dont le travail ne lui fournissait plus de revenus. Les grands domaines furent morcelés en petites parcelles remises à certaines conditions soit à d’anciens esclaves, soit à des citoyens autrefois libres, qui étaient astreints désormais à toutes sortes de redevances au bénéfice du propriétaire foncier. Ces nouveaux cultivateurs étaient attachés à leurs parcelles et pouvaient être vendus avec elles. Mais ils n’étaient plus esclaves.
C’était une nouvelle catégorie de petits producteurs dont la situation était intermédiaire entre celles des hommes libres et des esclaves, et qui avait quelque intérêt au travail. Ces colons, comme on les appelait, furent les prédécesseurs des serfs du Moyen âge.
Ainsi apparaissaient, au sein même de la société esclavagiste, les éléments d’un mode de production nouveau, le mode féodal.
2.5. La lutte de classe des exploités contre leurs exploiteurs. Les révoltes d’esclaves. La fin du régime de l’esclavage.
L’histoire des sociétés fondées sur l’esclavage dans l’Orient ancien, en Grèce et à Rome montre qu’avec le développement de l’économie esclavagiste la lutte de classe des masses asservies contre leurs oppresseurs s’intensifiait. Les révoltes d’esclaves se combinaient avec la lutte des petits paysans exploités contre la couche privilégiée des grands propriétaires d’esclaves et de terres.
La contradiction entre les petits producteurs et les grands propriétaires fonciers donna naissance dès le début du développement de la société esclavagiste, parmi les hommes libres, à un mouvement démocratique qui se proposait d’annuler les dettes, de procéder au partage des terres, de retirer ses privilèges à l’aristocratie foncière, de donner le pouvoir au peuple, au « démos ».
Parmi les nombreuses révoltes d’esclaves dont l’Empire romain fut le théâtre, la plus importante est celle que dirigea Spartacus (74-71 avant notre ère), au nom duquel se rattache l’épisode le plus glorieux de la lutte des esclaves contre leurs maîtres.
Au cours des siècles, les soulèvements d’esclaves furent fréquents ; les paysans ruinés se joignaient à eux. Les plus importants éclatèrent aux 2e et 1er siècles avant notre ère et du 3e au 5e siècle de notre ère. Les propriétaires d’esclaves réprimèrent ces révoltes avec la dernière cruauté.
Les soulèvements des masses exploitées, et surtout des esclaves, minèrent la puissance de Rome. Ces poussées internes étaient de plus en plus souvent accompagnées de poussées externes. Les habitants des pays voisins emmenés en esclavage se soulevaient dans les champs d’Italie tandis que leurs compatriotes restés en liberté attaquaient et forçaient les frontières de l’Empire, renversaient la domination romaine. Toutes ces circonstances hâtèrent la fin du régime esclavagiste à Rome.
C’est dans l’Empire romain que le mode de production fondé sur l’esclavage atteignit son apogée. La chute de l’Empire romain marqua aussi la fin du régime de l’esclavage dans son ensemble.
À ce régime succéda la féodalité.
Les conceptions économiques de l’époque de l’esclavage.
Les conceptions économiques de la période de l’esclavage ont trouvé leur expression dans maints ouvrages que nous ont laissés les poètes, les philosophes, les historiens, les hommes d’État et les personnalités publiques, pour qui l’esclave n’était pas un homme, mais une chose entre les mains de son maître. Le travail servile était méprisé ; or, le travail devenait de plus en plus le lot des esclaves ; aussi fut-il bientôt considéré comme une activité indigne d’un homme libre.
Le code du roi Hammourabi (18e siècle avant notre ère) témoigne des conceptions économiques de la société esclavagiste babylonienne. Ce code protège la propriété et les droits des riches et des nobles, des propriétaires d’esclaves et de terres. Quiconque cache un esclave fugitif est passible de mort. Le paysan qui n’a pas payé sa dette au créancier ou son fermage au propriétaire foncier doit livrer sa femme, son fils ou sa fille qui sont réduits en esclavage, jusqu’à ce qu’ils aient acquitté la dette par leur travail. Les lois de Manou, dans l’Inde antique, sont un recueil de prescriptions sociales, religieuses et morales qui consacrent l’esclavage. L’esclave n’a aucune propriété. La loi punissait de mort quiconque «cachait dans sa maison un esclave fugitif».
Les idées des classes dominantes se retrouvaient dans la religion. Ainsi le bouddhisme, qui se répandit dans l’Inde à partir du 6e siècle avant notre ère, prêchait la résignation, la non-résistance à la violence et l’humilité devant les classes dominantes ; l’aristocratie esclavagiste s’en servit pour consolider sa domination.
Même les penseurs éminents de l’Antiquité ne pouvaient se représenter une société sans esclaves. Ainsi le philosophe grec Platon (5e-4e siècles avant notre ère), qui composa la première utopie connue, maintenait l’esclavage dans sa république idéale. Le travail des esclaves, des cultivateurs et des artisans devait procurer les moyens d’existence indispensables à la classe supérieure, celle des gouvernants et des guerriers.
Aux yeux d’Aristote, le plus grand penseur de l’Antiquité (4e siècle avant notre ère), l’esclavage était pour la société une nécessité éternelle. Aristote a exercé une influence considérable sur la vie intellectuelle de l’Antiquité et du Moyen âge. Tout en s’élevant bien au-dessus de son temps lorsqu’il formule ses hypothèses et ses prévisions scientifiques, il reste, sur la question de l’esclavage, prisonnier des idées de la société de son époque. Son raisonnement est le suivant : de même que le gouvernail est pour le pilote un instrument inanimé, l’esclave est un instrument animé. Si les outils travaillaient d’eux-mêmes sur notre ordre, si par exemple les navettes tissaient toutes seules, on n’aurait pas besoin d’esclaves. Mais comme nombre d’occupations exigent un travail grossier, peu compliqué, la nature, dans sa sagesse, a créé les esclaves. Certains sont nés pour être esclaves et les autres pour les diriger. Le travail servile procure aux hommes libres des loisirs pour leur perfectionnement. Tout l’art du maître consiste donc à tirer le meilleur parti de ses esclaves.
C’est Aristote qui a créé le terme d’ « oïkonomia ». De son temps l’échange, le commerce et l’usure avaient déjà pris un certain développement, mais dans l’ensemble l’économie restait une économie naturelle, consommatrice. Aristote considérait comme seuls légitimes les biens acquis par l’agriculture et le métier ; c’est un partisan de l’économie naturelle. Mais il comprenait la nature réelle de l’échange, trouvant parfaitement normal l’échange pour la consommation « puisque les hommes ont d’ordinaire certains objets en quantité supérieure, et d’autres objets en quantité inférieure à leurs besoins ». Il comprenait que la monnaie était nécessaire aux échanges.
Par ailleurs Aristote condamnait le commerce s’il était exercé à des fins de lucre, ainsi que l’usure. À la différence de l’agriculture et du métier, ces activités, disait-il, ne posent aucune borne à l’acquisition des richesses.
Les anciens Grecs avaient déjà une idée de la division du travail et de son rôle dans la vie sociale. Platon, par exemple, la plaçait à la base du régime dont il dotait sa république idéale.
Les idées des Romains en matière économique étaient également fonction du mode de production fondé sur l’esclavage, qui prédominait alors.
Les écrivains et les hommes politiques, idéologues de la classe des propriétaires d’esclaves, considéraient les esclaves comme de simples instruments. C’est au polygraphe Varron (1er siècle avant notre ère), qui composa entre autres une sorte de manuel d’agriculture à l’usage des propriétaires d’esclaves, qu’appartient la célèbre division des instruments en : 1, instruments muets (chariots) ; 2, instruments qui émettent des sons inarticulés (bétail) ; et 3, instruments doués de la parole (esclaves). Il ne faisait qu’exprimer par là les opinions généralement admises par les propriétaires d’esclaves.
L’art de diriger les esclaves préoccupait les esprits, à Rome comme en Grèce. L’historien Plutarque (1er-2e siècles de notre ère) rapporte que Caton, maître « modèle », achetait ses esclaves encore enfants, « dans un âge où, pareils aux petits chiens et aux poulains, ils se prêtent facilement à l’éducation et au dressage ». Il relate ensuite qu’ « il imaginait sans cesse de nouveaux moyens d’entretenir parmi les esclaves la discorde et la division, car il craignait leur bonne entente, qu’il considérait comme dangereuse ».
Par la suite, dans l’Empire romain, l’écroulement et la désagrégation de l’économie fondée sur le travail forcé des esclaves s’accentuèrent. L’écrivain latin Columelle (1er siècle de notre ère) se plaignait en ces termes : « Les esclaves causent un grave préjudice aux champs. Ils prêtent les bœufs et soignent mal le troupeau. Ils labourent de façon déplorable. » Pline l’Ancien, son contemporain, déclarait: « Les latifundia ont perdu l’Italie et les provinces. »
De même que les Grecs, les Romains considéraient comme normale l’économie naturelle où le maître n’échange que ses excédents. Les ouvrages de l’époque condamnent parfois les profits commerciaux élevés et l’intérêt usuraire. Mais les marchands et les usuriers n’en amassaient pas moins d’immenses fortunes.
Dans la dernière période de l’histoire romaine des voix s’élevèrent pour condamner l’esclavage et proclamer l’égalité naturelle des hommes. Il va sans dire que ces idées ne trouvaient point d’écho parmi la classe dominante, celle des propriétaires d’esclaves. Quant aux esclaves, ils étaient si accablés par leur situation misérable, si abrutis et si ignorants, qu’ils étaient incapables d’élaborer une idéologie plus progressiste que les idées périmées de la classe esclavagiste. C’est d’ailleurs là une des raisons du caractère tout spontané et inorganisé des révoltes d’esclaves.
La lutte entre la grande et la petite propriété foncière constituait une des contradictions profondes du régime de l’esclavage. La paysannerie dont la situation devenait de plus en plus difficile réclamait dans son programme la limitation de la grande propriété foncière et le partage des terres. Tel était aussi le but de la réforme agraire défendue par les Gracques (2e siècle avant notre ère).
À l’époque de la désagrégation de l’Empire romain, alors que la grande majorité de la population des villes et des campagnes, esclaves et hommes libres, n’apercevait aucune issue à la situation, l’idéologie de la Rome esclavagiste traversa une crise profonde.
Les contradictions de classe de l’Empire agonisant donnèrent naissance à une nouvelle idéologie religieuse : le christianisme, qui traduisait à l’époque la protestation des esclaves, des masses ruinées de la paysannerie, des artisans et des déclassés contre l’esclavage et l’oppression. Le christianisme répondait aussi à l’état d’esprit de larges fractions des classes dominantes qui avaient conscience de leur situation sans issue. C’est pourquoi, tout en adressant des avertissements sévères aux riches et aux puissants, le christianisme de la chute de l’Empire romain exhortait à l’humilité et à la recherche du salut dans la vie d’outre-tombe.
Dans les siècles qui suivirent, le christianisme devint définitivement la religion des classes dominantes, l’arme spirituelle chargée de défendre et de justifier l’exploitation et l’oppression des masses laborieuses.
Résumé du chapitre 2
-
Le mode de production fondé sur l’esclavage s’est instauré grâce à l’accroissement des forces productives de la société, à l’apparition du surproduit, à la naissance de la propriété privée des moyens de production, y compris la terre, et à l’appropriation du surproduit par les détenteurs des moyens de production.
L’esclavage est la première et la plus grossière forme d’exploitation de l’homme par l’homme. Le maître avait la propriété pleine et entière de son esclave. Il disposait à sa guise non seulement du travail de l’esclave, mais encore de sa vie.
-
Avec le régime de l’esclavage naquit aussi l’État. Celui-ci est le résultat de la scission de la société en classes irréductiblement hostiles ; c’est un appareil permettant à une minorité exploiteuse d’opprimer la majorité exploitée de la société.
-
L’économie esclavagiste était essentiellement une économie naturelle. Le monde antique se subdivisait en une multitude d’unités économiques subvenant elles-mêmes à leurs besoins. Le commerce portait principalement sur les esclaves et les objets de luxe. Le développement de l’échange engendra la monnaie métallique.
-
La loi économique fondamentale du mode de production fondé sur l’esclavage réside dans la production d’un surproduit pour la satisfaction des besoins des propriétaires d’esclaves en exploitant sauvagement les esclaves sur la base de la propriété complète des moyens de production et des esclaves par les possesseurs d’esclaves, par la ruine et l’asservissement des paysans et des artisans, ainsi que par la conquête et l’asservissement des peuples des autres pays.
-
L’esclavage permit l’essor d’une civilisation (sciences, philosophie, arts) d’un niveau relativement élevé, mais dont la mince couche privilégiée de la société esclavagiste était seule à bénéficier. La conscience sociale du monde antique correspondait au mode de production fondé sur l’esclavage. Les classes dominantes et leurs idéologues ne considéraient pas l’esclave comme un homme. Le travail manuel, lot des esclaves, était regardé comme une activité déshonorante, indigne d’un homme libre.
-
Le mode de production esclavagiste entraîna un accroissement des forces productives de la société par rapport au régime de la communauté primitive. Mais par la suite, le travail des esclaves, qui n’avaient aucun intérêt à la production, épuisa toutes ses possibilités. L’extension du travail servile et la situation de parias faite aux esclaves avaient pour conséquence la destruction de la main-d’œuvre, principale force productive de la société, et la ruine des petits producteurs libres : paysans et artisans. D’où la chute inévitable du régime esclavagiste.
-
Les révoltes d’esclaves ébranlèrent le régime esclavagiste et hâtèrent sa destruction. Le mode de production fondé sur l’esclavage fut remplacé par le mode de production féodal, la forme d’exploitation esclavagiste par la forme d’exploitation féodale qui permettait dans une certaine mesure un développement nouveau des forces productives de la société.
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par Pcautunois le 26 Avril 2011 à 13:39
Chapitre 3 — Le mode de production féodal
3.1. L’avènement de la féodalité.
Le régime féodal a existé, avec des particularités différentes, dans presque tous les pays.
La féodalité s’étend sur une longue période. En Chine, le régime féodal a existé plus de deux mille ans. En Europe occidentale, il a duré plusieurs siècles, depuis la chute de l’Empire romain (5e siècle) jusqu’aux révolutions bourgeoises d’Angleterre (17e siècle) et de France (18e siècle) ; en Russie, du 9e siècle à la réforme paysanne de 1861 ; en Transcaucasie, du 4e siècle jusque vers 1870 ; chez les peuples de l’Asie centrale, des 7e et 8e siècles à la victoire de la révolution prolétarienne en Russie.
En Europe occidentale, la féodalité s’est constituée sur les ruines de la société romaine esclavagiste, d’une part, et sur celles de la gens, chez les tribus conquérantes, d’autre part ; elle résulta de l’action réciproque de ces deux processus.
Des éléments de féodalisme existaient, nous l’avons déjà dit, au sein de la société esclavagiste sous la forme du colonat. Les colons étaient tenus de cultiver la terre de leur maître, grand propriétaire foncier, de lui verser une somme d’argent ou de lui remettre une importante partie de la récolte ; ils étaient en outre astreints à certaines redevances. Néanmoins, les colons avaient plus d’intérêt à leur travail que les esclaves, puisqu’ils possédaient leur propre exploitation.
Ainsi se formèrent de nouveaux rapports de production, qui reçurent leur plein développement à l’époque féodale.
L’Empire romain fut détruit par les tribus germaniques, gauloises, slaves et autres, qui habitaient différentes parties de l’Europe. Le pouvoir des propriétaires d’esclaves fut renversé, l’esclavage disparut. Les latifundia et les grands ateliers artisanaux reposant sur le travail servile se disloquèrent. Après la chute de l’Empire romain, la population se composait de grands propriétaires fonciers (anciens propriétaires d’esclaves qui avaient adopté le système du colonat), d’esclaves affranchis, de colons, de petits paysans et d’artisans. À l’époque où elles soumirent Rome, les tribus conquérantes se trouvaient au stade de la communauté primitive en voie de désagrégation. La communauté rurale, qui chez les Germains portait le nom de « marche », jouait un rôle important dans la vie sociale de ces peuplades. La terre, à l’exception des grands domaines de l’aristocratie de la gens, était bien communal. Les forêts, les friches, les pacages, les étangs restaient indivis pour l’usage collectif. Au bout de quelques années, on procédait à un nouveau partage des champs et des prairies entre les membres de la communauté. Mais, peu à peu, le terrain attenant à l’habitation, puis toute la terre arable, passèrent aux familles, en jouissance héréditaire. La répartition des terres, l’examen des affaires concernant la communauté, le règlement des litiges qui s’élevaient entre ses membres, étaient du ressort de l’assemblée de la communauté, des anciens et des juges qu’elle élisait. À la tête des tribus conquérantes se trouvaient des chefs militaires qui, ainsi que leurs suites, possédaient de vastes étendues de terre.
Les tribus qui soumirent l’Empire romain s’emparèrent de la plus grande partie des terres publiques et d’une partie des terres appartenant aux gros propriétaires fonciers. Les forêts, les prairies et les pacages restèrent en jouissance commune, alors que la terre arable était divisée entre les exploitations. Les terres ainsi partagées devinrent par la suite la propriété privée des paysans. Ainsi se constitua une couche nombreuse de petits paysans indépendants.
Mais les paysans ne pouvaient garder longtemps leur indépendance. L’inégalité des fortunes entre les membres de la communauté rurale devait nécessairement s’accentuer du fait de l’existence de la propriété privée de la terre et des autres moyens de production. Il y eut, parmi la paysannerie, des familles pauvres et des familles aisées. À mesure que grandissait l’inégalité des fortunes, les membres enrichis de la communauté acquéraient sur celle-ci un pouvoir toujours croissant. La terre se concentrait entre les mains des familles riches, de l’aristocratie de la gens et des chefs militaires. Les paysans perdaient petit à petit leur liberté personnelle au profit des grands propriétaires fonciers.
La conquête de l’Empire romain hâta la décomposition du régime de la gens chez les tribus conquérantes. Pour maintenir et consolider leur pouvoir sur les paysans dépendants, les grands propriétaires fonciers devaient renforcer le pouvoir d’État. Les chefs militaires, s’appuyant sur l’aristocratie de la « gens » et les guerriers de leurs suites, concentrèrent le pouvoir en leurs mains et se transformèrent en rois, en monarques.
Sur les ruines de l’Empire romain se constituèrent un certain nombre d’États nouveaux ayant des rois à leur tête. Ces rois distribuaient généreusement à leurs proches, à titre viager, puis héréditaire, les terres qu’ils avaient conquises ; ceux-ci leur devaient en échange le service militaire. L’Église, appui important du pouvoir royal, reçut elle aussi de nombreuses terres. Le sol était cultivé par les paysans désormais tenus de s’acquitter de certaines obligations au bénéfice de leurs nouveaux maîtres. D’immenses propriétés foncières passèrent aux mains des guerriers et des serviteurs du roi, du haut clergé et des monastères. Les terres ainsi concédées étaient désignées sous le nom de fiefs (en bas latin : feodum). D’où le nom de féodalité donné au nouveau régime social.
En Europe, la transformation graduelle des terres des paysans en propriété féodale et l’asservissement des masses paysannes (féodalisation) se poursuivit pendant des siècles (des 5e et 6e siècles aux 9e et 10e siècles). Le service militaire ininterrompu, les pillages et les impôts ruinaient la paysannerie libre. Réduit à demander assistance au grand propriétaire foncier, le paysan devenait dépendant de ce dernier. Il était souvent contraint de se placer sous la « protection » du seigneur féodal ; un homme isolé, sans défense, n’aurait pu subsister en raison des guerres continuelles, des incursions de brigandage. La propriété de sa parcelle passait au seigneur et le paysan ne pouvait la cultiver qu’en échange de diverses redevances qu’il devait au seigneur. Parfois aussi, les représentants et les fonctionnaires du roi accaparaient, par la fraude et la violence, les terres des paysans libres, les obligeant à reconnaître leur pouvoir.
La féodalisation s’accomplit différemment dans les divers pays, mais elle aboutit partout aux mêmes résultats : les paysans autrefois libres devenaient personnellement dépendants des féodaux qui s’étaient emparés de leur terre. Cette dépendance était plus ou moins dure. Avec le temps, les différences qui avaient d’abord existé entre anciens esclaves, colons et paysans libres, finirent par s’effacer, et tous se fondirent dans la masse de la paysannerie serve. Peu à peu se constitua un état de choses caractérisé par l’adage du Moyen âge : « Pas de terre sans seigneur ». Les rois étaient les propriétaires suprêmes de la terre.
La féodalité a été un stade nécessaire dans l’histoire de la société. L’esclavage avait épuisé toutes ses possibilités. Un nouveau développement des forces productives n’était désormais possible que grâce au travail de la masse des paysans dépendants possédant leur propre exploitation, leurs instruments de production et ayant quelque intérêt au travail.
Pourtant l’histoire atteste qu’il n’est nullement obligatoire que chaque peuple parcoure successivement toutes les étapes de l’évolution sociale. Beaucoup de peuples se trouvent placés dans des conditions qui leur permettent d’éviter telle ou telle phase du développement et de passer d’emblée à un stade supérieur.
En Russie, l’esclavage patriarcal fît son apparition à l’époque de la désagrégation de la communauté. Mais ici le développement social s’engagea pour l’essentiel, non dans la voie de l’esclavage, mais dans celle de la féodalisation. Les tribus slaves, où régnait encore le régime gentilice, attaquèrent l’Empire romain esclavagiste à partir du 3e siècle de notre ère pour libérer les villes du littoral nord de la mer Noire et jouèrent un rôle important dans la chute de l’esclavage. Le passage de la communauté primitive à la féodalité s’effectua en Russie au moment où l’esclavage avait depuis longtemps disparu et où les rapports féodaux s’étaient consolidés dans les pays de l’Europe occidentale.
Chez les Slaves de l’Est, la communauté rurale portait le nom de « verv » ou de « mir ». Les prairies, les forêts, les étangs restaient indivis, alors que la terre arable devenait possession des différentes familles. À la tête de la communauté se trouvait un ancien. Le développement de la propriété privée de la terre entraîna peu à peu la décomposition de la communauté. Les anciens et les princes de la tribu s’emparèrent du sol. Les paysans (smerdy), d’abord membres libres de la communauté, tombèrent sous la dépendance des grands propriétaires fonciers, ou boyards.
L’Église devint le plus important des propriétaires féodaux de l’époque. Les dons des princes, les donations et les legs testamentaires la mirent en possession de vastes territoires et de très riches domaines.
Quand se constitua l’État russe centralisé (15e et 16e siècles) les grands princes et les tsars prirent l’habitude d’« installer » (en russe pomechtchat) comme on disait alors, sur des terres leurs proches et leurs serviteurs, autrement dit de leur concéder terres et paysans, à charge pour eux de les servir à la guerre. De là sont venus les noms de pomestié (fief) et de pomechtchik (seigneur féodal).
À l’époque, les paysans n’étaient pas encore définitivement attachés au propriétaire foncier et à la glèbe : ils avaient le droit de changer de seigneur. À la fin du 16e siècle, les grands propriétaires fonciers intensifièrent l’exploitation de la paysannerie afin de produire davantage de céréales pour la vente. Aussi, en 1581, l’État retira-t-il aux paysans le droit de changer de seigneur. Les paysans, désormais complètement attachés à la terre de leur propriétaire, furent ainsi transformés en serfs.
Sous la féodalité, l’économie rurale, et surtout la culture du sol, jouaient un rôle prépondérant. Des améliorations furent apportées au cours des siècles à la culture des céréales ; la culture maraîchère, le jardinage, l’industrie vinicole, la fabrication de l’huile se développèrent.
Durant la première phase de la féodalité prédominait un système de culture à jachère complète, ou à brûlis dans les régions boisées. On pratiquait la même culture sur une terre plusieurs années de suite jusqu’à ce que le sol fût épuisé. Après quoi on mettait en culture une autre terre. Ce système fut ensuite remplacé par l’assolement triennal : la terre arable était divisée en trois soles dont chacune était alternativement cultivée en céréale d’hiver, en céréale de printemps et laissée en friche. L’assolement triennal se répandit en Europe occidentale et en Russie à partir des 11e et 12e siècles. Il resta en usage pendant des centaines d’années, jusqu’au 19e siècle, et est encore appliqué aujourd’hui dans maints pays.
Au début de la féodalité, l’outillage agricole restait médiocre, les instruments de travail étaient l’araire à soc de fer, la faucille, la faux, la bêche. Puis on se mit à employer la charrue de fer et la herse. La mouture du grain s’effectua longtemps à la main, jusqu’au moment où se répandit l’usage des moulins à vent et à eau.
3.2. Les rapports de production de la société féodale. L’exploitation du paysan par le seigneur.
La base des rapports de production de la société féodale était la propriété du seigneur sur la terre et sa propriété limitée sur le serf. Ce dernier n’était pas un esclave. Il avait sa propre exploitation. Le seigneur ne pouvait plus le tuer, mais il pouvait le vendre. La propriété féodale coexistait avec la propriété individuelle du paysan et de l’artisan sur les instruments de production et sur leur exploitation privée ; cette propriété individuelle était fondée sur le travail personnel.
La grande propriété foncière féodale était à la base de l’exploitation du paysan par le seigneur. Le domaine proprement dit du féodal s’étendait sur une partie de sa terre. L’autre partie, le seigneur la donnait en jouissance aux paysans à des conditions qui les asservissaient. Le féodal « lotissait » le paysan et s’assurait ainsi une main-d’œuvre. En échange de la jouissance héréditaire de son lot, le paysan devait travailler pour le propriétaire, cultiver la terre de celui-ci avec ses propres instruments et son bétail, ou bien lui remettre son surproduit, en nature ou en argent.
Ce système d’économie supposait qu’un lien de dépendance personnelle attachait le paysan au propriétaire foncier, il supposait une contrainte extra-économique :
[…] si [le seigneur] n’avait plus exercé une autorité directe sur la personne du paysan, il lui aurait été impossible d’obliger à travailler pour lui un homme qui était pourvu d’un lot de terre et qui avait sa propre exploitation.
( V. Lénine, « Le développement du capitalisme en Russie », Œuvres, t. 3, p. 199. )Le temps de travail du serf se divisait en deux parties : le temps nécessaire et le temps supplémentaire. Pendant le temps nécessaire, le paysan créait le produit nécessaire à sa subsistance et à celle de sa famille. Pendant le temps supplémentaire, il créait le produit supplémentaire, le surproduit, que le seigneur s’appropriait. Le fruit du surtravail du paysan travaillant dans le domaine seigneurial, ou le surproduit créé par le paysan dans sa propre exploitation et que s’appropriait le seigneur, constituaient la rente foncière féodale.
Souvent la rente féodale absorbait non seulement le surproduit du paysan, mais encore une partie de son produit nécessaire. Cette rente avait sa base dans la propriété féodale de la terre, à laquelle se rattachait la domination directe du propriétaire féodal sur les paysans placés sous sa dépendance.
Il a existé sous la féodalité trois formes de rente foncière :
La rente-travail, la rente en nature et la rente en argent ; elles sont toutes trois la manifestation non déguisée de l’exploitation des paysans par leurs propriétaires.
La rente-travail ou corvée a prédominé aux premiers stades de la féodalité : le paysan travaillait une partie de la semaine — trois jours ou davantage — avec ses instruments de production (araire, bêtes de somme, etc.) dans le domaine du seigneur, et les autres jours de la semaine dans son exploitation. De la sorte, le travail nécessaire et le surtravail du paysan étaient nettement délimités dans le temps et dans l’espace. Les travaux à exécuter pendant la corvée étaient très nombreux : le paysan labourait, semait et rentrait la récolte, paissait le bétail, charpentait, coupait du bois, transportait a l’aide de son cheval des denrées agricoles et des matériaux de construction.
Le serf astreint à la corvée n’avait intérêt à accroître le rendement de son travail que sur son exploitation. Il en allait autrement sur la terre du seigneur. Aussi celui-ci avait-il des surveillants pour obliger les paysans à travailler.
Par la suite, la rente-travail lit place à la rente en nature, à la redevance en nature. Le paysan était tenu de livrer régulièrement au seigneur une certaine quantité de blé, de bétail, de volailles et d’autres produits agricoles ; le plus souvent la redevance s’ajoutait à certaines survivances de la corvée, c’est-à-dire à des travaux à exécuter par le paysan dans le domaine seigneurial.
La rente en nature permettait au paysan de disposer à son gré de son travail nécessaire comme de son surtravail. Le travail nécessaire et le surtravail ne se distinguaient plus de façon aussi tangible que dans la rente-travail. Le paysan acquérait une indépendance relative, ce qui l’encourageait jusqu’à un certain point à accroître la productivité de son travail.
À un stade ultérieur de la féodalité, quand l’échange eut pris une assez large extension, apparut la rente en argent sous la forme d’une redevance en argent. La rente en argent est caractéristique de la période où la féodalité se désagrège et où les rapports capitalistes font leur apparition.
Les différentes formes de la rente féodale ont souvent coexisté.
Dans toutes les formes étudiées, nous avons admis que celui qui payait la rente possédait et travaillait réellement la terre, et que son surtravail non rétribué revenait directement au propriétaire foncier. Dans la rente en argent, transformation de la rente en nature, c’est non seulement possible, c’est la réalité !
( K. Marx, Le Capital, livre 3, chap. 47, § 4. )Pour accroître leurs revenus, les seigneurs levaient une foule de taxes sur les paysans. Souvent, ils monopolisaient les moulins, les forges et autres entreprises auxquelles le paysan était obligé de recourir moyennant un paiement exorbitant en nature ou en argent. Outre la redevance en nature ou en argent qu’il versait au seigneur, le paysan devait acquitter une série d’impôts d’État, de taxes locales et, dans certains pays, payer la dîme, c’est-à-dire remettre à l’Église le dixième de sa récolte.
Le travail des serfs était donc à la base de l’existence de la société féodale. Les paysans non seulement produisaient les denrées agricoles, mais encore travaillaient dans les domaines seigneuriaux en qualité d’artisans, construisaient châteaux et monastères, faisaient les routes ; ce sont eux qui ont bâti les villes.
L’économie seigneuriale, surtout au début, était essentiellement une économie naturelle. Chaque domaine féodal, qui se composait de la résidence du seigneur et des villages lui appartenant, vivait en économie fermée et avait rarement recours aux échanges. Les besoins du seigneur, de sa famille et de sa nombreuse valetaille étaient couverts au début par les produits provenant du domaine seigneurial et par les redevances des paysans. Les domaines plus ou moins importants disposaient d’un nombre suffisant d’artisans, pour la plupart des serfs attachés à la demeure seigneuriale. Ces artisans confectionnaient des vêtements et des chaussures, fabriquaient et réparaient les armes, les engins de chasse et le matériel agricole, construisaient les bâtiments.
L’exploitation du paysan était elle aussi une économie naturelle. Les paysans se livraient non seulement aux travaux agricoles, mais aussi à des travaux d’artisanat, notamment au traitement des matières premières provenant de leur exploitation : ils filaient, tissaient, fabriquaient des chaussures et des outils pour leur exploitation.
La féodalité fut longtemps caractérisée par l’association de l’agriculture, principale branche d’activité, et du métier à domicile, qui ne jouait qu’un rôle auxiliaire. Les quelques produits importés dont on ne pouvait se passer, comme le sel, les articles en fer, étaient d’abord fournis par des marchands ambulants. Par la suite, avec le développement des villes et de la production artisanale, la division du travail et le développement des échanges entre la ville et la campagne réalisèrent d’importants progrès.
L’exploitation des paysans dépendants par les seigneurs constitue le principal trait de la féodalité chez tous les peuples. Mais dans certains pays le régime féodal a présenté des particularités. En Orient, les rapports féodaux se sont longtemps combinés avec l’esclavage, comme ce fut le cas en Chine, dans l’Inde, au Japon et dans quelques autres pays. La propriété d’État féodale sur la terre y a joué un rôle important. Ainsi, à l’époque du califat de Bagdad, sous la domination arabe (notamment aux 8e et 9e siècles de notre ère), une partie considérable des membres des communautés rurales vivait sur les terres du calife et payait la rente féodale directement à l’État. En Orient, la féodalité était également caractérisée par la survivance des rapports patriarcaux que les seigneurs mettaient à profit pour intensifier l’exploitation des paysans. Dans les pays d’Orient où l’agriculture irriguée joue un rôle déterminant, les paysans se trouvaient sous la coupe des féodaux du fait que non seulement la terre, mais aussi l’eau et les systèmes d’irrigation étaient la propriété de l’État féodal ou des seigneurs.
Chez les peuples nomades, la terre était utilisée comme pâturage. L’étendue des terres possédées par les féodaux était déterminée par l’importance de leurs troupeaux. Les grands seigneurs propriétaires de bétail étaient aussi en fait de grands propriétaires de pâturages. Ils asservissaient et exploitaient la paysannerie.
La loi économique fondamentale de la féodalité réside dans la production d’un surproduit pour la satisfaction des besoins des seigneurs féodaux en exploitant les paysans dépendants sur la base de la propriété du féodal sur la terre et de sa propriété limitée sur les producteurs les paysans serfs.
3.3. La ville médiévale. Les corporations. Les guildes des marchands.
Les villes sont apparues dès l’époque de l’esclavage : ainsi Rome, Florence, Venise, Gênes en Italie ; Constantinople, Alexandrie dans le Proche-Orient ; Paris, Lyon et Marseille en France ; Londres en Angleterre, Samarcande en Asie centrale et bien d’autres encore sont un héritage qu’a reçu le Moyen âge de l’époque de l’esclavage. Le régime fondé sur l’esclavage s’écroula, mais les villes restèrent. Les grands ateliers d’esclaves se morcelèrent, mais les métiers continuèrent d’exister.
Dans le haut Moyen âge, les villes et les métiers ne connurent qu’un faible développement. Les artisans des villes produisaient des articles pour la vente, mais c’est par leur travail personnel qu’ils tiraient la plupart des biens de consommation dont ils avaient besoin. Beaucoup possédaient une parcelle de terre, un jardin, du bétail. Les femmes filaient le lin et la laine pour les vêtements. Ce qui témoignait du caractère limité des marchés et de l’échange.
À la campagne, le traitement des matières premières agricoles ne fut d’abord pour le cultivateur qu’une activité auxiliaire. Puis des artisans, desservant leur village, commencèrent à se détacher de la masse paysanne. La productivité de leur travail s’accrut. On put fabriquer plus d’articles qu’il n’était nécessaire au seigneur ou aux paysans d’un seul village. Les artisans commencèrent à se grouper autour des châteaux forts et des monastères, dans les gros bourgs et autres centres commerciaux. C’est ainsi que petit à petit on vit apparaître de nouvelles cités, la plupart du temps sur des cours d’eau (comme ce fut en Russie le cas de Kiev, Pskov, Novgorod, Vladimir).
Avec le temps, les métiers devinrent de plus en plus lucratifs. L’habileté des artisans augmenta. Le seigneur féodal prit l’habitude d’acheter des articles artisanaux chez les citadins, ceux de ses propres serfs ayant cessé de le satisfaire. Le métier, en se développant, se détacha définitivement de l’agriculture.
Les villes, qui se trouvaient sur les terres des féodaux laïques et ecclésiastiques, relevaient de leur juridiction. Les citadins étaient tenus à certaines obligations envers le seigneur, ils lui versaient des redevances en nature ou en argent, ils étaient justiciables de son administration et de ses tribunaux. De bonne heure, la population des villes engagea la lutte pour s’affranchir de cette dépendance féodale. De force ou en se rachetant, les villes obtinrent le droit de s’administrer, d’avoir leurs tribunaux, de battre monnaie et de lever des impôts.
La population urbaine se composait surtout d’artisans et de marchands. Beaucoup de villes donnaient asile aux serfs fugitifs. La ville
représentait la production marchande, par opposition à la campagne, où dominait l’économie naturelle. La concurrence croissante des serfs fugitifs affluant dans les villes, la lutte contre l’exploitation et les exactions des seigneurs obligèrent les artisans à se grouper en corporations. Le régime corporatif a, sous la féodalité, existé dans presque tous les pays.Les corporations sont apparues à Byzance et en Italie aux 9e et 10e siècles et, par la suite, dans toute l’Europe occidentale et en Russie. En Orient (Égypte, Chine, califat arabe), les corporations sont nées plus tôt encore. Elles groupaient les artisans urbains exerçant la même profession ou des professions connexes. Seuls les maîtres de métier en étaient membres de plein droit. Le maître de métier avait sous ses ordres un petit nombre de compagnons et d’apprentis. La corporation protégeait jalousement le droit exclusif de ses membres d’exercer leur métier et réglementait strictement la production : elle fixait la durée de la journée de travail, le nombre des compagnons et des apprentis que chaque maître pouvait avoir, la qualité des matières premières et des articles finis, ainsi que les prix ; elle organisait souvent l’achat en commun des matières premières. Les procédés de travail, consacrés par une longue tradition, étaient obligatoires pour tous. Une réglementation sévère visait à empêcher qu’un maître de métier s’élevât au-dessus des autres. Les corporations étaient en outre des organisations de secours mutuel.
Les corporations étaient la forme féodale de l’organisation du métier. Elles jouèrent au début un rôle bienfaisant en contribuant à affermir et à développer les métiers dans les villes. Mais avec la croissance de la production marchande et l’extension du marché, elles devinrent de plus en plus un frein au progrès des forces productives.
La réglementation stricte du travail par les corporations paralysait l’initiative des artisans et entravait le développement de la technique. Pour limiter la concurrence les corporations firent dépendre l’acquisition de la maîtrise de conditions de plus en plus restrictives. Les apprentis et les compagnons, dont le nombre avait fortement augmenté, étaient pratiquement dans l’impossibilité d’accéder à la maîtrise. Ils étaient condamnés à rester toute leur vie des salariés. Aussi les rapports entre le maître et ses subordonnés perdirent-ils leur caractère plus ou moins patriarcal. Les maîtres intensifiaient l’exploitation de leurs subordonnés, les faisant travailler quatorze ou seize heures par jour pour un salaire misérable. Les compagnons commencèrent à se grouper, pour défendre leurs intérêts, en associations secrètes, ou compagnonnages, que les corporations et les autorités de la ville persécutaient violemment.
Les marchands formaient la partie la plus riche de la population urbaine. Le commerce se développait dans les villes, nées à l’époque de l’esclavage ou apparues sous la féodalité. Aux corporations dans l’artisanat correspondaient les guildes dans le commerce. Les guildes des marchands ont existé un peu partout à l’époque de la féodalité. On constate leur existence en Orient à partir du 9e siècle, en Europe occidentale à partir des 9e et 10e siècles, en Russie à partir du 12e siècle. Elles se proposaient surtout de lutter contre la concurrence des autres marchands, d’assurer l’unification des poids et mesures, de protéger les droits des marchands contre les entreprises des seigneurs.
Aux 9e et 10e siècles, il existait déjà un commerce important entre l’Orient et l’Europe occidentale, commerce auquel la Russie de Kiev prenait une part active. Les croisades (du 11e au 13e siècle) contribuèrent à son extension en ouvrant aux marchands d’Europe occidentale les marchés du Proche-Orient. L’or et l’argent d’Orient affluèrent en Europe. La monnaie fit son apparition là où on l’ignorait encore. Les villes italiennes, notamment Gênes et Venise, dont les navires assuraient le transport et le ravitaillement des croisés, participèrent directement à la conquête des marchés orientaux.
Les ports de la Méditerranée furent longtemps les principaux intermédiaires entre l’Europe occidentale et l’Orient. Mais le commerce se développa également dans les villes de l’Allemagne du Nord et des Pays-Bas situées sur les voies commerciales de la mer du Nord et de la Baltique. Au 14e siècle il s’y constitua une confédération commerciale, la Ligue hanséatique, qui groupa au cours des deux siècles qui suivirent près de 80 villes de différents pays d’Europe. La Ligue faisait le commerce avec l’Angleterre, la Scandinavie, la Pologne et la Russie. Les produits industriels d’Europe occidentale : draps de Flandre et d’Angleterre, toiles, articles métalliques d’Allemagne, vins de France, étaient échangés contre les fourrures, les peaux, le lard, le miel, le blé, le bois, la poix, les tissus de lin et autres articles artisanaux du nord-est de l’Europe. Les marchands rapportaient d’Orient les épices (poivre, clous de girofle, muscade), des parfums, des teintures, des cotonnades et des soieries, des tapis, et bien d’autres produits.
Aux 13e et 14e siècles les villes russes : Novgorod, Pskov et Moscou, étaient en relations très suivies avec l’Asie et l’Europe occidentale. Les marchands de Novgorod entretenaient des relations commerciales régulières avec les peuples du Nord (littoral de l’océan Glacial et pays au-delà de l’Oural), d’une part, avec la Scandinavie et l’Allemagne, d’autre part.
Le développement des villes et les progrès du commerce exercèrent une influence considérable sur la campagne féodale. L’économie seigneuriale était peu à peu entraînée dans la circulation marchande. Les seigneurs avaient besoin d’argent pour se procurer les objets de luxe et les articles de la ville. Aussi préféraient-ils remplacer la corvée et la redevance en nature par une redevance en argent. L’exploitation féodale se fit dès lors plus lourde. L’opposition entre la ville et la campagne, apparue avec l’esclavage, s’accentuait.
3.4. Les classes et les castes de la société féodale. La hiérarchie féodale.
La société féodale se composait de deux classes principales : les féodaux et les paysans. Elle
comportait une division en classes qui plaçait l’immense majorité, la paysannerie serve, sous la dépendance complète d’une infime minorité : les seigneurs féodaux possesseurs de la terre.( V. Lénine, « De l’État », Œuvres, t. 29, p. 486. )La classe féodale n’était pas homogène. Les petits féodaux payaient tribut aux grands, les aidaient dans la guerre, mais bénéficiaient en revanche de leur protection. Le protecteur s’appelait suzerain, le protégé vassal. Les suzerains étaient à leur tour les vassaux de seigneurs plus puissants. C’est ainsi que se forma la hiérarchie féodale.
Classe dominante, les propriétaires fonciers féodaux étaient à la tête de l’État. Ils formaient une couche sociale : la noblesse. Au sommet de l’échelle sociale, les nobles jouissaient de privilèges politiques et
économiques étendus.Le clergé (séculier et régulier) était, lui aussi, un gros propriétaire foncier. Il possédait de vastes territoires sur lesquels vivait une nombreuse population dépendante et serve, et formait, comme la noblesse, une couche sociale dominante.
La hiérarchie féodale reposait sur la large base que constituait la paysannerie. Les paysans devaient obéissance au seigneur et se trouvaient placés sous la juridiction suprême du premier féodal : le roi. La paysannerie était une couche sociale dépourvue de tout droit politique. Les seigneurs pouvaient vendre leurs serfs, et ils usaient largement de ce droit. Ils infligeaient aux paysans des châtiments corporels. Lénine a appelé le servage l’ « esclavage de l’homme attaché à la glèbe ». Le serf était presque aussi férocement exploité que l’Antiquité. Il pouvait toutefois travailler une partie de son temps sur son lopin de terre, il pouvait jusqu’à un certain point être son propre maître.
La contradiction de classe entre féodaux et paysans serfs domine l’histoire de la société féodale. La lutte de la paysannerie exploitée contre les seigneurs s’est poursuivie durant toute la féodalité ; elle devint particulièrement aiguë à la fin de cette époque, quand l’exploitation des serfs se fut aggravée à l’extrême.
Dans les villes qui s’étaient affranchies de la dépendance féodale, le pouvoir appartenait aux riches citadins : marchands, usuriers, propriétaires de terrains et d’immeubles. Les artisans des corporations, qui formaient la grande masse de la population des villes, étaient souvent en lutte contre l’aristocratie urbaine pour obtenir le droit de participer conjointement avec elle à l’administration de la cité. Les petits artisans et les compagnons luttaient contre l’exploitation que leur faisaient subir les maîtres de métier et les marchands.
À la fin de l’époque féodale, une différenciation déjà très poussée s’était opérée parmi la population des villes. Il y avait, d’un côté, les riches marchands et les maîtres de métier ; de l’autre, la masse des compagnons et des apprentis, des pauvres gens. Les couches inférieures de la population luttaient contre l’aristocratie urbaine et les seigneurs coalisés. Leur lutte rejoignait celle des paysans serfs contre l’exploitation féodale.
Le pouvoir suprême était censé appartenir aux rois (en Russie, aux grands princes, puis aux tsars). Mais hors de leurs domaines, le pouvoir des rois était infime au début de l’époque féodale, souvent même purement nominal. Toute l’Europe était divisée en une foule d’États grands et petits. Les grands feudataires étaient maîtres absolus sur leurs terres. Ils édictaient les lois, en assuraient l’exécution, rendaient la justice, possédaient une armée, se livraient à des incursions contre leurs voisins ; ils ne se faisaient pas faute non plus de piller sur les grands chemins. Beaucoup d’entre eux battaient monnaie. Les féodaux moins puissants jouissaient aussi de droits très étendus sur leurs sujets et cherchaient à s’aligner en tout sur les grands seigneurs.
Avec le temps, les rapports féodaux finirent par constituer un écheveau extrêmement embrouillé de droits et de devoirs. Les désaccords et les conflits étaient continuels entre seigneurs. Ils étaient d’ordinaire tranchés par la force, au cours de guerres intestines.
3.5. Le développement des forces productives de la société féodale.
Les forces productives atteignirent à l’époque féodale un niveau plus élevé qu’à l’époque de l’esclavage.
La technique agricole se perfectionna. L’emploi de la charrue en fer et d’autres instruments en fer se généralisa. De nouvelles cultures furent introduites, la viticulture, l’industrie vinicole, les cultures maraîchères connurent un essor remarquable. L’élevage progressa, surtout celui du cheval, en raison des besoins militaires des féodaux ; la fabrication du beurre se développa. Dans certaines régions, l’élevage du mouton prit une grande
extension. On agrandit et on améliora les prairies et les pâturages.Les outils des artisans et le traitement des matières premières se perfectionnèrent. Les anciens métiers commencèrent à se spécialiser. C’est ainsi que du métier du forgeron, qui produisait d’abord tous les articles de métal, se détachèrent l’armurerie, la clouterie, la coutellerie, la serrurerie ; de la peausserie, la cordonnerie et la bourrellerie. Aux 16e et 17e siècles, le rouet se répandit en Europe. Le métier à étirer fut inventé en 1600.
L’amélioration des procédés de la fonte et du traitement du fer joua un rôle décisif dans le perfectionnement des instruments de travail. Au début, on produisait le fer par des méthodes tout à fait primitives. Au 14e siècle, on commença à utiliser la roue hydraulique, pour actionner les soufflets de forge et les gros marteaux destinés à concasser le minerai. Un meilleur tirage dans les fours permit d’obtenir, au lieu d’une masse malléable, une masse en fusion : la fonte. Avec l’emploi de la poudre à des fins militaires et l’apparition de l’artillerie (14e siècle), il fallut de grosses quantités de métal pour fabriquer les boulets ; à partir du début du 15e siècle, on prit l’habitude de les couler en fonte. La confection des outils agricoles et d’autres instruments demandait aussi toujours plus de métal. Les premiers hauts fourneaux firent leur apparition dans la première moitié du 15e siècle. L’invention de la boussole contribua aux progrès de la navigation. L’invention et la diffusion de l’imprimerie eurent une importance considérable.
La Chine, où les forces productives et la civilisation connurent déjà du 6e au 11e siècle un développement remarquable, devança l’Europe sur bien des points. C’est aux Chinois que l’on doit l’invention de la boussole, de la poudre, du papier et de l’imprimerie sous sa forme la plus élémentaire.
Le développement des forces productives de la société se heurtait de plus en plus au cadre trop étroit des rapports de production féodaux. La paysannerie, courbée sous le joug de l’exploitation féodale, était incapable de produire davantage de denrées agricoles. Le rendement du travail du paysan asservi était extrêmement bas. Dans les villes, l’augmentation de la productivité du travail artisanal se heurtait aux statuts et aux règlements corporatifs. La lenteur des progrès de la production, la routine, l’empire de la tradition, caractérisaient le régime féodal.
Les forces productives qui s’étaient développées dans la société féodale réclamaient de nouveaux rapports de production.
3.6. La naissance de la production capitaliste au sein du régime féodal. Le rôle du capital marchand.
On assiste, à l’époque féodale, au développement graduel de la production marchande et à l’extension de l’artisanat urbain ; les produits de l’économie paysanne sont de plus en plus entraînés dans le mouvement des échanges.
La production des petits artisans et des paysans, fondée sur la propriété privée et le travail personnel, et créant des produits pour l’échange, est ce qu’on appelle la production marchande simple.
Le produit fabriqué en vue de l’échange est, nous l’avons déjà dit, une marchandise. Les différents producteurs de marchandises dépensent pour produire des marchandises identiques une quantité différente de travail, qui dépend des conditions dans lesquelles ils se trouvent placés. Ceux qui disposent d’instruments plus perfectionnés dépensent moins de travail que les autres pour produire une même marchandise. Les travailleurs diffèrent également par la force, l’adresse, l’habileté, etc. Mais peu importe au marché dans quelles conditions et à l’aide de quels instruments a été produite telle ou telle marchandise. On paye sur le marché la même somme d’argent pour des marchandises identiques, quelles que soient les conditions individuelles de travail dans lesquelles elles ont été fabriquées.
Aussi les producteurs de marchandises, chez qui les dépenses individuelles du travail sont supérieures à la moyenne du fait qu’ils se trouvent placés dans de plus mauvaises conditions, ne couvrent-ils qu’une partie de ces dépenses en vendant leurs marchandises et ils finissent par se ruiner. Par contre, ceux chez qui les dépenses individuelles de travail sont inférieures à la moyenne, grâce à de meilleures conditions, sont en excellente posture pour vendre, et s’enrichissent. D’où une aggravation de la concurrence. Une différenciation s’opère parmi les petits producteurs de marchandises : la majorité s’appauvrit de plus en plus, alors qu’une infime minorité s’enrichit.
Le morcellement politique fut, sous le régime féodal, un gros obstacle au développement de la production marchande. Les féodaux établissaient à leur guise des droits sur les marchandises amenées du dehors, percevaient des péages et créaient ainsi de graves obstacles au commerce. Les besoins de celui-ci, et plus généralement du développement économique de la société, exigeaient la suppression du morcellement féodal. Les progrès de la production artisanale et agricole, de la division sociale du travail entre la ville et la campagne eurent pour conséquence l’établissement de relations économiques plus actives entre les différentes régions d’un même pays, la formation d’un marché national. Celui-ci créa à son tour les conditions économiques d’une centralisation du pouvoir politique. La bourgeoisie naissante des villes avait intérêt à la destruction des barrières féodales ; aussi était-elle favorable à la constitution d’un État centralisé.
S’appuyant sur la couche plus large de la petite noblesse, sur les « vassaux de leurs vassaux », ainsi que sur les villes dont l’ascension se poursuit, les rois portent à l’aristocratie féodale des coups décisifs et affermissent leur domination. Ils deviennent les maîtres de l’État non plus seulement de nom, mais aussi en fait. De grands États nationaux se constituent sous forme de monarchies absolues. La fin du morcellement féodal et l’établissement d’un pouvoir politique centralisé contribuent à l’apparition et au développement de rapports capitalistes.
La formation d’un marché mondial joua également un rôle considérable dans l’avènement du régime capitaliste.
Dans la seconde moitié du 15e siècle, les Turcs s’emparèrent de Constantinople et de toute la partie orientale de la Méditerranée. La grande route commerciale était coupée, qui mettait l’Europe occidentale en communication avec l’Orient. Christophe Colomb découvrit en 1492 l’Amérique, alors qu’il cherchait la voie maritime des Indes, que Vasco de Gama trouva en 1498, après avoir fait le tour de l’Afrique.
À la suite de ces découvertes, la Méditerranée perdit sa primauté commerciale au profit de l’Atlantique, et la première place dans le Commerce échut aux Pays-Bas, à l’Angleterre et à la France. La Russie jouait elle aussi un rôle important dans le commerce européen.
Avec la naissance du commerce mondial et d’un marché mondial, l’artisanal n’était plus en mesure de satisfaire la demande accrue de marchandises. Cette circonstance hâta le passage de la petite production artisanale à la grande production capitaliste fondée sur l’exploitation d’ouvriers salariés.
Le passage du mode de production féodal au mode de production capitaliste s’accomplit de deux façons : d’une part, la différenciation des petits producteurs de marchandises fit apparaître des entrepreneurs capitalistes ; d’autre part, le capital commercial, en la personne des marchands, plaça directement la production sous sa dépendance.
Les corporations pouvaient limiter la concurrence et la différenciation parmi les artisans tant que la production marchande restait peu développée. Avec les progrès de l’échange, la concurrence se fit de plus en plus âpre. Les maîtres de métier travaillant pour un marché plus étendu cherchaient à obtenir l’abolition des restrictions corporatives, ou bien les tournaient purement et simplement. Ils allongeaient la journée de travail des compagnons et des apprentis, en augmentaient le nombre, appliquaient des méthodes de travail plus productives. Les plus riches d’entre eux devenaient peu à peu des capitalistes ; les plus pauvres, les compagnons et les apprentis, devenaient des ouvriers salariés.
En désagrégeant l’économie naturelle, le capital commercial contribua à l’avènement de la production capitaliste. Il ne fut d’abord qu’un intermédiaire dans l’échange des marchandises des petits producteurs — artisans et paysans — et lors de la réalisation par les féodaux d’une partie du surproduit que ceux-ci s’appropriaient. Puis le marchand se mit à acheter régulièrement aux petits producteurs les marchandises qu’ils fabriquaient, pour les revendre sur un marché plus large. Il devenait de la sorte un accapareur 1. Avec les progrès de la concurrence et l’apparition de l’accapareur, la situation de la masse des artisans se modifia sensiblement. Les maîtres de métier appauvris imploraient l’aide du marchand accapareur qui leur avançait de l’argent, des matières premières et des matériaux, à la condition qu’ils lui vendent le produit fini à un prix très bas, convenu d’avance. Les petits producteurs tombaient de la sorte sous la dépendance économique du capital commercial.
Peu à peu un grand nombre de maîtres de métier appauvris se trouvèrent dépendre d’un riche accapareur. Celui-ci leur distribuait des matières premières, par exemple des filés dont ils faisaient des tissus, contre le payement d’une certaine somme, et devenait ainsi un distributeur.
La ruine de l’artisan fit que l’accapareur dut lui fournir non seulement la matière première, mais encore les instruments de travail. De la sorte, l’artisan perdit son dernier semblant d’autonomie et devint définitivement un ouvrier salarié, tandis que l’accapareur se transformait en capitaliste industriel.
Groupés dans l’atelier du capitaliste, les artisans d’autrefois exécutaient un même travail. Mais il apparut bientôt que certaines opérations réussissaient mieux aux uns, et d’autres opérations aux autres. Il était donc plus avantageux de confier à chacun la partie du travail où il était le plus habile. C’est ainsi que la division du travail s’introduisit peu à peu dans les ateliers employant une main-d’œuvre plus ou moins nombreuse. Les entreprises capitalistes où des ouvriers salariés accomplissent un travail manuel sur la base de la division du travail, sont appelées manufactures 2.
Les premières sont apparues dès les 14e et 15e siècles à Florence et dans certaines républiques italiennes du Moyen âge. Du 16e au 18e siècle, les manufactures produisant du drap, des tissus de lin et de soie, de l’horlogerie, des armes, de la verrerie, se multiplièrent dans tous les pays d’Europe.
Elles firent leur apparition en Russie au 17e siècle. Au début du 18e siècle, sous Pierre Ier, elles connurent un essor rapide, notamment les manufactures d’armes, de drap, de soieries. Des usines sidérurgiques, des mines, des sauneries furent créées dans l’Oural.
À la différence des manufactures d’Europe occidentale, reposant sur le travail salarié, les entreprises russes des 17e et 18e siècles, tout en recourant à des travailleurs libres salariés, employaient surtout des paysans et des ouvriers serfs. À partir de la fin du 18e siècle, les manufactures fondées sur le travail libre salarié reçurent une large extension. Ce processus s’intensifia au cours des dernières décennies qui précédèrent l’abolition du servage.
La désagrégation des rapports féodaux se poursuivait également à la campagne. À mesure que se développait la production marchande, le pouvoir de l’argent augmentait. Les seigneurs remplaçaient les obligations en nature des paysans par des obligations en argent. Les paysans durent vendre les produits de leur travail et remettre aux féodaux l’argent qu’ils en avaient retiré. D’où, chez les paysans, un perpétuel besoin d’argent. Les accapareurs et les usuriers mettaient à profit cette situation pour les asservir. L’oppression féodale devenait plus lourde, la situation des serfs s’aggravait.
Le développement des relations monétaires donna une forte impulsion à la différenciation de la paysannerie, autrement dit à sa division en différents groupes sociaux. L’immense majorité de la paysannerie était dans la misère, s’épuisait au travail et se ruinait. Parallèlement apparurent des paysans riches qui exploitaient leurs voisins par des prêts léonins, en achetant à vil prix leurs produits agricoles, leur cheptel, leurs instruments de travail.
C’est ainsi que la production capitaliste naquît au sein du régime féodal.
Notes1. Le mot est pris ici dans son sens propre, sans la nuance péjorative qu’il a prise aujourd’hui (N.T.)2. « Manufacture » signifie littéralement travail fait à la main.3.7. L’accumulation primitive du capital. L’expropriation violente des paysans. L’accumulation des richesses.
La production capitaliste suppose réalisées deux conditions principales : 1o l’existence d’une masse de non-possédants personnellement libres mais dépourvus de moyens de production et d’existence, obligés par suite de se louer aux capitalistes et de travailler pour eux ; et 2o l’accumulation des richesses monétaires indispensables pour créer de grandes entreprises capitalistes.
Nous avons vu que le capitalisme a pour milieu nourricier la petite production marchande fondée sur la propriété privée, où la concurrence enrichit quelques-uns et ruine la plupart des autres. Mais la lenteur de ce processus ne correspondait pas aux besoins du nouveau marché mondial créé par les grandes découvertes de la fin du 15e siècle. L’avènement du mode de production capitaliste fut accéléré par l’emploi des méthodes de contrainte les plus brutales de la part des grands propriétaires fonciers, de la bourgeoisie et du pouvoir d’État qui se trouvait aux mains des classes exploiteuses. La violence, selon l’expression de Marx, a été l’accoucheuse qui a hâté la venue au monde du nouveau mode de production capitaliste.
Les savants bourgeois dépeignent sous des couleurs idylliques la naissance de la classe capitaliste et de la classe ouvrière. Dans des temps immémoriaux, assurent-ils, une poignée d’hommes laborieux et économes accumulèrent des richesses par leur travail, alors qu’une foule de paresseux et d’oisifs gaspillaient tout leur avoir et devenaient des prolétaires.
Ces fables imaginées par les défenseurs du capitalisme n’ont rien de commun avec la réalité. En fait, la formation d’une masse de non-possédants — les prolétaires — et l’accumulation de richesses aux mains de quelques-uns résultèrent du fait que les petits producteurs furent privés par la violence de leurs moyens de production. Le processus de séparation des producteurs de leurs moyens de production (terre, instruments de production, etc.) s’accompagna de spoliations et de cruautés sans nombre. Il a reçu le nom d’accumulation primitive du capital, car il a précédé l’apparition de la grande production capitaliste.
C’est d’abord en Angleterre que la production capitaliste prit un développement considérable. À la fin du 15e siècle, un douloureux processus d’expropriation violente de la paysannerie s’amorça dans ce pays. L’impulsion directe fut donnée par la demande accrue de laine de la part des grandes manufactures de drap apparues d’abord en Flandre, puis en Angleterre même. Les seigneurs se mirent à élever de grands troupeaux de moutons. Ils avaient besoin pour cela de pâturages. Ils chassaient en masse les paysans de leurs demeures, s’emparaient de la terre dont ceux-ci avaient toujours eu la jouissance, et transformaient les champs cultivés en pâturages.
L’expropriation des paysans s’accomplit de différentes façons, mais principalement par une mainmise éhontée sur les terres communales. Les seigneurs entouraient ces terres de clôtures, démolissaient les maisons des paysans, expulsaient ces derniers. Si ceux-ci tentaient de recouvrer la terre dont ils avaient été illégalement dépossédés, la force armée de l’État volait au secours du seigneur. Une série de lois sur les « enclosures » consacrèrent au 18e siècle cette spoliation du paysan.
La foule des paysans ruinés et dépouillés encombrait les villes, les bourgs et les routes d’Angleterre. Privés de moyens d’existence, ils étaient réduits à la mendicité. Les autorités édictèrent contre les expropriés des lois sanguinaires, d’une cruauté exceptionnelle. Ainsi, sous le règne d’Henri VIII (16e siècle), 72 000 personnes furent exécutées pour « vagabondage ». Au 18e siècle, la peine de mort fut remplacée pour les « vagabonds » et les sans-logis par l’incarcération dans des « maisons de travail », qui méritèrent le nom de « maisons d’horreur ». La bourgeoisie entendait ainsi plier la population rurale, chassée de ses terres et réduite au vagabondage, à la discipline du travail salarié.
Dans la Russie des tsars, engagée après les autres pays d’Europe dans la voie du développement capitaliste, la séparation du producteur de ses moyens de production fut réalisée par les mêmes méthodes qu’ailleurs. En 1861, le gouvernement tsariste, sous la pression des soulèvements paysans, se vit contraint d’abolir le servage.
Cette réforme constitua une gigantesque spoliation de la paysannerie. Les grands propriétaires fonciers s’emparèrent des deux tiers du sol. Ils se réservèrent des enclaves (« otrezki »), sur les terres les mieux situées, et parfois aussi les pacages, les abreuvoirs, les chemins conduisant aux champs, etc., dont les paysans avaient auparavant la jouissance. Les enclaves devinrent pour les propriétaires fonciers un moyen d’asservir les paysans, obligés de prendre des terres à bail aux plus dures conditions. La loi établissant la liberté personnelle du paysan maintint provisoirement la corvée et la redevance. En échange du lot tronqué qu’il avait reçu, le paysan devait satisfaire à ces obligations au bénéfice du propriétaire foncier tant que la terre n’aurait pas été rachetée. Le montant des droits de rachat avait été calculé sur la base de prix de la terre fortement majorés, et il s’éleva à environ deux milliards de roubles.
Caractérisant la réforme paysanne de 1861, Lénine écrivait :
C’est une première violence massive contre la paysannerie au profit du capitalisme naissant dans l’agriculture. C’est un « nettoyage des terres », entrepris par les propriétaires fonciers au profit du capitalisme.
( V. Lénine, « Le Programme agraire de la social-démocratie dans la première révolution russe de 1905-1907 », Œuvres, t. 13, p. 291. )L’expropriation des paysans eut un double résultat. D’une part, la terre devint la propriété privée d’un nombre relativement restreint de grands propriétaires fonciers. La propriété féodale de la terre, la propriété d’une couche sociale, se transforma en propriété bourgeoise. D’autre part, l’industrie bénéficia d’un afflux considérable d’ouvriers libres, prêts à se louer aux capitalistes.
Pour que la production capitaliste pût apparaître, il fallait non seulement une main-d’œuvre à bon marché, mais encore une accumulation de richesses considérables entre les mains de quelques-uns sous forme de sommes d’argent pouvant être transformées en moyens de production et servir à embaucher des ouvriers.
Au Moyen âge, marchands et usuriers avaient édifié de grandes fortunes qui permirent par la suite de créer de nombreuses entreprises capitalistes.
La conquête de l’Amérique, qui s’accompagna du pillage massif et de l’extermination de la population indigène, procura aux conquérants des richesses incalculables qu’accrut plus rapidement encore l’exploitation des mines de métaux précieux d’une richesse extraordinaire. Pour faire valoir ces mines, il fallait de la main-d’œuvre. Les Indiens périssaient en masse par suite des conditions inhumaines dans lesquelles ils travaillaient. Les marchands européens organisèrent en Afrique la chasse aux nègres comme s’il s’était agi de bêtes sauvages. Le commerce des nègres d’Afrique réduits en esclavage était des plus lucratifs. Les négriers réalisaient des profits fabuleux. Le travail servile des nègres reçut une grande extension dans les plantations de coton américaines.
Le commerce colonial fut, lui aussi, à l’origine de grosses fortunes. Les marchands de Hollande, d’Angleterre et de France fondèrent les compagnies des Indes orientales pour faire le commerce avec l’Inde. Ces compagnies bénéficiaient de l’appui de leurs gouvernements. Elles monopolisaient le commerce des produits coloniaux et avaient reçu le droit d’exploiter sans aucune restriction les colonies en usant des pires méthodes de violence. Leurs bénéfices annuels dépassaient de plusieurs fois le capital engagé. En Russie, le commerce avec la Sibérie qui mettait en coupe réglée les populations et la ferme de l’eau-de-vie, par laquelle l’État accordait à des traitants le droit exclusif de produire et de vendre des spiritueux contre le payement d’une certaine somme, procuraient de gros profits aux marchands.
Le capital commercial et le capital usuraire concentrèrent de la sorte de prodigieuses richesses monétaires. C’est ainsi que par le pillage et la ruine de la masse des petits producteurs s’accumulèrent les ressources monétaires indispensables à la création de grandes entreprises capitalistes. Analysant ce processus, Marx a écrit que le capital arrive au monde « suant le sang et la boue par tous les pores ». (K. Marx, Le Capital, livre 1, t. 3, p. 202.)
3.8. Les révoltes des serfs. Les révolutions bourgeoises. La chute du régime féodal.
La lutte de la paysannerie contre les seigneurs féodaux s’est poursuivie durant toute l’époque féodale, mais c’est à la fin de celle-ci qu’elle a atteint sa plus grande acuité.
Au 14e siècle, la France fut le théâtre d’une guerre des paysans connue dans l’histoire sous le nom de Jacquerie. La bourgeoisie naissante des villes, qui avait d’abord appuyé le mouvement, s’en détourna au moment décisif.
À la fin du 14e siècle, une
révolte paysanne éclata dans une grande partie de l’Angleterre. Les paysans armés, ayant à leur tête Wat Tyler, se répandirent à travers le pays, détruisant les demeures seigneuriales et les monastères, et s’emparèrent de Londres. Les seigneurs étouffèrent le soulèvement par la violence et la ruse. Tyler fut tué par trahison. Confiants dans les promesses du roi et des seigneurs, les révoltés rentrèrent chez eux, après quoi des expéditions punitives passèrent dans le» villages ; la répression fut féroce.Au début du 16e siècle, une guerre des paysans soutenus par les petites gens des villes et conduits par Thomas Münzer se déroula en Allemagne. Les paysans réclamaient la cessation de l’arbitraire et des violences des nobles.
En Russie, citons les grandes guerres paysannes dirigées par Stépan Razine au 17e siècle et Emélian Pougatchev au 18e. Les révoltés demandaient l’abolition du servage, la remise aux paysans des terres de la noblesse et de l’État, la fin de la domination féodale. L’aggravation de la crise du système féodal d’économie entre 1850 et 1860 se traduisit par une puissante vague d’insurrections paysannes à la veille de la réforme de 1861.
Des guerres et des révoltes paysannes d’une ampleur exceptionnelle se sont déroulées en Chine pendant des siècles. L’insurrection des Taïpings, sous la dynastie des Tsing (milieu du 19e siècle), mit en mouvement des millions de paysans. Les révoltés occupèrent Nankin, ancienne capitale de la Chine. La loi agraire des Taïpings proclamait l’égalité dans le droit, la jouissance de la terre et des autres biens. Leur organisation politique combinait de façon originale la monarchie avec la démocratie paysanne, trait que l’on retrouve aussi dans les mouvements paysans d’autres pays.
Les révoltes paysannes ont une importance révolutionnaire, car elles ont ébranlé les bases mêmes de la féodalité et conduit en définitive à l’abolition du servage.
Le passage du régime féodal au capitalisme en Europe occidentale s’est accompli grâce aux révolutions bourgeoises. La bourgeoisie montante profita de la lutte des paysans contre les seigneurs pour hâter la chute du régime féodal, remplacer l’exploitation féodale par l’exploitation capitaliste, et s’emparer du pouvoir. Lors des révolutions bourgeoises, les paysans fournirent le gros des forces qui renversèrent le régime féodal. Il en fut ainsi au cours de la première révolution bourgeoise dans les Pays-Bas, au 16e siècle, pendant la révolution anglaise du 17e siècle, pendant la révolution bourgeoise en France à la fin du 18e siècle.
La bourgeoisie s’appropria les fruits de la lutte révolutionnaire de la paysannerie et se hissa au pouvoir sur les épaules de celle-ci. La force des paysans résidait dans leur haine des oppresseurs. Mais leurs révoltes étaient spontanées. La paysannerie, en tant que classe de petits propriétaires privés, était morcelée ; elle ne pouvait formuler un programme clair ni mettre sur pied une organisation solide et cohérente pour mener la lutte. Pour triompher, les révoltes paysannes doivent se combiner avec le mouvement ouvrier et être dirigées par les ouvriers. Mais lors des révolutions bourgeoises des 17e et 18e siècles la classe ouvrière était encore faible, peu nombreuse et inorganisée.
C’est au sein même de la société féodale qu’avaient mûri les formes plus ou moins achevées du régime capitaliste ; une nouvelle classe exploiteuse, celle des capitalistes, avait grandi en même temps qu’étaient apparues des masses d’hommes dépourvus de moyens de production : les prolétaires.
À l’époque des révolutions bourgeoises, la bourgeoisie a utilisé contre la féodalité la loi économique de correspondance nécessaire entre les rapports de production et le caractère des forces productives ; elle a renversé les rapports de production féodaux, créé des rapports de production nouveaux, des rapports bourgeois, et fait concorder les rapports de production avec le caractère des forces productives développées au sein du régime féodal.
Les révolutions bourgeoises mirent fin au régime féodal et instaurèrent la domination du capitalisme.
Les conceptions économiques de l’époque féodale.
Les conceptions économiques de l’époque féodale reflètent les rapports sociaux qui règnent alors. Toute la vie intellectuelle se trouve sous le contrôle du clergé et revêt de préférence pour cette raison une forme religieuse et scolastique. Aussi les considérations sur la vie économique forment-elles des chapitres particuliers des traités de théologie.
En Chine, les conceptions économiques furent pendant des siècles Influencées par la doctrine de Confucius. Idéologie religieuse, le confucianisme naquit au 5e siècle avant notre ère. Il exige le maintien strict de la hiérarchie féodale des castes dans l’ordre politique aussi bien que dans la famille. « Les ignorants, dit Confucius, doivent obéir aux nobles et aux sages. L’insubordination des petites gens à l’autorité supérieure est principe de désordre. » Cependant Confucius demandait aux hommes « bien nés » de faire preuve d’ « humanité » et de ne pas être trop durs envers les pauvres. Confucius prônait la nécessité de l’union de la Chine, alors morcelée, sous le pouvoir d’un monarque. Confucius et ses disciples idéalisent les formes d’économie arriérées. Ils exaltent « l’âge d’or » que représente pour eux le passé patriarcal. La paysannerie, écrasée par l’aristocratie féodale et les marchands, mettait dans le confucianisme ses espérances d’une amélioration de sa situation, bien que cette doctrine n’exprimât pas les intérêts de classe de la paysannerie. Au cours de son évolution, le confucianisme devint l’idéologie officielle de l’aristocratie féodale. Il fut exploité par les classes dirigeantes pour élever le peuple dans l’esprit d’une soumission servile aux seigneurs féodaux, pour perpétuer le régime féodal.
Saint Thomas d’Aquin (13e
siècle), un des idéologues du féodalisme de l’Europe médiévale, a tenté de justifier par la théologie la nécessité de la société féodale. Tout en proclamant que la propriété féodale est nécessaire et raisonnable, et en déclarant que les serfs sont des esclaves, il affirme, contrairement aux esclavagistes de l’antiquité, que « l’esclave est libre en esprit » et que par conséquent son maître n’a pas le droit de le tuer. Il ne considère plus le travail comme indigne d’un homme libre. Le travail manuel est à ses yeux une activité d’ordre inférieur, et le travail intellectuel une occupation noble ; il voit dans cette distinction la base de la division de la société en différents ordres. Ses idées sur la richesse s’inspirent du même point de vue de caste. L’homme doit disposer de la richesse à laquelle lui donne droit la situation qu’il occupe dans la hiérarchie féodale. Très caractéristique à cet égard est la théorie des théologiens du Moyen Âge sur le « juste » prix. Le « juste » prix doit correspondre à la quantité de travail dépensée pour produire un objet et à la situation sociale du producteur.Les défenseurs du « juste » prix ne protestaient nullement contre le profit du marchand. Ce qu’ils voulaient, c’était lui fixer des bornes pour qu’il ne compromît pas l’existence économique des autres ordres. Ils condamnaient l’usure comme déshonorante et immorale. Mais avec le développement de la production marchande et de l’échange, le clergé lui-même se livra à l’usure pour laquelle l’Église se montra de plus en plus indulgente.
La lutte de classe des masses opprimées contre les classes dominantes de la société féodale prit pendant des siècles une forme religieuse. Les paysans et les compagnons exploités citaient souvent la Bible à l’appui de leurs revendications. D’innombrables sectes prirent une grande extension. L’Église catholique et l’Inquisition persécutaient férocement les « hérétiques », les envoyaient au bûcher.
Avec le développement de la lutte de classe, le mouvement des masses opprimées se dégagea de plus en plus de son enveloppe religieuse, et son caractère révolutionnaire s’affirma avec une netteté croissante. Les paysans réclamaient l’abolition du servage et des privilèges féodaux, l’égalité des droits, la suppression des ordres, etc.
Au cours des guerres paysannes en Angleterre, en Bohême et en Allemagne, les mots d’ordre des révoltés prirent un caractère toujours plus radical. L’aspiration à l’égalité des masses exploitées de la campagne et de la ville se traduisit par la revendication de la communauté des biens, c’est-à-dire de l’égalité en matière de consommation. Revendication impossible à réaliser, mais qui avait à l’époque une portée révolutionnaire, car elle soulevait les masses pour la lutte contre l’oppression féodale.
C’est au déclin de l’époque féodale qu’apparurent les deux premiers grands socialistes utopistes : l’Anglais Thomas More, auteur de l’Utopie (16e siècle), et l’Italien Tommaso Campanella qui écrivit La Cité du soleil (17e siècle). Constatant dans la société de leur temps une inégalité et des contradictions croissantes, ces penseurs ont exposé sous une forme originale leurs idées sur la cause des maux dont elle souffre ; ils ont donné la description d’un régime qu’ils considèrent comme idéal et où ces maux auront été supprimés.
Le régime social qu’ils préconisent ignore la propriété privée et les vices qu’elle entraîne. Chacun est à la fois artisan et agriculteur. La journée de travail est de six, voire de quatre heures par jour, ce qui suffit parfaitement à couvrir tous les besoins. Les produits sont répartis selon les besoins. L’éducation des enfants est confiée à la société.
Les ouvrages de More et de Campanella jouèrent un rôle progressiste dans l’histoire de la pensée sociale. Ils renfermaient des idées très en avance sur leur temps. Mais faute de tenir compte des lois du développement social, ces idées étaient irréalisables, utopiques. On ne pouvait alors supprimer l’inégalité sociale: le niveau des forces productives exigeait que l’exploitation féodale fît place à l’exploitation capitaliste.
L’apparition du capitalisme remonte au 16e siècle. C’est aussi à cette époque que furent faites les premières tentatives pour interpréter et pour expliquer certains phénomènes propres au capitalisme. Ainsi prit naissance et se développa, du 16e au 18e siècle, le courant de la pensée et de la politique économiques, qui a reçu le nom de mercantilisme.
Né en Angleterre, le mercantilisme se répandit ensuite en France, en Italie et dans les autres pays. Il posait le problème de la richesse nationale, de ses formes et des moyens de l’accroître.
C’était à l’époque où le capital, sous sa forme commerciale et usuraire, dominait le commerce et le crédit. Il ne faisait encore que ses premiers pas dans la production où il fondait des manufactures. Après la découverte et la conquête de l’Amérique les métaux précieux affluèrent en Europe. Les guerres et le commerce opéraient une redistribution permanente de l’or et de l’argent entre les États européens.
Dans leur conception de la nature de la richesse, les mercantilistes partaient de l’analyse des phénomènes superficiels de la circulation. Leur attention se portait non sur la production, mais sur le commerce et la circulation monétaire, en particulier sur les mouvements de l’or et de l’argent.
Pour les mercantilistes, la seule richesse véritable est constituée non par la production sociale, mais par la monnaie : l’or et l’argent. Ils demandent que l’État intervienne énergiquement dans la vie économique pour faire en sorte que la monnaie afflue le plus possible dans le pays et s’en aille le moins possible à l’étranger. Les mercantilistes pensèrent d’abord y parvenir en interdisant par de simples mesures administratives la sortie de la monnaie. Ils estimèrent par la suite qu’il était nécessaire pour cela de développer le commerce extérieur. Ainsi, l’Anglais Thomas Mun (1571-1641), gros marchand et directeur de la Compagnie des Indes orientales, écrivait : « Le moyen ordinaire d’augmenter notre richesse et nos trésors est le commerce avec l’étranger où nous devons toujours avoir pour règle de vendre chaque année aux étrangers nos marchandises pour une somme supérieure à celle que nous dépensons pour nous procurer les leurs ».
Les mercantilistes exprimaient les intérêts de la bourgeoisie, qui naissait au sein du régime féodal, et qui était impatiente d’accumuler des richesses sous forme d’or et d’argent en développant le commerce extérieur, en pillant les colonies et en engageant des guerres commerciales, en asservissant les peuples moins évolués. Avec le progrès du capitalisme, ils exigèrent que l’État protégeât le développement des entreprises industrielles, des manufactures. Des primes à l’exportation furent accordées aux marchands qui vendaient des marchandises à l’étranger. Les droits d’entrée acquirent bientôt une importance plus grande encore. À mesure que se développaient les manufactures, puis les fabriques, l’imposition de droits de douane sur les produits importés devint la mesure la plus fréquemment appliquée pour protéger l’industrie nationale contre la concurrence étrangère.
C’est ce qu’on appelle le protectionnisme, politique qui a subsisté dans de nombreux pays bien après l’abandon des théories mercantilistes.
En Angleterre, les tarifs protecteurs jouèrent un rôle important aux 16e et 17e siècles, alors qu’il s’agissait d’écarter la concurrence des manufactures plus développées des Pays-Bas. À partir du 18e siècle, l’Angleterre t’assura de façon durable la primauté industrielle. Les autres pays, moins évolués, ne pouvaient rivaliser avec elle. Aussi l’idée du libre-échange commença-t-elle à se faire jour en Angleterre.
Il en allait autrement dans les pays qui s’étaient engagés dans la voie du capitalisme après l’Angleterre. En France, le ministre de Louis XIV, Colbert, encouragea les manufactures par tout un ensemble de mesures protectionnistes : droits de douane élevés, interdiction d’exporter les matières premières, implantation d’industries nouvelles et création de compagnies pour le commerce extérieur, etc.
Le mercantilisme joua à l’époque un rôle progressiste. La politique protectionniste qu’il inspira contribua dans une mesure appréciable à l’extension des manufactures. Mais la théorie mercantiliste de la richesse traduisait le faible développement de la production capitaliste. Les progrès du capitalisme firent de mieux en mieux apparaître la faiblesse de cette théorie.
En Russie, le système féodal prédomina aux 17e et 18e siècles. L’économie était essentiellement une économie naturelle. Néanmoins le commerce et l’artisanat prirent un développement considérable, un marché national se constitua, des manufactures furent fondées ; ces transformations contribuèrent à renforcer l’absolutisme.
Les économistes russes développèrent certaines idées propres au mercantilisme en tenant compte des particularités historiques et économiques du pays. Toutefois, à la différence de nombreux mercantilistes d’Europe occidentale, ils attachaient une grande importance non seulement au commerce, mais aussi au développement de l’industrie et de l’agriculture.
Les conceptions économiques de cette époque ont inspiré les ouvrages et les actes de A. L. Ordyne-Nachtchokine, homme d’État russe du 17e siècle, la politique économique de Pierre le Grand, les œuvres de I. T. Possochkov, le plus éminent des économistes russes du début du 18e siècle.
Dans son livre De la pauvreté et de la richesse (1724), I. T. Possochkov expose un vaste programme de développement économique de la Russie qu’il justifie dans le détail. Il y montre la nécessité d’appliquer un certain nombre de mesures pour protéger l’industrie nationale, le commerce et l’agriculture, améliorer le système financier.
À partir du dernier tiers du 18e siècle, une tendance à la désagrégation des rapports fondés sur la féodalité et le servage se dessina en Russie ; elle s’accentua au cours du premier quart du 19e siècle et aboutit à une véritable crise du servage.
A. N. Radichtchev (1749-1802), qui est à l’origine du courant démocratique et révolutionnaire dans la pensée sociale russe, fut un économiste éminent. S’élevant vigoureusement contre le servage et prenant la défense de la paysannerie opprimée, il soumit le régime féodal à une critique impitoyable, dénonça l’exploitation à laquelle les seigneurs féodaux, les propriétaires des manufactures et les marchands devaient leur richesse, et proclama que la terre doit appartenir à ceux qui la travaillent. Il était convaincu qu’une révolution pouvait seule mettre un terme à l’absolutisme et au servage. Il proposa l’application d’un ensemble de mesures économiques progressistes pour l’époque dont la réalisation aurait permis rétablissement en Russie d’un régime bourgeois démocratique.
Les décembristes (premier quart du 19e siècle) furent des révolutionnaires d’une époque où commençait à se faire sentir en Russie la nécessité de remplacer le régime féodal par le capitalisme. Leur critique était avant tout dirigée contre le servage. Ardents champions du développement des forces productives en Russie, ils voyaient dans l’abolition du servage et l’affranchissement de la paysannerie la condition essentielle de ce développement. Non contents de prêcher la lutte contre le servage et l’autocratie, ils organisèrent une insurrection contre la monarchie absolue. On doit à P. I. Pestel (1793-1826) un projet original de règlement de la question agraire. Son projet de constitution, la Rousskaïa Pravda, prévoyait l’affranchissement immédiat et complet des paysans, ainsi que des mesures d’ordre économique pour protéger leurs intérêts à l’avenir. Il préconisait dans ce but la constitution d’un fonds social des terres, grâce auquel chaque paysan pourrait recevoir en jouissance gratuite la terre dont il avait besoin pour sa subsistance. Ce fonds devait se composer de terres de la noblesse et de l’État, une partie de celles qui appartenaient aux seigneurs les plus riches étant aliénée sans indemnité. Révolutionnaires issus de la noblesse, les décembristes étaient loin du peuple, mais leur lutte contre le servage fit progresser le mouvement révolutionnaire en Russie.
C’est avec la désagrégation du régime féodal et la naissance du capitalisme que s’élabora l’idéologie de la bourgeoisie marchant à la conquête du pouvoir. Cette idéologie était dirigée contre le régime féodal et contre la religion, arme spirituelle de la féodalité. Aussi la conception du monde de la bourgeoisie en lutte pour le pouvoir revêt-elle dans une série de pays un caractère progressiste. Ses représentants les plus en vue, économistes et philosophes, soumirent à une critique impitoyable tous les fondements — économiques, politiques, religieux, philosophiques et moraux — de la société féodale. Ils jouèrent un rôle important dans la préparation idéologique de la révolution bourgeoise et exercèrent une influence féconde sur les sciences et les arts.
Résumé du chapitre 3
-
La féodalité est née de la décadence de la société esclavagiste et de la désagrégation de la communauté rurale dans les tribus qui avaient conquis les États esclavagistes. Dans les pays qui n’ont pas connu l’esclavage, la féodalité est née de la désagrégation de la communauté primitive. L’aristocratie des gentes et les chefs militaires des tribus s’emparèrent d’une grande partie des terres qu’ils distribuèrent à leurs proches. Les paysans furent peu à peu asservis.
-
La base des rapports de production de la société féodale était la propriété du seigneur sur la terre et sa propriété limitée sur le producteur : le paysan serf. La propriété féodale coexistait avec la propriété individuelle du paysan et de l’artisan fondée sur le travail personnel. La société féodale reposait sur le travail des serfs. L’exploitation féodale se traduisait par la corvée à laquelle les paysans étaient astreints au profit du seigneur, ou par le paiement à celui-ci d’une redevance en nature et en argent. Le servage était souvent pour le paysan presque aussi dur que l’esclavage. Mais le régime féodal offrait certaines possibilités de développement aux forces productives, puisque le paysan pouvait consacrer une partie de son temps à cultiver sa terre et avait quelque intérêt à son travail.
-
La loi économique fondamentale de la féodalité réside dans la production d’un surproduit pour la satisfaction des besoins des seigneurs féodaux en exploitant les paysans dépendants sur la base de la propriété du féodal sur la terre et de sa propriété limitée sur les producteurs : les paysans serfs.
-
La société féodale, surtout au début du Moyen âge, était divisée en une foule de petites principautés et de petits États. Les couches sociales dominantes de la société féodale étaient la noblesse et le clergé. La paysannerie n’avait aucun droit politique. La lutte de classe entre paysans et seigneurs féodaux s’est poursuivie tout au long de l’histoire de la société féodale. L’État féodal, expression des intérêts de la noblesse et du clergé, les aidait activement à maintenir leur droit de propriété féodale sur la terre et à intensifier l’exploitation des paysans opprimés et dépourvus de tout droit.
-
Sous le régime féodal, l’agriculture jouait un rôle primordial et l’économie était essentiellement une économie naturelle. Avec le développement de la division sociale du travail et de l’échange, les vieilles cités, qui avaient survécu à la chute de l’esclavage, connurent une animation nouvelle ; d’autres apparurent. Les villes étaient les centres de l’artisanat et du commerce. L’artisanat était organisé en corporations qui visaient à empêcher la concurrence. Les commerçants étaient groupés en guildes de marchands.
-
Désagrégeant l’économie naturelle, les progrès de la production marchande entraînèrent une différenciation parmi la paysannerie et les artisans. Le capital commercial hâta la décomposition de l’artisanat et contribua à l’apparition d’entreprises capitalistes : les manufactures. Les entraves féodales et le morcellement territorial freinaient l’essor de la production marchande. Des marchés nationaux se formèrent peu à peu. Des États féodaux centralisés se constituèrent sous forme de monarchies absolues.
-
L’accumulation primitive du capital prépara l’avènement du capitalisme. Des masses considérables de petits producteurs — paysans et artisans — furent privés de leurs moyens de production. Les grands propriétaires fonciers, les marchands et les usuriers concentrèrent entre leurs mains d’importantes richesses monétaires par l’expropriation brutale de la paysannerie, le commerce avec les colonies, les impôts et la traite des noirs. Ainsi se trouva accélérée la formation des principales classes de la société capitaliste : celle des ouvriers salariés et celle des capitalistes. C’est au sein même de la société féodale que surgirent et mûrirent les formes plus ou moins achevées du régime capitaliste.
-
Les rapports de production féodaux, la faible productivité du travail des paysans serfs, les restrictions corporatives entravaient le développement des forces productives. Les révoltes des serfs ébranlèrent le régime féodal et aboutirent à l’abolition du servage. La bourgeoisie prit la tête du combat contre la féodalité. Elle mit à profit la lutte révolutionnaire des paysans contre les seigneurs féodaux pour s’emparer du pouvoir. Les révolutions bourgeoises renversèrent le régime féodal, assurèrent la victoire du capitalisme et donnèrent libre cours au développement des forces productives.
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par Pcautunois le 19 Avril 2011 à 16:52
A. — Le capitalisme prémonopoliste
Chapitre 4 — La production marchande — La marchandise et la monnaie
4.1. La production marchande est le point de départ et le trait général du capitalisme.
Le mode de production capitaliste, qui a succédé au mode de production féodal, est fondé sur l’exploitation de la classe des ouvriers salariés par la classe des capitalistes. Pour comprendre ce qu’est au fond le mode de production capitaliste, il faut tout d’abord ne pas perdre de vue que le régime capitaliste est fondé sur la production marchande : tout y prend forme de marchandise, partout prévaut le principe de l’achat et de la vente.
La production marchande est plus ancienne que la production capitaliste. Elle existait déjà sous le régime de l’esclavage et sous le régime féodal. Dans la période de décomposition de la féodalité, la production marchande simple a servi de base à la naissance de la production capitaliste.
La production marchande simple implique, premièrement, la division sociale du travail dans laquelle des producteurs isolés se spécialisent dans la fabrication de produits déterminés, et, en second lieu, l’existence de la propriété privée des moyens de production et des produits du travail.
La production marchande simple des artisans et des paysans se distingue de la production capitaliste en ce qu’elle repose sur le travail individuel du producteur de marchandises. Cependant, elle est, quant à sa base, du même type que la production capitaliste, puisqu’elle prend appui sur la propriété privée des moyens de production. La propriété privée engendre nécessairement, entre les producteurs de marchandises, la concurrence qui aboutit à l’enrichissement d’une minorité et à la ruine de la majorité. La petite production marchande est donc à l’origine de la formation et du développement des rapports capitalistes.
La production marchande revêt en régime capitaliste un caractère prédominant, universel. L’échange des marchandises, écrivait Lénine, constitue
le rapport de la société bourgeoise (marchande) le plus simple, habituel, fondamental, le plus massivement répandu, le plus ordinaire, qui se rencontre des milliards de fois […]( V. Lénine, « Sur la question de la dialectique », Cahiers philosophiques, p. 344-345, Éditions sociales, Éditions du Progrès, 1973.Aussi
Œuvres, t. 38, p. 344-345. )4.2. La marchandise et ses propriétés. Le double caractère du travail incorporé dans la marchandise.
La marchandise est une chose qui, premièrement, satisfait un besoin quelconque de l’homme et qui, deuxièmement, est produite, non pas pour la consommation propre, mais pour l’échange.
L’utilité d’un objet, ses propriétés qui lui permettent de satisfaire tel ou tel besoin de l’homme, en font une valeur d’usage. La valeur d’usage peut satisfaire directement le besoin individuel de l’homme, ou servir de moyen de production de biens matériels. Ainsi, le pain satisfait le besoin de nourriture ; le tissu, le besoin de s’habiller ; la valeur d’usage du métier à tisser consiste en ce qu’il sert à produire des tissus. Au cours du développement historique, l’homme découvre des propriétés utiles toujours nouvelles dans les objets et des procédés nouveaux de leur utilisation.
De nombreuses choses qui n’ont cependant pas été créées par le travail de l’homme, ont une valeur d’usage, comme par exemple, l’eau de source, les fruits sauvages, etc. Mais toute chose ayant une valeur d’usage ne constitue pas une marchandise. Pour qu’un objet puisse devenir marchandise, il doit être un produit du travail destiné à la vente.
Les valeurs d’usage forment le contenu matériel de la richesse, quelle que soit la forme sociale de cette richesse. Dans l’économie marchande, la valeur d’usage porte en soi la valeur d’échange de la marchandise. La valeur d’échange se présente tout d’abord comme un rapport quantitatif dans lequel les valeurs d’usage d’espèce différente sont échangées l’une contre l’autre. Par exemple, une hache est échangée contre 20 kilogrammes de grain. Dans ce rapport quantitatif des objets échangés se trouve exprimée leur valeur d’échange. Des marchandises en quantités déterminées sont assimilées les unes aux autres ; par conséquent, elles ont quelque chose de commun. Ce ne peut être aucune des propriétés physiques des marchandises — leur poids, leur volume, leur forme, etc. Les propriétés naturelles des marchandises déterminent leur utilité, leur valeur d’usage. La diversité des valeurs d’usage des marchandises est une condition nécessaire de l’échange. Personne n’échangera des marchandises identiques en qualité, par exemple, du froment pour du froment ou du sucre pour du sucre.
Les valeurs d’usage des diverses marchandises, qualitativement différentes, ne sont pas quantitativement commensurables.
Les différentes marchandises n’ont qu’une seule propriété commune qui les rende comparables entre elles lors de rechange : elles sont des produits du travail. À la base de l’égalité de deux marchandises échangées se trouve le travail social dépensé pour les produire. Quand le producteur porte au marché une hache pour l’échanger, il constate que l’on donne pour sa hache 20 kilogrammes de grain. Cela veut dire que la hache vaut autant de travail social que 20 kilogrammes de grain. La valeur est le travail social des producteurs, incorporé dans la marchandise.
La valeur des marchandises incarne le travail social dépensé pour leur production ; c’est ce que confirment des faits connus de tous. Les biens matériels qui, utiles par eux-mêmes, n’exigent pas de dépenses de travail, n’ont pas de valeur, comme par exemple l’air. Les biens matériels nécessitant une grande quantité de travail possèdent une grande valeur, comme par exemple l’or, les diamants. Beaucoup de marchandises qui coûtaient d’abord cher, ont considérablement diminué de prix depuis que le progrès technique a réduit la quantité de travail nécessaire à leur production. Les variations de dépenses de travail dans la production des marchandises se reflètent d’ordinaire aussi dans le rapport quantitatif des marchandises échangées, c’est-à-dire dans leur valeur d’échange. Il en résulte que la valeur d’échange d’une marchandise est la forme de la manifestation de sa valeur.
L’échange des marchandises implique la division sociale du travail entre les propriétaires de ces marchandises. Les producteurs, en assimilant les différentes marchandises les unes aux autres, identifient par là même leurs différentes espèces de travail. Ainsi donc, la valeur exprime des rapports de production entre les producteurs. Ces rapports apparaissent dans l’échange des marchandises.
La marchandise revêt un double caractère : 1o elle est une valeur d’usage et 2o elle est une valeur d’échange. Le double caractère de la marchandise est déterminé par le double caractère du travail incorporé à la marchandise. Les espèces de travail sont aussi variées que les valeurs d’usage produites. Le travail du menuisier diffère qualitativement de celui du tailleur, du cordonnier, etc. Les différentes espèces de travail se distinguent les unes des autres par leur but, les procédés de fabrication, les outils et, enfin, par les résultats. Le menuisier travaille à l’aide d’une hache, d’une scie, d’un rabot, et produit des articles en bois : tables, chaises, armoires ; le tailleur produit des vêtements à l’aide d’une machine à coudre, de ciseaux, d’aiguilles. C’est ainsi que chaque valeur d’usage incarne une espèce déterminée de travail : la table, le travail du menuisier ; le costume, le travail du tailleur ; les chaussures, le travail du cordonnier, etc. Le travail dépensé sous une forme déterminée constitue le travail concret. Le travail concret crée la valeur d’usage de la marchandise.
Lors de l’échange, les marchandises les plus variées provenant des formes diverses du travail concret, sont comparées et assimilées les unes aux autres. Par conséquent, les différentes espèces concrètes de travail cachent derrière elles quelque chose de commun à tout travail. Le travail du menuisier comme celui du tailleur, malgré leur différence qualitative, comporte une dépense productive du cerveau humain, des nerfs, des muscles, etc., et c’est dans ce sens qu’il apparaît comme un travail humain identique uniforme, du travail en général. Le travail des producteurs de marchandises en tant que dépense de la force de travail de l’homme en général, indépendamment de sa forme concrète, est du travail abstrait. Le travail abstrait forme la valeur de la marchandise.
Travail abstrait et travail concret sont les deux aspects du travail incorporé dans la marchandise.
Tout travail est d’une part dépense, dans le sens physiologique, de force de travail humaine, et à ce titre de travail humain identique ou travail humain abstrait il forme la valeur des marchandises. D’autre part, tout travail est dépense de force de travail humaine, déterminée par un but particulier, et à ce titre de travail concret utile il produit des valeurs d’usage.
( K. Marx, Le Capital, livre 1, t. 1, p. 61. )Dans une société où règne la propriété privée des moyens de production, le double caractère du travail incorporé dans la marchandise reflète la contradiction entre le travail privé et le travail social des producteurs. La propriété privée des moyens de production sépare les hommes, fait du travail de chaque producteur son affaire privée. Chaque producteur de marchandises travaille isolément. Le travail des différents ouvriers n’est ni concerté ni coordonné à l’échelle de toute la société. Mais d’autre part, la division sociale du travail traduit l’existence d’une multitude de liens entre les producteurs qui travaillent les uns pour les autres. Plus la division du travail dans la société est poussée et plus il y a de diversité dans les produits des différents producteurs, et plus leur interdépendance est grande. Par conséquent, le travail du producteur isolé est au fond un travail social ; il constitue une parcelle du travail de la société dans son ensemble. Les marchandises, qui sont les produits de diverses formes de travail privé concret, sont également en même temps les produits de travail humain en général, de travail abstrait.
La contradiction propre à la production marchande consiste donc en ce que le travail des producteurs de marchandises, tout en étant directement leur affaire privée, revêt en même temps un caractère social. Par suite de l’isolement des producteurs de marchandises, le caractère social de leur travail dans le processus de production reste caché. Il ne se manifeste que dans le processus de l’échange, au moment où la marchandise apparaît sur le marché pour être échangée contre une autre marchandise. C’est seulement dans le processus d’échange qu’il est possible d’établir si le travail de tel ou tel producteur est nécessaire à la société et s’il obtiendra l’agrément de la société. Le travail abstrait, qui forme la valeur de la marchandise, constitue une catégorie historique, il est la forme spécifique du travail social propre seulement à l’économie marchande. Dans l’économie naturelle, les hommes produisent non pas pour l’échange, mais pour leur propre consommation ; en conséquence, le caractère social de leur travail se présente directement sous sa forme concrète. Ainsi, quand le seigneur féodal prenait aux serfs le surproduit sous la forme d’une rente-travail ou d’une rente en nature, il s’appropriait leur travail directement sous la forme de redevance en travail ou de certains produits. Le travail social dans ces conditions ne prenait pas la forme d’un travail abstrait. Dans la production marchande, les produits sont confectionnés non pour la consommation personnelle du producteur, mais pour la vente. Le caractère social du travail ne se manifeste que sur le marché, par l’assimilation d’une marchandise à une autre, en ramenant les formes concrètes du travail au travail abstrait qui constitue la valeur de la marchandise. Ce processus s’opère spontanément, en dehors de tout plan général, à l’insu du producteur.
4.3. Le temps de travail socialement nécessaire. Le travail simple et le travail complexe.
La grandeur de la valeur d’une marchandise est déterminée par le temps de travail. Plus la production d’une marchandise nécessite de temps, et plus grande est sa valeur. On sait que les producteurs travaillent dans des conditions différentes et dépensent pour la production de marchandises identiques une quantité différente de temps. Est-ce à dire que plus le travailleur est paresseux, plus les conditions dans lesquelles il travaille sont défavorables, et plus la valeur de la marchandise produite par lui sera élevée ? Non, évidemment. La grandeur de la valeur de la marchandise n’est point déterminée par le temps de travail individuel dépensé pour la production de la marchandise par tel ou tel producteur, mais par le temps de travail socialement nécessaire.
Le temps de travail socialement nécessaire est celui qu’exige la fabrication de telle ou telle marchandise, dans des conditions sociales de production moyennes, c’est-à-dire avec un niveau technique moyen, une habileté moyenne et une intensité de travail moyenne. Il correspond aux conditions de production, dans lesquelles sont fabriquées la plupart des marchandises d’un type donné. Le temps de travail socialement nécessaire varie selon le degré de la productivité du travail.
La productivité du travail s’exprime dans la quantité de produits créés en une unité de temps de travail. Elle augmente grâce au perfectionnement ou à l’utilisation plus complète des instruments de production, aux progrès de la science, à l’habileté accrue du travailleur, à la rationalisation du travail et à d’autres améliorations dans le processus de production. Plus la productivité du travail est élevée, et moins de temps est nécessaire à la production d’une unité d’une marchandise donnée, et plus la valeur de cette marchandise est basse.
De la productivité du travail, il faut distinguer l’intensité du travail. L’intensité du travail est déterminée par les dépenses de travail en une unité de temps. L’accroissement de l’intensité du travail signifie l’augmentation des dépenses de travail dans un laps de temps donné. Un travail plus intensif s’incarne dans une plus grande quantité de produits et crée plus de valeur en une unité de temps qu’un travail moins intensif.
À la production des marchandises prennent part des travailleurs de toute qualification. Le travail de l’homme ne possédant aucune formation spéciale est un travail travail simple. Le travail demandant une formation spéciale est un travail complexe, ou un travail qualifié.
Le travail complexe crée dans une même unité de temps, une valeur plus grande que le travail simple. La valeur de la marchandise créée par le travail complexe contient aussi la part du travail consacrée à l’apprentissage du travailleur et à l’augmentation de sa qualification. Le travail complexe prend la signification d’un travail simple multiplié ; une heure de travail complexe équivaut à plusieurs heures de travail simple. C’est de façon spontanée que, dans la production marchande fondée sur la propriété privée, toutes les espèces de travail complexe se ramènent à un travail simple. La grandeur de la valeur d’une marchandise est déterminée par la quantité de travail simple socialement nécessaire.
4.4. L’évolution des formes de la valeur. Le caractère de la monnaie.
La valeur de la marchandise est créée par le travail dans le processus de production, mais elle ne peut se manifester que si l’on compare une marchandise à une autre dans le processus d’échange, c’est-à-dire dans la valeur d’échange.
La forme la plus simple de la valeur est l’expression de la valeur d’une marchandise en une autre marchandise : par exemple, une hache = 20 kilogrammes de grain. Examinons cette forme.
Ici la valeur de la hache est exprimée en grain. Le grain sert de moyen d’expression matériel de la valeur de la hache. La valeur de la hache ne peut s’exprimer dans la valeur d’usage du grain que parce que la production du grain, de même que la production de la hache, a nécessité du travail. Derrière l’égalité des marchandises se cache l’égalité du travail dépensé à leur production. La marchandise (dans notre cas la hache) exprimant sa valeur en une autre marchandise se présente sous la forme relative de la valeur. La marchandise (dans notre exemple le grain), dont la valeur d’usage sert de moyen d’expression de la valeur d’une autre marchandise, se présente sous une forme forme équivalente. Le grain est l’équivalent d’une autre marchandise : la hache. La valeur d’usage d’aine marchandise : le grain, devient ainsi la forme d’expression de la valeur d’une autre marchandise : la hache.
À l’origine l’échange, qui apparaît déjà dans la société primitive, présentait un caractère fortuit et s’effectuait sous forme d’échange direct d’un produit contre un autre. À cette phase du développement des échanges correspond la forme simple ou accidentelle de la valeur :
Une hache = 20 kilogrammes de grain.
Avec la forme simple de la valeur, la valeur de la hache ne peut être exprimée que dans la valeur d’usage d’une marchandise, le grain dans notre exemple.
Avec l’apparition de la première grande division sociale du travail, la séparation des tribus de pasteurs de l’ensemble des tribus, l’échange devient plus régulier. Certaines tribus, celles des éleveurs, par exemple, commencent à produire un excédent de produits d’élevage, qu’elles échangent contre les produits agricoles ou artisanaux qui leur manquent. À ce degré d’évolution des échanges correspond une forme totale ou développée de la valeur. Interviennent alors dans les échanges non plus deux, mais toute une série de marchandises :
Un mouton = 40 kilogrammes de grain, ou 20 mètres de toile, ou2 haches, ou3 grammes d’or, etc.Ici la valeur de la marchandise reçoit son expression dans la valeur d’usage non pas d’une seule, mais de beaucoup de marchandises, qui jouent le rôle d’équivalent, En même temps les rapports quantitatifs, dans lesquels s’effectue l’échange, prennent un caractère plus constant. À ce degré toutefois se conserve encore l’échange direct d’une marchandise contre une autre.
Avec le développement de la division sociale du travail et de la production marchande, la forme d’échange direct d’une marchandise contre une autre devient insuffisante. On voit surgir, dans le processus de l’échange, des difficultés dues à l’accroissement des contradictions de la production marchande, des contradictions entre travail privé et travail social, entre la valeur d’usage et la valeur d’une marchandise. De plus en plus souvent apparaît une situation dans laquelle, par exemple, le possesseur d’une paire de bottes a besoin d’une hache, mais la valeur d’usage des bottes fait obstacle à l’échange, car le possesseur de la hache a besoin non de bottes, mais de grain : la transaction ne peut avoir lieu entre ces deux possesseurs de marchandises. Alors le possesseur de bottes échange sa marchandise contre la marchandise qui est plus souvent demandée en échange, et que tout le monde accepte volontiers, par exemple un mouton, et il échange contre ce mouton la hache qui lui est nécessaire. Quant au possesseur de la hache, une fois qu’il a reçu en échange de sa hache un mouton, il échange celui-ci contre du grain. C’est ainsi que sont résolues les contradictions de l’échange direct. L’échange direct d’une marchandise contre une autre disparaît progressivement. De la masse des marchandises, il s’en dégage une, par exemple le bétail, contre laquelle on commence à échanger toutes les marchandises. À ce degré de développement de l’échange correspond la forme générale de la valeur :
= un mouton. 40 kilogrammes de grain, ou 20 mètres de toile, ou2 haches, ou3 grammes d’or, etc.La forme générale de la valeur se caractérise par Je fait que toutes les marchandises commencent à s’échanger contre une marchandise qui joue le rôle d’équivalent général. Cependant, dans cette phase, le rôle d’équivalent général n’a pas encore été réservé à une seule marchandise. Selon les lieux, ce rôle est rempli par des marchandises différentes. Là, c’est le bétail ; ici, ce sont les fourrures ; ailleurs encore, c’est le sel, etc.
L’accroissement des forces productives, l’apparition des outils de métal et de la deuxième grande division sociale du travail, la séparation de l’artisanat et de l’agriculture, amènent le développement de la production marchande et l’élargissement du marché. L’abondance de marchandises d’espèces différentes, jouant le rôle d’équivalent général, entre en contradiction avec les besoins croissants du marché, qui exige l’adoption d’un équivalent unique.
Lorsque le rôle d’équivalent général se fut attaché à une seule marchandise, on a vu surgir la forme monnaie de la valeur. Divers métaux ont joué le rôle de monnaie, mais en fin de compte, il a été réservé aux métaux précieux, l’or et l’argent. L’argent et l’or présentent au plus haut degré toutes les qualités qui rendent les métaux propres à jouer le rôle de monnaie : ils sont homogènes, divisibles, inaltérables et ont une grande valeur sous un poids et un volume faibles. C’est pourquoi la fonction de la monnaie échut aux métaux précieux, et finalement à l’or.
La forme monnaie de la valeur peut être représentée de la façon suivante :
= 3 grammes d’or. 40 kilogrammes de grain, ou 20 mètres de toile, ou1 mouton, ou2 haches, etc.Avec la forme monnaie, la valeur de toutes les marchandises s’exprime dans la valeur d’usage d’une seule marchandise, qui est devenue équivalent général.
Ainsi la monnaie a fait son apparition à la suite d’un long processus de développement de l’échange et des formes de la valeur. Avec l’apparition de la monnaie s’effectue la division du monde des marchandises selon deux pôles : à un pôle restent les marchandises courantes ; à l’autre se trouve la marchandise qui joue le rôle de monnaie. Désormais toutes les marchandises commencent à exprimer leur valeur en marchandise-monnaie. Par conséquent, la monnaie, contrairement à toutes les autres marchandises, joue le rôle d’incarnation générale de la valeur, d’équivalent général. La monnaie a la faculté de pouvoir être échangée directement contre toutes les marchandises, et ainsi de servir de moyen de satisfaction de tous les besoins des possesseurs de marchandises, tandis que toutes les autres marchandises ne sont à même de satisfaire qu’une espèce de besoins particuliers, par exemple les besoins en pain, en vêtements, etc…
Par conséquent, la monnaie est une marchandise qui sert d’équivalent général pour toutes les marchandises ; elle incarne le travail social et exprime les rapports de production entre les producteurs de marchandises.
4.5. Les fonctions de la monnaie.
À mesure que la production marchande croît, se développent les fonctions exercées par la monnaie. Dans une production marchande évoluée la monnaie sert : 1o de mesure de la valeur ; 2o de moyen de circulation ; 3o de moyen d’accumulation ; 4o de moyen de paiement et 5o de monnaie universelle.
La fonction essentielle de la monnaie est de servir de mesure de la valeur des marchandises. C’est au moyen de la monnaie que le travail privé des producteurs de marchandises trouve une expression sociale, que s’opère le contrôle spontané et la mesure de la valeur de toutes les marchandises. La valeur d’une marchandise ne peut être exprimée directement en temps de travail, puisque dans les conditions d’isolement et de dispersion des producteurs privés il est impossible de déterminer la quantité de travail que dépense non pas un producteur isolé, mais la société dans son ensemble pour la production de telle ou telle marchandise. De ce fait la valeur de la marchandise ne peut être exprimée qu’indirectement, en assimilant la marchandise à la monnaie dans le processus d’échange.
Pour remplir la fonction de mesure de la valeur, la monnaie doit être elle-même une marchandise, posséder une valeur. De même que la pesanteur d’un corps ne peut être mesurée qu’à l’aide d’un corps pesant, de même la valeur d’une marchandise ne peut être mesurée qu’à l’aide d’une marchandise ayant une valeur.
La mesure de la valeur des marchandises par le moyen de l’or se fait avant que s’effectue l’échange d’une marchandise donnée contre de la monnaie. Pour exprimer en monnaie la valeur des marchandises, il n’est pas nécessaire d’avoir en main de l’argent liquide. En fixant un prix déterminé pour une marchandise, le possesseur exprime mentalement ou, comme le dit Marx, idéalement, la valeur de la marchandise en or.
Cela est possible parce que, dans la réalité vivante, il existe un rapport déterminé entre la valeur de l’or et celle d’une marchandise donnée ; à la base de ce rapport se trouve le travail socialement nécessaire dépensé pour leur production.
La valeur d’une marchandise, exprimée en monnaie, s’appelle son prix. Le prix est l’expression monétaire de la valeur de la marchandise.
Les marchandises expriment leur valeur en des quantités déterminées d’argent ou d’or. Ces quantités de marchandise-monnaie doivent être mesurées à leur tour. D’où la nécessité d’une unité de mesure de la monnaie. Cette unité est constituée par un certain poids du métal devenu monnaie.
En Angleterre, par exemple, l’unité monétaire s’appelle livre sterling ; autrefois, elle correspondait à une livre d’argent. Plus tard, les unités de monnaie se sont différenciées des unités de poids. Cela est dû à l’emprunt de monnaies étrangères, au passage de l’argent à l’or, et principalement à la dépréciation des pièces de monnaie par les gouvernements, qui peu à peu en diminuèrent le poids. Pour faciliter la mesure les unités monétaires se divisent en parties plus petites : le rouble en 100 kopeks ; le dollar en 100 cents ; le franc en 100 centimes, etc.
L’unité monétaire avec ses subdivisions sert d’étalon des prix. À ce titre, la monnaie joue un tout autre rôle qu’en tant que mesure de la valeur. Comme mesure de la valeur, la monnaie mesure la valeur des autres marchandises ; en tant qu’étalon des prix, elle mesure la quantité du métal monétaire. La valeur de la marchandise-monnaie varie avec les variations de la quantité de travail socialement nécessaire à sa production. Le changement de valeur de l’or n’affecte pas sa fonction d’étalon des prix. Quelles que soient les variations de la valeur de l’or, le dollar reste toujours cent fois supérieur au cent.
L’État peut modifier la teneur en or de l’unité monétaire, mais il ne peut changer le rapport de valeur entre l’or et les autres marchandises. Si l’État diminue la quantité d’or contenue dans une unité monétaire, c’est-à-dire s’il en diminue la teneur en or, le marché réagira par une hausse des prix, et la valeur de la marchandise s’exprimera comme par le passé en une quantité d’or qui correspond au travail dépensé pour la fabrication de cette marchandise. Seulement, pour exprimer maintenant la même quantité d’or, il faut un plus grand nombre d’unités monétaires qu’auparavant.
Les prix des marchandises peuvent monter ou s’abaisser sous l’influence des variations que subissent la valeur des marchandises, ainsi que la valeur de l’or. La valeur de l’or, comme celle de toutes les autres marchandises, dépend de la productivité du travail. Ainsi, la découverte de l’Amérique avec ses riches ruines d’or a amené une « révolution » dans les prix. L’or en Amérique était extrait avec moins de travail qu’en Europe. L’afflux en Europe de l’or américain à meilleur marché a provoqué une hausse générale des prix.
La monnaie fait fonction de moyen de circulation. L’échange des marchandises effectué avec de la monnaie s’appelle circulation des marchandises. La circulation des marchandises est étroitement liée à la circulation de la monnaie : lorsque la marchandise passe des mains du vendeur dans celles de l’acheteur, la monnaie passe des mains de l’acheteur dans celles du vendeur. La fonction de la monnaie comme moyen de circulation consiste précisément dans son rôle d’intermédiaire dans le processus de circulation des marchandises. Pour remplir cette fonction la monnaie est indispensable.
À l’origine, dans l’échange des marchandises, la monnaie se présentait directement sous forme de lingots d’argent ou d’or. Cela créait certaines difficultés ; nécessité de peser le métal-monnaie, de le fragmenter en petites parcelles, d’en établir le titre. Peu à peu les lingots de métal-monnaie furent remplacés par des pièces de monnaie. La pièce de monnaie est un lingot de métal de forme, de poids et de valeur déterminés, qui sert de moyen de circulation. La frappe des monnaies fut centralisée entre les mains de l’État.
Dans le processus de circulation, les monnaies s’usent et perdent une partie de leur valeur. La pratique de la circulation monétaire montre que les pièces usées peuvent faire office de moyen de circulation aussi bien que les pièces de monnaie demeurées intactes. Cela s’explique par le fait que la monnaie dans sa fonction de moyen de circulation joue un rôle passager. En règle générale, le vendeur d’une marchandise l’échange contre de la monnaie pour acheter avec cette monnaie une autre marchandise. Par conséquent, la monnaie comme moyen de circulation ne doit pas avoir obligatoirement une valeur propre.
Constatant la circulation des pièces de monnaie usées, les gouvernements se sont mis sciemment à déprécier les pièces de monnaie, à en diminuer le poids, à abaisser le titre du métal-monnaie, sans changer la valeur nominale de la pièce de monnaie, c’est-à-dire la quantité d’unités monétaires marquées sur les pièces. Les pièces de monnaie devenaient de plus en plus des symboles de valeur, des signes monétaires. Leur valeur réelle est de beaucoup inférieure à leur valeur nominale.
Le dédoublement de la marchandise en marchandise et en monnaie marque le développement des contradictions de la production marchande. Lors de l’échange direct d’une marchandise contre une autre, chaque transaction présente un caractère isolé, la vente est inséparable de l’achat. Tout autre est l’échange effectué par l’intermédiaire de la monnaie, c’est-à-dire la circulation des marchandises. Ici, l’échange suppose une multitude de liens entre producteurs et un entrelacement constant de leurs transactions. Il offre la possibilité de séparer la vente et l’achat. Le producteur peut vendre sa marchandise et garder pour un temps la monnaie qu’il a retirée de cette vente. Lorsque beaucoup de producteurs vendent sans acheter, il peut se produire un arrêt dans l’écoulement des marchandises. Ainsi, déjà dans la circulation simple des marchandises se trouve impliquée la possibilité des crises. Mais pour que les crises deviennent inévitables, il faut une série de conditions qui n’apparaissent qu’avec le passage au mode de production capitaliste.
La monnaie fait fonction de moyen d’accumulation ou de moyen de thésaurisation. La monnaie devient trésor dans les cas où elle est retirée de la circulation. Comme on peut toujours convertir la monnaie en n’importe quelle marchandise, elle est le représentant universel de la richesse. On peut la garder en n’importe quelle quantité. Les producteurs accumulent de la monnaie, par exemple pour l’achat de moyens de production ou à titre d’épargne. Le pouvoir de la monnaie grandit avec le développement de la production marchande. C’est ce qui engendre la passion de l’épargne de la monnaie, la passion de la thésaurisation. Seule la monnaie non dépréciée peut exercer la fonction de thésaurisation : les pièces d’or et d’argent, les lingots d’or et d’argent, ainsi que les objets en or et en argent.
Quand ce sont les pièces d’or ou d’argent qui servent de monnaie, leur quantité s’adapte spontanément aux besoins de la circulation des marchandises. En cas de diminution de la production des marchandises et de réduction du commerce, une partie des pièces d’or est retirée de la circulation et est thésaurisée. Par contre, quand la production s’élargit et que le commerce s’accroît, ces pièces de monnaie rentrent de nouveau dans la circulation.
La monnaie exerce la fonction de moyen de paiement. En tant que moyen de paiement elle intervient dans les cas où l’achat et la vente de la marchandise se font à crédit, c’est-à-dire quand le paiement est différé. Dans l’achat à crédit, la remise de la marchandise des mains du vendeur dans celles de l’acheteur se fait sans paiement immédiat de la marchandise achetée. À l’échéance du paiement de la marchandise, l’acheteur verse la monnaie au vendeur pour la marchandise dont la livraison a déjà été effectuée auparavant. La monnaie sert aussi de moyen de paiement quand elle sert à acquitter les impôts, la rente foncière, etc.
La fonction de la monnaie comme moyen de paiement reflète le développement des contradictions de la production marchande. Les liaisons entre les divers producteurs s’étendent, leur interdépendance s’accroît. L’acheteur devient débiteur, le vendeur se transforme en créancier. Lorsque beaucoup de possesseurs de marchandises achètent à crédit, le défaut de paiement de traites à leur échéance, par l’un ou plusieurs des débiteurs, peut se répercuter sur toute la chaîne des obligations de paiement et provoquer la faillite d’un certain nombre de possesseurs de marchandises, liés les uns aux autres par des rapports de crédit. C’est ainsi que la possibilité des crises, impliquée déjà dans la fonction de la monnaie comme moyen de circulation, s’accentue.
L’analyse des fonctions exercées par la monnaie comme moyen de circulation et comme moyen de paiement permet d’établir la loi déterminant la quantité de monnaie nécessaire à la circulation des marchandises.
Les marchandises se vendent et s’achètent en beaucoup d’endroits simultanément. La quantité de monnaie nécessaire a la circulation à une période donnée dépend tout d’abord de la somme des prix des marchandises en circulation ; cette somme dépend à son tour de la quantité de marchandises et du prix de chaque marchandise prise à part. En outre, il faut tenir compte de la vitesse avec laquelle la monnaie circule. Quand la monnaie circule plus vite, il en faut moins pour la circulation, et inversement. Si, par exemple, pendant une période donnée, mettons un an, il se vend pour un milliard de dollars de marchandises, et si chaque dollar effectue en moyenne cinq rotations, il faudra 200 millions de dollars pour la circulation de toute la masse des marchandises.
Grâce au crédit que les producteurs s’accordent les uns aux autres, le besoin de monnaie diminue de la somme des prix des marchandises vendues à crédit, ainsi que des créances réciproques qui s’annulent au jour de l’échéance. L’argent liquide n’est nécessaire que pour acquitter les dettes, dont le remboursement est venu à échéance.
Ainsi donc, la loi de la circulation monétaire est la suivante : la quantité de monnaie nécessaire à la circulation des marchandises doit égaler la somme des prix de toutes les marchandises, divisée par la moyenne des rotations des unités monétaires de même nom. De la somme des prix de toutes les marchandises, il faut déduire la somme des prix des marchandises vendues à crédit, les sommes mutuellement remboursables et y ajouter les sommes dont le remboursement est venu à échéance.
Cette loi a une portée générale pour toutes les formations sociales où il y a production et circulation marchandes.
Enfin la monnaie joue le rôle de monnaie universelle dans le trafic entre les pays. Le rôle de monnaie universelle ne peut être joué par des pièces de monnaie dévalorisées ou par du papier-monnaie. Sur le marché mondial, la monnaie perd la forme de pièces de monnaie et se présente sous son aspect primitif de lingots de métal précieux. Sur le marché mondial dans les transactions entre les pays, l’or est le moyen d’achat universel, dans le règlement des marchandises importées d’un pays dans un autre ; il est le moyen de paiement universel dans l’amortissement des dettes internationales, dans le paiement des intérêts des emprunts extérieurs et des autres obligations ; il est l’incarnation de la richesse sociale dans les transferts de richesse sous forme monétaire d’un pays dans un autre, par exemple dans les cas d’exportation de capitaux en monnaie, destinés à des placements dans des banques étrangères ou à des octrois de prêts ainsi que dans les impositions de contributions par un pays vainqueur à un pays vaincu, etc.
Le développement des fonctions exercées par la monnaie exprime le progrès de la production marchande et de ses contradictions. La monnaie dans les formations sociales fondées sur l’exploitation de l’homme par l’homme a une nature de classe : elle est un moyen d’accaparer le travail d’autrui. Elle a joué ce rôle dans les sociétés esclavagiste et féodale. Nous verrons par la suite que c’est dans la société capitaliste que la monnaie sert au plus haut degré d’instrument d’exploitation des travailleurs.
4.6. L’or et le papier-monnaie.
Quand la production marchande est développée, on emploie souvent pour les achats et les paiements, au lieu de pièces d’or, le papier-monnaie qui les remplace. L’émission du papier-monnaie a été engendrée par la pratique de la circulation des pièces usées et dépréciées, qui devenaient des symboles d’or, des signes monétaires.
Le papier-monnaie consiste en signes monétaires émis par l’État et ayant cours forcé, qui remplacent l’or dans sa fonction de moyen de circulation. Il n’a pas de valeur propre. Aussi ne peut-il pas remplir la fonction de mesure de la valeur des marchandises. Quelle que soit la quantité de papier-monnaie émis, elle ne représente que la valeur de la quantité d’or, nécessaire pour assurer les échanges. Le papier-monnaie n’est pas échangeable avec l’or.
Si le papier-monnaie est émis proportionnellement à la quantité d’or nécessaire à la circulation, son pouvoir d’achat, c’est-à-dire la quantité de marchandises qu’il permet d’acheter, coïncide avec le pouvoir d’achat de la monnaie d’or. Mais l’État émet généralement le papier-monnaie pour couvrir ses dépenses, notamment pendant les guerres, les crises et autres bouleversements, sans tenir compte des besoins de la circulation des marchandises. Lorsque la production et la circulation des marchandises se contractent, ou qu’on émet une quantité excessive de papier-monnaie, celle-ci excède la quantité d’or nécessaire aux échanges. Admettons que l’on ait émis deux fois plus de monnaie qu’il n’est nécessaire. En ce cas, chaque unité de papier-monnaie (dollar, mark, franc, etc.) représentera une quantité d’or deux fois moindre, c’est-à-dire que le papier-monnaie sera déprécié de moitié.
Les premiers essais d’émission de papier-monnaie ont eu lieu en Chine dès le 12e siècle ; du papier-monnaie fut émis en Amérique en 1690, en France, en 1716 ; l’Angleterre a procédé aux émissions de papier-monnaie pendant les guerres de Napoléon. En Russie, le papier-monnaie a été émis pour la première fois sous le règne de Catherine II.
L’émission excessive de papier-monnaie, qui entraîne sa dépréciation et qui est utilisée par les classes régnantes pour faire retomber les dépenses de l’État sur le dos des masses laborieuses et en renforcer l’exploitation, porte le nom d’inflation. Celle-ci, en provoquant la hausse des prix des produits, affecte surtout les travailleurs, car le salaire des ouvriers et des employés reste en retard sur la montée des prix. L’inflation profite aux capitalistes et aux propriétaires fonciers, surtout par suite de l’abaissement du salaire réel des ouvriers de l’industrie et de l’agriculture. L’inflation favorise les capitalistes et les propriétaires terriens qui exportent leurs marchandises à l’étranger. Par suite de la chute du salaire réel et de la diminution des dépenses de production qui en résulte, il devient possible de concurrencer avec succès les capitalistes et les propriétaires terriens étrangers et d’accroître l’écoulement de ses propres marchandises.
4.7. La loi de la valeur est la loi économique de la production marchande.
Dans l’économie marchande fondée sur la propriété privée, les marchandises sont fabriquées par des producteurs privés, isolés. Entre les producteurs de marchandises règnent la concurrence et la lutte. Chacun s’efforce d’évincer l’autre, de maintenir et d’élargir ses positions sur le marché. La production se fait sans aucun plan d’ensemble. Chacun produit pour son compte, indépendamment des autres, nul ne connaît quel besoin les marchandises qu’il produit doivent satisfaire ni le nombre des autres producteurs qui travaillent à la fabrication de la même marchandise, ni s’il pourra vendre sa marchandise au marché et si sa dépense de travail sera dédommagée. Avec le développement de la production marchande, le pouvoir du marché sur le producteur se renforce de plus en plus.
Cela veut dire que dans la production marchande fondée sur la propriété privée des moyens de production agit la loi économique de la concurrence et de l’anarchie de la production. Cette loi exprime le caractère spontané de la production et de l’échange, la lutte entre les producteurs privés pour des conditions plus avantageuses de la production et de la vente des marchandises.
Dans les conditions de l’anarchie de la production, qui règne dans l’économie marchande fondée sur la propriété privée, c’est la loi de la valeur agissant par la concurrence du marché, qui joue le rôle de régulateur spontané de la production.
La loi de la valeur est la loi économique de la production des marchandises, d’après laquelle l’échange des marchandises s’opère conformément à la quantité de travail socialement nécessaire à leur production.
Spontanément la loi de la valeur règle, par le mécanisme des prix, la répartition du travail social et des moyens de production entre les diverses branches de l’économie marchande. Sous l’influence des fluctuations qui se produisent dans le rapport de l’offre et de la demande, les prix des marchandises s’écartent sans cesse de leur valeur (au-dessus ou en dessous de celle-ci). Ces écarts ne sont pas le résultat de quelque déficience de la loi de la valeur ; au contraire, c’est le seul moyen pour cette loi de se réaliser. Dans une société où la production est détenue par des propriétaires privés qui travaillent à l’aveuglette, seules les fluctuations spontanées des prix sur le marché font connaître aux producteurs quels sont les produits qui sont en excédent ou qui manquent par rapport à la demande solvable de la population. Seules les fluctuations spontanées des prix autour de la valeur obligent les producteurs à élargir ou à réduire la production de telle ou telle marchandise. Sous l’influence de la variation des prix, les producteurs se tournent vers les branches plus avantageuses, où les prix des marchandises sont supérieurs à leur valeur, et ils se retirent de celles où les prix des marchandises sont inférieurs à leur valeur.
L’action de la loi de la valeur conditionne le développement des forces productives de l’économie marchande. Comme on le sait, la grandeur de la valeur d’une marchandise est déterminée par le travail socialement nécessaire. Les producteurs qui appliquent pour la première fois une technique plus avancée, produisent leurs marchandises avec des dépenses inférieures aux dépenses socialement nécessaires ; ils les vendent cependant à des prix correspondant au travail socialement nécessaire. Ce faisant, ils reçoivent un surplus de monnaie et s’enrichissent. Cela incite les autres producteurs à moderniser leurs entreprises au point de vue technique. C’est ainsi qu’à la suite d’actions disséminées de producteurs isolés, qui ne songent qu’à leur profit personnel, la technique progresse, les forces productives de la société se développent.
La concurrence et l’anarchie de la production font que la répartition du travail et des moyens de production entre les différentes branches, et le développement des forces productives dans l’économie marchande, sont réalisés au prix de grosses pertes de travail social et aboutissent à une aggravation constante des contradictions de cette économie.
Dans le cadre de la production marchande fondée sur la propriété privée, l’action de la loi de la valeur conduit à la naissance et au développement des rapports capitalistes. Les variations spontanées des prix du marché autour de la valeur, les écarts des dépenses individuelles de travail par rapport au travail socialement nécessaire qui détermine la grandeur de la valeur de la marchandise, accentuent l’inégalité économique et la lutte entre les producteurs. La concurrence provoque la ruine et la disparition de certains producteurs qui deviennent des prolétaires, l’enrichissement de certains autres, qui deviennent des capitalistes. L’action de la loi de la valeur conduit ainsi à la différenciation des producteurs.
[…] la petite production engendre le capitalisme et la bourgeoisie constamment, chaque jour, à chaque heure, d’une manière spontanée et dans de vastes proportions.
( V. Lénine, « La Maladie infantile du communisme (le gauchisme) », Œuvres, t. 31, p. 18. )4.8. Le caractère fétiche de la marchandise.
Dans le cadre de la production marchande fondée sur la propriété privée des moyens de production, le lien social qui existe entre les hommes dans le processus de production ne se manifeste que par l’échange des objets-marchandises. Le sort des producteurs se trouve étroitement lié à celui des objets-marchandises qu’ils ont créés. Les prix des marchandises varient sans cesse indépendamment de la volonté et de la conscience des hommes, cependant que le niveau des prix est souvent une question de vie et de mort pour les producteurs.
Les rapports des choses masquent les rapports sociaux entre les hommes. Ainsi, la valeur de la marchandise exprime le rapport social entre producteurs, toutefois elle apparaît comme une propriété aussi naturelle de la marchandise que, par exemple, sa couleur ou son poids.
C’est seulement un rapport social déterminé des hommes entre eux qui revêt ici pour eux la forme fantastique d’un rapport des choses entre elles.
( K. Marx, Le Capital, livre 1, t. 1, p. 85. )Ainsi, dans l’économie marchande fondée sur la propriété privée, les rapports de production entre les hommes se présentent inévitablement comme des rapports entre objets-marchandises. C’est dans cette matérialisation des rapports de production que réside justement le caractère fétiche 1 propre à la production des marchandises.
Le fétichisme de la marchandise se manifeste de façon particulièrement éclatante dans la monnaie. La monnaie dans l’économie marchande est une force énorme qui confère un pouvoir sur les hommes. Tout s’achète avec de la monnaie. On a l’impression que cette faculté de tout acheter est la propriété naturelle de l’or, alors que, en réalité, elle résulte de rapports sociaux déterminés.
Le fétichisme de la marchandise a des racines profondes dans la production marchande, où le travail du producteur se manifeste directement comme travail privé, et où son caractère social n’apparaît que dans l’échange des marchandises. C’est seulement avec l’abolition de la propriété privée des moyens de production que disparaît le caractère fétiche de la marchandise.
Notes1. La matérialisation des rapports de production, inhérente à la production des marchandises, porte le nom de « fétichisme marchand » par analogie avec le fétichisme religieux qui consiste dans la déification par les hommes primitifs des objets qu’ils avaient eux-mêmes créés.Résumé du chapitre 4
-
La production marchande simple des artisans et des paysans est à l’origine du capitalisme. Elle diffère de la production capitaliste en ce qu’elle repose sur le travail individuel du producteur. Elle a en même temps une base analogue à la production capitaliste, puisqu’elle est fondée sur la propriété privée des moyens de production. Sous le régime capitaliste, quand, tout comme les produits du travail, la force de travail devient aussi marchandise, la production marchande prend un caractère prédominant, universel.
-
La marchandise est un objet produit en vue de rechange. Elle constitue d’une part une valeur d’usage, d’autre part une valeur proprement dite. Le travail qui crée la marchandise possède un double caractère. Le travail concret est celui que l’on dépense sous une forme déterminée ; il crée la valeur d’usage de la marchandise. Le travail abstrait est une dépense de force humaine de travail en général ; il crée la valeur de la marchandise.
-
La valeur est le travail social — matérialisé dans la marchandise — des producteurs. La valeur est une catégorie historique propre uniquement à l’économie marchande. La grandeur de la valeur d’une marchandise est déterminée par le travail socialement nécessaire à sa production. La contradiction de la production marchande simple réside en ce que le travail des producteurs, qui est directement leur affaire privée, revêt en même temps un caractère social.
-
Le développement des contradictions dans la production marchande fait que, de la masse des marchandises, il s en dégage spontanément une, qui devient monnaie. La monnaie est une marchandise qui joue le rôle d’équivalent général. La monnaie exerce les fonctions suivantes : 1o mesure de la valeur ; 2o moyen de circulation ; 3o moyen d’accumulation ; 4o moyen de paiement et 5o monnaie universelle.
-
Avec le développement de la circulation monétaire apparaît le papier-monnaie. Celui-ci, n’ayant pas de valeur propre, est le signe de la monnaie métallique qu’il remplace comme moyen de circulation. L’émission excessive de papier-monnaie, qui en provoque la dépréciation (inflation), conduit à l’abaissement du niveau de vie des travailleurs.
-
Dans l’économie marchande fondée sur la propriété privée des moyens de production, la loi de la valeur est le régulateur spontané de la répartition du travail social entre les branches de la production. L’action de la loi de la valeur détermine la différenciation des petits producteurs et le développement des rapports capitalistes.
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par Pcautunois le 18 Avril 2011 à 16:56
A. — Le capitalisme prémonopoliste
Chapitre 5 — La coopération capitaliste simple et la manufacture
5.1. La coopération capitaliste simple.
Le capitalisme se rend d’abord maître de la production telle qu’il la trouve, c’est-à-dire avec sa technique arriérée d’économie artisanale et petite-paysanne, et ce n’est que plus tard, à une phase supérieure de son développement, qu’il la transforme sur des bases économiques et techniques nouvelles.
La production capitaliste commence là où les moyens de production sont détenus par des particuliers, et où les ouvriers privés des moyens de production sont obligés de vendre leur force de travail comme une marchandise. Dans la production artisanale et dans les petites industries des paysans se forment des ateliers relativement importants, qui appartiennent aux capitalistes. Ces derniers étendent la production, sans modifier au début ni les instruments, ni les méthodes de travail des petits producteurs. Cette phase initiale du développement de la production capitaliste s’appelle la coopération capitaliste simple.
La coopération capitaliste simple est une forme de socialisation du travail dans laquelle le capitaliste exploite un nombre plus ou moins important d’ouvriers salariés occupés simultanément à un travail de même espèce. Cette coopération capitaliste simple apparaît lors de la désagrégation de la petite production marchande. Les premières entreprises capitalistes furent fondées par des marchands accapareurs, des usuriers, des maîtres-ouvriers et des artisans enrichis. Dans ces entreprises travaillaient des artisans ruinés, des apprentis, qui n’avaient plus la possibilité de devenir maîtres-ouvriers, des paysans pauvres.
La coopération capitaliste simple présente des avantages sur la petite production marchande.
La réunion de nombreux travailleurs dans une seule entreprise permet d’économiser les moyens de production. Construire, chauffer et éclairer un atelier pour vingt personnes coûte moins cher que construire et entretenir dix ateliers occupant chacun deux ouvriers. Les dépenses nécessitées par les outils, les entrepôts, le transport des matières premières et des produits finis, sont également réduites.
Le fruit du travail d’un artisan pris à part dépend dans une large mesure de ses qualités individuelles : de sa force, de son habileté, de son art, etc. Dans le cadre d’une technique rudimentaire ces différences entre travailleurs sont très grandes. Déjà de ce seul fait la situation du petit producteur est extrêmement précaire. Les producteurs qui pour la fabrication d’une marchandise d’une seule et même espèce dépensent plus de travail qu’il n’en faut dans les conditions moyennes de la production, finissent inévitablement par se ruiner. Les ouvriers étant nombreux dans un atelier, les différences individuelles entre eux s’effacent. Le travail de chaque ouvrier s’écarte dans un sens ou dans l’autre du travail social moyen, mais le travail d’ensemble de nombreux ouvriers occupés simultanément correspond plus ou moins à la moyenne du travail socialement nécessaire. De ce fait, la production et la vente des marchandises d’un atelier capitaliste deviennent plus régulières et plus stables.
La coopération simple permet une économie de travail, un accroissement de la productivité du travail.
Prenons un exemple : la transmission de briques de la main à la main par des ouvriers faisant la chaîne. Chaque travailleur accomplit ici les mêmes mouvements, mais ses actes font partie d’une seule opération commune. Résultat : le travail va beaucoup plus vite que si le transport des briques était effectué par chacun pris à part. Dix personnes travaillant ensemble produisent, pendant une journée de travail, plus que ces mêmes dix personnes travaillant isolément ou qu’une seule personne travaillant pendant dix journées de même durée.
La coopération permet de conduire des travaux simultanément sur une grande superficie, par exemple : l’assèchement de marais, la construction de barrages, de canaux, de voies ferrées ; elle permet également de dépenser sur un espace réduit une grande quantité de travail, par exemple, pour la construction d’édifices ou pour les cultures agricoles qui réclament beaucoup de travail.
La coopération a une grande importance dans les branches de la production où des travaux doivent être exécutés rapidement, par exemple, pour la rentrée des récoltes, la tonte des moutons, etc. L’emploi simultané d’un grand nombre d’ouvriers permet d’accomplir rapidement ce genre de travaux et d’éviter par là de grosses pertes.
Ainsi, la coopération a engendré une nouvelle force productive sociale du travail. Déjà la simple réunion des efforts de divers travailleurs aboutissait à l’accroissement de la productivité du travail. Cela permettait aux propriétaires des premiers ateliers capitalistes de fabriquer à meilleur compte les marchandises et de concurrencer avec succès les petits producteurs. Accaparés gratuitement par les capitalistes, les résultats de la nouvelle force productive sociale du travail servaient à leur enrichissement.
5.2. La phase manufacturière du capitalisme.
Le développement de la coopération capitaliste simple a amené la naissance des manufactures. La manufacture est la coopération capitaliste fondée sur la division du travail et la technique artisanale. La manufacture, comme forme du processus de production capitaliste, a dominé en Europe occidentale à peu près depuis la moitié du 16e siècle jusqu’au dernier tiers du 18e siècle.
Le passage à la manufacture s’est effectué selon deux voies différentes.
La première, c’est la réunion par le capitaliste, dans un seul atelier, d’artisans de différentes spécialités. C’est ainsi qu’est née, par exemple, la manufacture de la carrosserie, qui groupait dans un même local des artisans autrefois indépendants : charrons, selliers, tapissiers, serruriers, chaudronniers, tourneurs, passementiers, vitriers, peintres, vernisseurs, etc. La fabrication des carrosses comporte un grand nombre d’opérations qui se complètent les unes les autres, et dont chacune est exécutée par un ouvrier. Cela étant, le caractère antérieur du travail artisanal se modifie. Par exemple, l’ouvrier serrurier ne s’occupe alors, pendant un temps assez long, que d’une opération déterminée dans la fabrication des carrosses et cesse peu à peu d’être le serrurier qui, autrefois, fabriquait lui-même une marchandise finie.
La seconde voie, c’est la réunion par le capitaliste, dans un seul atelier, d’artisans d’une seule spécialité. Auparavant, chacun des artisans accomplissait lui-même toutes les opérations nécessitées par la fabrication d’une marchandise donnée. Le capitaliste décompose le processus de production dans l’atelier en une suite d’opérations dont chacune est confiée à un ouvrier spécialiste. C’est ainsi qu’est apparue, par exemple, la manufacture d’aiguilles. Le fil de fer y passait par les mains de 72 ouvriers et même plus : l’un étirait le fil, l’autre le redressait, un troisième le sectionnait, un quatrième taillait la pointe, etc.
La division manufacturière du travail est une division du travail à l’intérieur de l’entreprise lors de la fabrication d’une seule et même marchandise à la différence de la division du travail dans la société entre les différentes entreprises lors de la fabrication de marchandises différentes.
La division du travail à l’intérieur de la manufacture suppose la concentration des moyens de production entre les mains du capitaliste qui est en même temps le propriétaire des marchandises fabriquées. L’ouvrier salarié, contrairement au petit producteur, ne fabrique pas lui-même la marchandise ; seul le produit commun du travail de plusieurs ouvriers se convertit en marchandise. La division du travail à l’intérieur de la société suppose la dissémination des moyens de production entre des producteurs isolés, indépendants les uns des autres. Les produits de leur travail, par exemple de celui du menuisier, du peaussier, du cordonnier, du cultivateur, se présentent comme des marchandises, et le lien entre les producteurs indépendants s’établit par le marché.
L’ouvrier qui accomplit dans la manufacture une opération particulière de la fabrication d’une marchandise, devient un ouvrier parcellaire. Répétant sans cesse une opération simple, toujours la même, il dépense moins de temps et de force que l’artisan qui exécute tour à tour une série d’opérations diverses. D’autre part, avec la spécialisation, le travail devient plus intensif. Auparavant, l’ouvrier dépensait une certaine quantité de temps pour passer d’une opération à une autre, pour changer d’outil. Dans la manufacture, ces pertes de temps étaient moindres. Peu à peu la spécialisation s’est étendue non seulement à l’ouvrier, mais aussi aux instruments de production qui se perfectionnaient, s’adaptaient de plus en plus à l’opération partielle à laquelle ils étaient destinés.
Tout cela devait aboutir à un nouvel accroissement de la productivité du travail.
La fabrication des aiguilles en est un exemple frappant. Au 18e siècle, une petite manufacture avec 10 ouvriers produisait, en appliquant la division du travail, 48 000 aiguilles par jour, soit 4 800 aiguilles par ouvrier. Or, sans la division du travail, un ouvrier n’aurait même pas pu produire 20 aiguilles par jour.
La spécialisation du travail dans la manufacture, comportant la répétition constante des mêmes mouvements peu compliqués, mutilait l’ouvrier physiquement et moralement. Il y eut des ouvriers à la colonne vertébrale déviée, à la cage thoracique comprimée, etc. Ainsi, la productivité du travail dans la manufacture augmentait au prix de la mutilation de l’ouvrier.
Elle [la manufacture] estropie le travailleur, elle fait de lui quelque chose de monstrueux en activant le développement factice de sa dextérité de détail, en sacrifiant tout un monde de dispositions et d’instincts producteurs.( K. Marx, Le Capital, livre 1, t. 2, p. 49. )Les ouvriers des manufactures étaient l’objet d’une exploitation féroce. La journée de travail atteignait jusqu’à 18 heures et plus ; le salaire était extrêmement bas ; l’immense majorité des ouvriers des manufactures était sous-alimentée ; la nouvelle discipline capitaliste du travail était inculquée par des mesures implacables de coercition et de violence.
La division manufacturière du travail, écrivait Marx,
crée des circonstances nouvelles qui assurent la domination du capital sur le travail. Elle se présente donc et comme un progrès historique, une phase nécessaire dans la formation économique de la société, et comme un moyen civilisé et raffiné d’exploitation.( K. Marx, ibidem, p. 53. )Dans les sociétés esclavagiste et féodale, il existait deux formes de capital — le capital commercial et le capital usuraire.
La naissance de la production capitaliste marquait le début du capital industriel. Le capital industriel est le capital engagé dans la production des marchandises. Un des traits caractéristiques de la phase manufacturière du capitalisme est le lien étroit et indissoluble entre le capital commercial et le capital industriel. Le propriétaire d’une manufacture a presque toujours été aussi un accapareur. Il revendait les matières premières aux petits producteurs, distribuait des matériaux à domicile pour les faire transformer, ou bien il achetait aux petits producteurs des éléments d’articles manufacturés, pour les revendre. La vente des matières premières et l’achat du produit se mêlaient à une exploitation usuraire. Cela avait pour effet d’aggraver considérablement la situation du petit producteur, aboutissait à la prolongation de la journée de travail, à la baisse des salaires.
5.3. Le mode capitaliste du travail à domicile.
Dans la phase manufacturière du capitalisme, la distribution de travail à domicile prit une large extension.
Le travail à domicile pour le capitaliste consiste à transformer, pour un salaire aux pièces, les matériaux reçus de l’entrepreneur. Cette forme d’exploitation se rencontrait parfois déjà au temps de la coopération simple. Elle a lieu aussi dans la phase de la grande industrie mécanisée, mais elle caractérise précisément la manufacture. Le travail à domicile pour le capitaliste apparaît ici comme un appendice de la manufacture.
La division manufacturière du travail décomposait la production de chaque marchandise en un certain nombre d’opérations séparées. Souvent l’accapareur manufacturier trouvait avantageux de fonder un petit atelier où ne s’opérait que l’assemblage ou la finition de la marchandise. Toutes les opérations préparatoires étaient exécutées par des artisans à domicile, mais ceux-ci n’en étaient pas moins sous la dépendance absolue des capitalistes. Souvent les artisans, disséminés dans les villages, ne traitaient pas avec le propriétaire de l’atelier, mais avec des maîtres-ouvriers intermédiaires qui les exploitaient à leur tour.
Les artisans travaillant à domicile recevaient du capitaliste un salaire de beaucoup inférieur à celui de l’ouvrier occupé dans l’atelier du capitaliste. L’industrie attirait les masses de paysans que le besoin d’argent contraignait à chercher un gagne-pain auxiliaire. Pour gagner une petite somme d’argent, le paysan s’épuisait et faisait travailler tous les membres de sa famille. Une journée de travail excessivement longue, des conditions de travail nuisibles à la santé, l’exploitation la plus impitoyable, tels sont les traits distinctifs du travail capitaliste à domicile.
Ces traits sont caractéristiques des nombreux métiers artisanaux de la Russie tsariste. Les accapareurs, devenus en fait les maîtres des industries artisanales du village ou du district, pratiquaient largement la division du travail parmi les artisans. Par exemple, dans l’établissement des Zavialov, à Pavlovo (dont l’atelier d’assemblage, entre 1860 et 1870, occupait plus de 100 ouvriers) un simple canif passait par les mains de 8 à 9 artisans. Forgeron, coutelier en lames, emmancheur, trempeur, polisseur, finisseur, affileur, marqueur travaillaient à sa fabrication. Un grand nombre d’ouvriers parcellaires étaient occupés, non dans l’atelier du capitaliste, mais à domicile. De même étaient organisées la fabrication des voitures, du feutre, les industries travaillant le bois, la cordonnerie, la boutonnerie, etc.
De nombreux exemples d’exploitation féroce des artisans ont été cités par Lénine dans son ouvrage Le Développement du capitalisme en Russie. Ainsi, dans la province de Moscou, vers 1880, 37 500 ouvrières travaillaient au dévidage des filés de coton, au tricotage et à d’autres métiers de femmes. Les enfants commençaient à travailler à 5 ou 6 ans. Le salaire moyen était de 13 kopeks par jour ; la journée de travail atteignait 18 heures.
5.4. Le rôle historique de la manufacture.
La manufacture a été la transition entre la petite production artisanale et la grande industrie mécanisée. La manufacture se rapprochait de l’artisanat parce qu’elle avait à sa base la technique manuelle, et de la fabrique capitaliste, parce qu’elle était une forme de grande production fondée sur l’exploitation des ouvriers salariés.
La division manufacturière du travail représentait un grand pas en avant dans le développement des forces productives de la société. Cependant la manufacture, basée sur le travail manuel, était incapable de supplanter la petite production. Un fait est typique de la manufacture capitaliste : c’est le petit nombre des établissements relativement importants et le grand nombre de petits établissements. Les manufactures fabriquaient une partie des marchandises, mais l’immense majorité de celles-ci était fournie, comme auparavant, par les artisans qui se trouvaient, à divers degrés, sous la dépendance des accapareurs capitalistes, des distributeurs et des manufacturiers. La manufacture ne pouvait donc embrasser la production sociale dans toute son étendue. Elle était une sorte de superstructure ; la base demeurait comme avant la petite production avec sa technique rudimentaire.
Le rôle historique de la manufacture a été de préparer les conditions du passage à la production mécanique. À cet égard, trois circonstances apparaissent particulièrement importantes. Premièrement, la manufacture, en portant à un haut degré la division du travail, a simplifié beaucoup d’opérations. Elles se ramenaient à des mouvements si simples qu’il devint possible de substituer la machine à l’ouvrier. En second lieu, le développement de la manufacture a abouti à la spécialisation des instruments de travail, à leur perfectionnement considérable, ce qui a permis de passer des outils manuels aux machines. Troisièmement, la manufacture a formé des cadres d’ouvriers habiles pour la grande industrie mécanique, grâce à leur spécialisation prolongée dans l’exécution de différentes opérations.
La petite production marchande, la coopération capitaliste simple et la manufacture avec son appendice : le travail à domicile pour le capitaliste, sont actuellement très répandues dans les pays économiquement arriérés et sous-développés, tels que l’Inde, la Turquie, l’Iran, etc.
5.5. La différenciation de la paysannerie. Le passage de l’économie fondée sur la corvée à l’économie capitaliste.
Dans la phase manufacturière du développement du capitalisme, l’industrie s’est de plus en plus séparée de l’agriculture. La division sans cesse accrue du travail avait pour résultat que, non seulement les produits de l’industrie, mais aussi ceux de l’agriculture se convertissaient en marchandises. Il s’effectuait dans l’agriculture une spécialisation des régions suivant les cultures et les branches agricoles. On a vu se former des régions d’agriculture commerciale : lin, betterave à sucre, coton, tabac, lait, fromage, etc. C’est sur cette base que se développait l’échange non seulement entre l’industrie et l’agriculture, mais aussi entre les différentes branches de la production agricole.
Plus la production marchande pénétrait dans l’agriculture, et plus la concurrence se renforçait entre les agriculteurs. Le paysan tombait de plus en plus dans la dépendance du marché. Les variations spontanées des prix du marché renforçaient et aggravaient l’inégalité matérielle entre les paysans. Des disponibilités de monnaie s’accumulaient entre les mains des couches aisées de la campagne. Cette monnaie servait à asservir, à exploiter les paysans non possédants ; elle se transformait en capital. Un des moyens de cet asservissement était l’achat à vil prix des produits du travail paysan. La ruine des paysans atteignait peu à peu un tel degré que beaucoup d’entre eux étaient obligés d’abandonner totalement leur exploitation et de vendre leur force de travail.
Ainsi, avec le développement de la division sociale du travail et l’accroissement de la production marchande, s’opérait une différenciation de la paysannerie ; des rapports capitalistes s’établissaient à la campagne, on y voyait apparaître de nouveaux types sociaux de population rurale, qui formaient les classes de la société capitaliste : la bourgeoisie rurale et le prolétariat agricole.
La bourgeoisie rurale (les koulaks) pratique une économie marchande en employant le travail salarié, en exploitant les ouvriers agricoles permanents, et encore davantage les journaliers et les autres ouvriers temporaires engagés pour les travaux agricoles saisonniers. Les koulaks détiennent une part considérable de la terre (y compris la terre affermée), des bêtes de trait, des produits agricoles. Ils possèdent également des entreprises pour la transformation des matières premières, des moulins, des batteuses, des reproducteurs de race, etc. Au village, ils jouent généralement le rôle d’usuriers et de boutiquiers. Tout cela sert à exploiter les paysans pauvres et une partie considérable des paysans moyens.
Le prolétariat agricole est constitué par la masse des ouvriers salariés qui ne possèdent pas de moyens de production et sont exploités par les propriétaires fonciers et la bourgeoisie rurale. C’est de la vente de sa propre force de travail que le prolétaire agricole tire surtout sa subsistance. Le représentant typique du prolétariat rural est l’ouvrier salarié pourvu d’une parcelle de terre. L’exploitation de son minuscule lopin de terre, l’absence de bêtes de trait et de matériel agricole contraignent fatalement ce paysan à vendre sa force de travail.
Le paysan pauvre s’apparente au prolétariat agricole. Il possède peu de terre et peu de bétail. Le blé qu’il produit ne suffit pas à le nourrir. L’argent nécessaire pour manger, se vêtir, pour tenir le ménage et payer les impôts, il est obligé de le gagner surtout en se louant. Il a déjà cessé ou presque d’être son maître pour devenir un semi-prolétaire rural. Le niveau de vie du paysan pauvre, comme celui du prolétaire rural, est très bas et même inférieur à celui de l’ouvrier industriel. Le développement du capitalisme dans l’agriculture aboutit à grossir de plus en plus les rangs du prolétariat rural et de la paysannerie pauvre.
La paysannerie moyenne occupe une position intermédiaire entre la bourgeoisie rurale et les paysans pauvres.
Le paysan moyen exploite son terrain sur la base de ses propres moyens de production et de son travail personnel. Le travail qu’il fournit ne pourvoit à l’entretien de sa famille que si les conditions sont favorables. De là sa situation précaire.
Par ses rapports sociaux, ce groupe oscille entre le groupe supérieur — autour duquel il gravite et où seule une faible minorité de favorisés réussit à pénétrer —, et le groupe inférieur où le pousse toute l’évolution sociale.
( V. Lénine, « Le développement du capitalisme en Russie », Œuvres, t. 3, p. 188. )Et c’est la ruine, le « lessivage » de la paysannerie moyenne.
Les rapports capitalistes dans l’agriculture des pays bourgeois s’entremêlent avec des survivances du servage. La bourgeoisie, en accédant au pouvoir, n’a pas supprimé dans la plupart des pays la grande propriété féodale. Les exploitations des propriétaires fonciers s’adaptaient progressivement au capitalisme. La paysannerie, libérée du servage, mais dépouillée d’une notable partie des terres, étouffait du manque de terre. Elle se vit obligée d’en louer au propriétaire foncier à des conditions asservissantes.
En Russie, par exemple, après la réforme de 1861, la forme d’exploitation la plus répandue des paysans par les propriétaires fonciers était la redevance en travail : le paysan, à titre de fermage ou pour acquitter un emprunt de servitude, était astreint à travailler sur le domaine du propriétaire foncier, en employant ses propres moyens de production, ses animaux de trait et son matériel primitif.
La différenciation de la paysannerie sapait les fondements de l’économie féodale fondée sur les redevances en travail, sur l’exploitation du paysan économiquement dépendant, sur une technique arriérée. Le paysan aisé pouvait louer de la terre contre de l’argent ; aussi n’avait-il pas besoin d’un bail asservissant pour faire face aux redevances. Le paysan pauvre ne pouvait pas non plus s’adapter à ces redevances, mais cette fois pour une autre raison : n’ayant pas de moyens de production, il devenait ouvrier salarié. Le propriétaire foncier pouvait utiliser principalement pour les redevances en travail la paysannerie moyenne. Mais le développement de l’économie marchande et de l’agriculture commerciale en ruinant la paysannerie moyenne, sapait le mode d’exploitation fondé sur les redevances ou prestations. Les propriétaires fonciers multipliaient l’emploi du travail salarié, qui était plus productif que le travail du paysan dépendant ; l’importance du système capitaliste d’exploitation augmentait, tandis que celle du système des redevances déclinait. Mais les redevances, en tant que survivance directe de la corvée, demeurent encore longtemps à côté du système d’exploitation capitaliste.
5.6. La formation du marché intérieur pour l’industrie capitaliste.
Avec le développement du capitalisme dans l’industrie et dans l’agriculture, se formait un marché intérieur.
Déjà dans la phase manufacturière, une série de nouvelles branches de la production industrielle avaient fait leur apparition. De l’agriculture se détachaient l’une après l’autre les différentes formes de traitement industriel des matières premières agricoles. Parallèlement au progrès de l’industrie augmentait la demande des produits agricoles. Le marché prenait donc de l’extension ; les régions qui s’étaient spécialisées, par exemple, dans la production du coton, du lin, de la betterave à sucre, de même que dans l’élevage du bétail de rapport, demandaient du blé. L’agriculture augmentait sa demande d’articles industriels variés.
Le marché intérieur pour l’industrie capitaliste se crée grâce au développement même du capitalisme, par la différenciation des petits producteurs.
La séparation du producteur direct d’avec les moyens de production, c’est-à-dire son expropriation, qui marque le passage de la simple production marchande à la production capitaliste (et qui constitue la condition indispensable de ce passage), crée le marché intérieur.
( V. Lénine, « Le développement du capitalisme en Russie », Œuvres, t. 3, p. 60. )La création du marché intérieur revêtait un double caractère. D’une part, la bourgeoisie des villes et des campagnes présentait une demande de moyens de production : instruments perfectionnés de travail, machines, matières premières, etc. nécessaires pour agrandir les entreprises capitalistes existantes et en construire de nouvelles. Elle accroissait également sa demande d’objets de consommation. D’autre part, l’augmentation des effectifs du prolétariat industriel et agricole, étroitement liée à la différenciation de la paysannerie, s’accompagnait d’une demande accrue de marchandises constituant les moyens de subsistance de l’ouvrier.
Les manufactures, fondées sur une technique primitive et sur le travail manuel, étaient incapables de satisfaire la demande croissante de marchandises industrielles que présentait le marché en extension. C’était une nécessité économique de passer à la grande production mécanisée.
Résumé du chapitre 5
-
La coopération capitaliste simple est une forme de production fondée sur l’exploitation par le capitaliste isolé d’un nombre plus ou moins important d’ouvriers salariés occupés simultanément à un travail identique. Elle permettait d’économiser les moyens de production, créait une nouvelle force sociale productive du travail, diminuait la dépense de travail par unité de produit fabriqué. Les résultats de l’augmentation de la force productive du travail social étaient accaparés gratuitement par les capitalistes.
-
La manufacture est la grande production capitaliste, fondée sur la technique manuelle et la division du travail entre ouvriers salariés. La division manufacturière du travail augmentait sensiblement la productivité du travail et mutilait du même coup l’ouvrier salarié, qu’elle vouait à un développement extrêmement unilatéral. La manufacture a créé les conditions nécessaires au passage à la grande industrie mécanique.
-
Le développement de la production marchande aboutit à la différenciation de la paysannerie. Les couches supérieures peu nombreuses de la campagne rejoignent les rangs de la bourgeoisie ; une partie importante des paysans rejoint les rangs du prolétariat urbain et rural ; la masse des paysans pauvres augmente ; la vaste couche intermédiaire de la paysannerie moyenne se ruine. La différenciation de la paysannerie sape les fondements du système des redevances en travail. Les propriétaires fonciers passent de plus en plus de l’exploitation par corvées à l’exploitation capitaliste.
-
C’est le développement du capitalisme lui-même qui crée le marché intérieur. L’extension du marché intérieur signifiait une demande croissante de moyens de production et de moyens de subsistance. La manufacture fondée sur une technique arriérée et sur le travail manuel était incapable de satisfaire la demande de marchandises industrielles que présentait le marché en extension. La nécessité s’affirme de passer à l’industrie mécanique.
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par Pcautunois le 17 Avril 2011 à 16:59
A. — Le capitalisme prémonopoliste
Chapitre 6 — La phase du machinisme sous le capitalisme
6.1. Le passage de la manufacture à l’industrie mécanique.
Tant que la production avait pour base le travail manuel, comme ce fut le cas dans la phase manufacturière, le capitalisme ne pouvait réaliser une révolution radicale de toute la vie économique de la société. Cette révolution se fit lors du passage de la manufacture à l’industrie mécanique, qui naquit dans le dernier tiers du 18e siècle et se développa dans les pays capitalistes les plus importants de l’Europe et aux États-Unis, au cours du 19e siècle.
La base technique et matérielle de cette révolution fut la machine.
Tout ensemble de machines perfectionné comporte trois parties : 1o le moteur ; 2o le mécanisme de transmission ; 3o la machine d’opération ou machine-outil.
Le moteur donne l’impulsion à tout le mécanisme. Il engendre lui-même la force motrice (par exemple, la machine à vapeur), ou la reçoit du dehors, d’une force naturelle toute prête (par exemple, la roue hydraulique mise en mouvement par la puissance d’une chute d’eau).
Le mécanisme de transmission comporte toutes sortes de dispositifs (transmissions, engrenages, courroies, fils électriques, etc.), qui règlent le mouvement, en modifient en cas de nécessité la forme (par exemple, le changent de rectiligne en circulaire), le distribuent et le transmettent à la machine d’opération. Le moteur comme le mécanisme de transmission mettent en mouvement la machine d’opération.
La machine-outil agit directement sur l’objet du travail et y produit les modifications nécessaires selon le but assigné. Si l’on examine de près la machine-outil, on peut y trouver en général, quoique souvent sous une forme sensiblement modifiée, les mêmes instruments dont on se sert pour le travail manuel. Mais en tout état de cause, ce ne sont plus des instruments de travail manuel, mais des mécanismes, des instruments mécaniques. La machine-outil a été le point de départ d’une révolution qui a amené la substitution de la production mécanique à la manufacture. Après l’invention des instruments mécaniques, des changements radicaux se sont produits dans la structure des moteurs et des mécanismes de transmission.
Dans sa course au profit, le capital a acquis, avec la machine, un puissant moyen pour augmenter la productivité du travail.
Premièrement, l’emploi des machines qui actionnent simultanément une multitude d’outils, a libéré le processus de la production de son cadre étroit déterminé par le caractère limité des organes humains. En second lieu, l’emploi des machines a permis pour la première fois d’utiliser dans le processus de la production d’immenses sources nouvelles d’énergie : la force motrice de la vapeur, du gaz et de l’électricité. Troisièmement l’emploi des machines a permis au capital de mettre au service de la production la science qui étend le pouvoir de l’homme sur la nature et ouvre des possibilités toujours nouvelles d’augmenter la productivité du travail. C’est sur la base de la grande industrie mécanique que s’est affirmée la domination du mode de production capitaliste. Avec la grande industrie mécanique le capitalisme acquiert la base matérielle et technique qui lui correspond.
6.2. La révolution industrielle.
C’est en Angleterre que la grande industrie mécanique a son origine. Il s’est formé dans ce pays des conditions historiques favorables à un prompt développement du mode de production capitaliste : le servage aboli de bonne heure et la liquidation du morcellement féodal, la victoire de la révolution bourgeoise au 17e siècle, le dépouillement du paysan de sa terre, ainsi que l’accumulation de capitaux au moyen d’un commerce très développé et du pillage des colonies.
Au milieu du 18e siècle, l’Angleterre possédait un grand nombre de manufactures. La branche la plus importante de l’industrie était la production textile. C’est à partir de cette branche qu’a commencé la révolution industrielle en Angleterre, au cours du dernier tiers du 18e et du premier quart du 19e siècle.
L’agrandissement du marché et la course aux profits engagée par les capitalistes ont déterminé la nécessité de perfectionner la technique de la production.
Dans l’industrie cotonnière, qui s’est développée plus vite que les autres branches de production, prédominait le travail manuel. Le filage et le tissage sont les principales opérations de l’industrie cotonnière. Le produit du travail des fileurs sert d’objet de travail aux tisseurs. La demande accrue des étoffes de coton s’est fait sentir tout d’abord sur la technique du tissage : en 1733 a été inventée la navette volante, qui a doublé la productivité du travail du tisseur. Cela a déterminé un retard du filage sur le tissage. Dans les manufactures, les métiers à tisser ont eu souvent des arrêts par manque de filés. L’amélioration de la technique du filage devint un besoin urgent.
Le problème fut résolu grâce à l’invention (en 1705-1767) des machines à filer, dont chacune possédait une quinzaine ou une vingtaine de broches. La force motrice des premières machines était l’homme lui-même ou les bêtes de trait ; ensuite, il y eut des machines actionnées parla force hydraulique. Les perfectionnements techniques ultérieurs permirent non seulement d’augmenter la production des filés, mais encore d’en améliorer la qualité. À la fin du 18e siècle existaient déjà des machines à filer comptant 400 broches. Ces inventions ont permis d’augmenter sensiblement la productivité du travail dans le filage.
Une nouvelle disproportion s’est manifestée alors dans l’industrie cotonnière : le filage avait gagné de vitesse le tissage. Disproportion qui fut éliminée grâce à l’invention en 1735 du métier à tisser mécanique. Après une série de perfectionnements, ce métier a pris de l’extension en Angleterre et, vers 1840, il a supplanté entièrement le tissage à la main. Le mode de traitement des tissus — blanchiment, teinture, impression — a lui aussi foncièrement changé. L’application de la chimie a eu pour effet de diminuer la durée de ces opérations et d’améliorer la qualité du produit.
Les premières fabriques textiles ont été implantées le long des cours d’eau, et les machines étaient mises en action au moyen de roues hydrauliques. Ceci limitait notablement les possibilités d’application du machinisme. Il fallait un nouveau moteur, qui ne dépendît ni de la localité ni de la saison. Ce fut la machine à vapeur.
La machine à vapeur sous sa forme primitive fut inventée dès la phase manufacturière du capitalisme et entre 1711 et 1712 commença à être employée dans l’industrie minière anglaise pour actionner les pompes installées dans les mines. La révolution industrielle en Angleterre provoqua le besoin d’un moteur à vapeur universel. Ce problème fut résolu en Angleterre vers 1780 par le perfectionnement de la machine à vapeur.
L’emploi de la machine à vapeur eut une importance énorme. C’est un moteur exempt des nombreux défauts propres au moteur hydraulique. Consommant le combustible et l’eau, la machine à vapeur produit une force motrice entièrement soumise au contrôle de l’homme. Cette machine est mobile ; elle permet à l’industrie de ne plus être tributaire des sources naturelles d’énergie et donne la possibilité de concentrer la production dans n’importe quel endroit.
L’emploi de la machine à vapeur s’est rapidement généralisé non seulement en Angleterre, mais aussi au-delà de ses frontières, créant ainsi les conditions nécessaires à l’apparition de fabriques importantes dotées d’une multitude de machines et comptant un grand nombre d’ouvriers.
Les machines ont révolutionné la production dans toutes les branches de l’industrie. Elles ont été mises en place non seulement dans l’industrie cotonnière, mais aussi dans l’industrie de la laine, du lin et de la soie. On découvrit peu après les procédés d’utilisation de la machine à vapeur dans les transports : en 1807, aux États-Unis, fut créé le premier bateau à vapeur et, en 1825, on construisit en Angleterre la première voie ferrée.
Au début, les machines furent fabriquées dans les manufactures au moyen du travail manuel. Elles revenaient cher et n’étaient pas suffisamment puissantes ni parfaites. Les manufactures ne pouvaient fabriquer la quantité de machines nécessaire au développement rapide de l’industrie. Le problème fut résolu par le passage à la production mécanique des machines. Une nouvelle branche de l’industrie apparut, qui se développa rapidement : les constructions mécaniques. Les premières machines étaient fabriquées surtout en bois. Ensuite, les pièces de bois furent remplacées par des pièces métalliques, ce qui permit d’augmenter la durée et la solidité des machines et de travailler avec une vitesse et une intensité inconnues jusque là. Au début du 19e siècle, on inventa des marteaux-pilons, des presses, des machines-outils pour le travail des métaux : le tour, ensuite la fraiseuse et la perceuse.
La fabrication de machines, locomotives, rails, bateaux nécessita des quantités énormes de fer et d’acier. La métallurgie fit des progrès rapides. Le développement de la métallurgie fut considérablement favorisé par la découverte des procédés de fonte des minerais de fer au combustible minéral au lieu du bois. Les hauts fourneaux se perfectionnèrent sans cesse. À partir de 1830, le soufflage à froid a été remplacé par le soufflage à chaud, ce qui accélérait les opérations dans les hauts fourneaux et fournissait une importante économie de combustible. On découvrit de nouveaux procédés, plus perfectionnés de production de l’acier. L’extension de la machine à vapeur, les progrès de la métallurgie réclamèrent d’importantes quantités de houille, ce qui amena un accroissement rapide de l’industrie houillère.
La révolution industrielle fit de l’Angleterre l’atelier industriel du monde. Après l’Angleterre, la production mécanique se répandit dans les autres pays d’Europe et en Amérique.
La révolution industrielle se poursuivit en France pendant des dizaines d’années à la suite de la révolution bourgeoise de 1789-1794. La situation dominante dans l’industrie de ce pays n’appartint à la fabrique capitaliste que dans la seconde moitié du 19e siècle.
En Allemagne, par suite du morcellement féodal et du maintien prolongé des rapports féodaux, la révolution industrielle se fit plus tard qu’en Angleterre et en France. La grande industrie ne commença à se développer qu’à partir de 1840 et particulièrement vite après l’unification de l’Allemagne en un seul État, en 1871.
Aux États-Unis, la grande industrie naquit au début du 19e siècle. L’industrie mécanique américaine se développa rapidement au lendemain de la guerre civile de 1861-1865. Et l’on utilisa sur une grande échelle les réalisations techniques de l’industrie anglaise, ainsi que l’afflux des capitaux disponibles et des cadres d’ouvriers qualifiés venus d’Europe.
En Russie, le passage de la manufacture à la phase de la production mécanique commença ayant l’abolition du servage, et prit toute son ampleur dans les premières décennies qui suivirent la réforme paysanne de 1861. Cependant, même après la disparition du servage, de nombreuses survivances de la féodalité retardèrent le passage de la production manuelle au machinisme. Cela se fit sentir surtout dans l’industrie minière de l’Oural.
6.3. L’industrialisation capitaliste.
La révolution industrielle marque le début de l’industrialisation capitaliste. L’industrie lourde, la production des moyens de production forme la base de l’industrialisation.
L’industrialisation capitaliste s’opère spontanément dans la poursuite du profit par les capitalistes. Le développement de la grande industrie capitaliste commence généralement par le développement de l’industrie légère, c’est-à-dire des branches produisant les objets de consommation individuelle. Ces branches demandent moins d’investissements, la rotation du capital y est plus rapide que dans l’industrie lourde, c’est-à-dire dans les branches d’industrie produisant les moyens de production : machines, métaux, combustibles. Le développement de l’industrie lourde ne commence qu’après une période pendant laquelle l’industrie légère accumule des profits. Ceux-ci sont progressivement attirés par l’industrie lourde. Ainsi donc, l’industrialisation capitaliste constitue un processus qui dure des dizaines et des dizaines d’années.
En Angleterre, par exemple, l’industrie textile resta pendant longtemps la principale et la plus développée des branches industrielles. Dans la seconde moitié du 19e siècle, c’est l’industrie lourde qui commence à jouer le rôle dominant. On constate le même type de développement des branches industrielles dans les autres pays capitalistes.
Dans la seconde moitié du 19e siècle, la métallurgie continua à se développer ; la technique de la fonte des métaux s’améliorait, la dimension des hauts fourneaux augmentait. La production de fonte se développait rapidement. En Angleterre, elle passait de 193 000 tonnes en 1800 à 2 285 000 tonnes en 1850, 6 059 000 tonnes en 1870 et 7 873 000 tonnes en 1880 ; aux États-Unis, de 41 000 tonnes en 1800 à 573 000 tonnes en 1850, 1 692 000 tonnes en 1870 et 3 897 000 tonnes en 1880.
Jusqu’au dernier tiers du 19e siècle, la machine à vapeur demeura le seul moteur employé dans la grande industrie et les transports. La vapeur a joué un rôle considérable dans le développement de l’industrie mécanique. Durant tout le 19e siècle se poursuivit le perfectionnement de la machine à vapeur : sa puissance augmentait, de même que le coefficient d’utilisation de l’énergie thermique. Après 1880 on créa la turbine à vapeur. Grâce à ses avantages, elle commença à évincer dans une série d’industries la machine à vapeur.
Mais plus la grande industrie se développait, et plus vite se manifestait l’insuffisance de la vapeur en tant que force motrice. On inventa un nouveau type de moteur, le moteur à combustion interne, d’abord à gaz (1877), puis un moteur fonctionnant au combustible liquide, le diesel (1893). Le dernier tiers du 19e siècle voit paraître, dans la vie économique, une force nouvelle et puissante, qui devait révolutionner encore davantage la production : l’électricité.
Au 19e siècle, le système mécanique gagne une industrie après l’autre. L’industrie minière — minerais, houille, — se développe. À la suite de l’invention du moteur à combustion interne, l’extraction du pétrole augmente. L’industrie chimique prend un large développement. L’accroissement rapide de la grande industrie mécanique s’accompagne d’une construction intense des voies ferrées.
L’industrialisation capitaliste se réalise au prix de l’exploitation des ouvriers salariés et de la ruine de la paysannerie de chaque pays, de même que par la spoliation des travailleurs des autres pays, notamment des colonies. Elle conduit inéluctablement à l’aggravation des contradictions du capitalisme, à l’appauvrissement de millions d’ouvriers, de paysans et d’artisans.
L’histoire fait apparaître différents moyens d’industrialisation capitaliste. Le premier est la mainmise sur les colonies et leur pillage. C’est ainsi que s’est développée l’industrie anglaise. Après s’être emparée de colonies dans toutes les parties du monde, l’Angleterre en a tiré, durant deux siècles, d’énormes profits qu’elle investissait dans son industrie. Le deuxième moyen est la guerre et les contributions prélevées par les pays vainqueurs sur les pays vaincus. Ainsi l’Allemagne, après avoir écrasé la France dans la guerre de 1870, la contraignit à payer cinq milliards de francs de contributions, qu’elle investit dans son industrie. Le troisième moyen, ce sont les concessions et les emprunts de servitude, qui mettent les pays arriérés sous la dépendance économique et politique des pays capitalistes développés. La Russie tsariste, par exemple, a accordé des concessions et s’est fait consentir des emprunts par les puissances occidentales à des conditions asservissantes, cherchant ainsi à s’engager progressivement dans la voie de l’industrialisation.
Dans l’histoire des différents pays, ces moyens d’industrialisation capitaliste se sont souvent enchevêtrés pour se compléter les uns les autres. L’histoire du développement économique des États-Unis en est un exemple. La grande industrie des États-Unis a été créée au moyen d’emprunts extérieurs et de crédits à long terme, et aussi par un pillage effréné de la population autochtone de l’Amérique.
Malgré les progrès de l’industrie mécanique dans les pays bourgeois, une grande partie de la population du monde capitaliste continue à vivre et à travailler avec la technique primitive du travail à la main.
6.4. Le développement des villes et des centres industriels. La formation de la classe des prolétaires.
L’industrialisation capitaliste a déterminé la croissance rapide des villes et des centres industriels. Au cours du 19e siècle, le nombre des grandes villes d’Europe (avec une population de plus de 100 000 habitants) a été multiplié par 7. La part de la population urbaine s’est constamment accrue aux dépens de la population rurale. En Angleterre, dès le milieu du 19e siècle, et en Allemagne au début du 20e siècle, plus de la moitié de la population se trouvait concentrée dans les villes.
Dans la phase manufacturière du capitalisme, les masses d’ouvriers salariés ne formaient pas encore une classe de prolétaires bien constituée. Les ouvriers des manufactures étaient relativement peu nombreux, liés pour une bonne part à l’agriculture, disséminés dans une multitude de petits ateliers et divisés par toutes sortes d’intérêts corporatifs étroits.
La révolution industrielle et le développement de l’industrie mécanique donnèrent naissance dans les pays capitalistes au prolétariat industriel. La classe ouvrière, dont les rangs grossissaient sans cesse par l’afflux de paysans et artisans en train de se ruiner, vit ses effectifs se multiplier rapidement. L’essor de la grande industrie mécanique fit disparaître peu à peu les intérêts et les préjugés locaux, corporatifs et de caste, des premières générations d’ouvriers, leurs espoirs utopiques de reconquérir la condition de petit artisan du Moyen âge. Les masses ouvrières se fondaient en une seule classe, le prolétariat. Définissant la formation du prolétariat en tant que classe, Engels écrivait :
Seul le développement de la production capitaliste, de l’industrie et de l’agriculture modernes dans de grandes proportions, a pu conférer un caractère de constance à son existence, l’a numériquement augmenté et formé en tant que classe particulière, avec ses intérêts particuliers et sa mission historique particulière.
( F. Engels, « Le mouvement ouvrier en Amérique », dans K. Marx et F. Engels, Œuvres, t. 16, 1re partie, p. 287 (éd. russe). )En Angleterre, le nombre des ouvriers dans l’industrie et les transports dans la seconde décennie du 19e siècle s’élevait à près de 2 millions d’individus ; au cours des cent années suivantes, il a plus que triplé.
En France, il y avait deux millions d’ouvriers dans l’industrie et les transports vers 1860, et au début du 20e siècle leur nombre atteignait environ 3 800 000 hommes.
Aux États-Unis, le nombre des ouvriers dans l’industrie et les transports était de 1 800 000 en 1859 et 6 800 000 en 1899.
En Allemagne, le nombre des ouvriers occupés dans l’industrie et les transports passe de 700 000 en 1848 à 5 millions en 1895.
En Russie, après l’abolition du servage, le processus de formation de la classe ouvrière se développe rapidement. En 1865, les grandes fabriques et usines, l’industrie minière et les chemins de fer occupent 700 000 ouvriers ; en 1890, 1 433 000. En 25 ans, le nombre des ouvriers dans les grandes entreprises capitalistes a donc plus que doublé. Vers 1900, dans les cinquante provinces de la Russie d’Europe, le nombre des ouvriers des grandes fabriques et usines, de l’industrie minière et des chemins de fer s’élève à 2 207 000 et dans toute la Russie, à 2 792 000.
6.5. La fabrique capitaliste. La machine comme moyen d’exploitation du travail salarié par le capital.
La fabrique capitaliste est une grande entreprise industrielle, fondée sur l’exploitation des ouvriers salariés et faisant usage d’un système de machines pour la production de marchandises.
Un système de machines est un ensemble de machines-outils accomplissant simultanément les mêmes opérations (par exemple, les métiers à tisser de même espèce), ou un ensemble de machines-outils d’espèces différentes, mais complémentaires les unes des autres. Le système de machines d’espèces différentes est une combinaison de machines-outils parcellaires, fondée sur la division des opérations entre elles. Chaque machine parcellaire fournit du travail à une autre machine. Comme toutes ces machines fonctionnent simultanément, le produit se trouve sans cesse à des degrés divers du processus de production, passant d’une phase à l’autre.
L’emploi des machines assure un accroissement considérable de la productivité du travail et un abaissement de la valeur de la marchandise. La machine permet de produire la même quantité de marchandises avec une dépense de travail beaucoup moindre, ou de produire avec la même dépense de travail une quantité sensiblement plus grande de marchandises.
Au 19e siècle, pour transformer une même quantité de coton en filés au moyen d’une machine, il fallait 180 fois moins de temps de travail qu’avec un rouet. Au moyen de la machine, un ouvrier adulte ou un adolescent imprimait par heure autant de cotonnade à quatre couleurs que 200 ouvriers adultes, autrefois, travaillant à la main. Au 18e siècle, avec la division manufacturière du travail, un ouvrier produisait par jour 4 800 aiguilles ; au 19e siècle un ouvrier, travaillant simultanément sur 4 machines, fabriquait jusqu’à 600 000 aiguilles par jour.
Avec le mode de production capitaliste, tous les avantages que procure l’emploi des machines deviennent la propriété des possesseurs de ces machines, les capitalistes, dont les profits augmentent.
La fabrique est la forme supérieure de la coopération capitaliste. La coopération capitaliste étant un travail accompli en commun à une échelle relativement importante, rend nécessaires les fonctions particulières d’administration, de surveillance, de coordination des différents travaux. Dans l’entreprise capitaliste, la fonction d’administration est réalisée par le capitaliste ; elle possède des traits spécifiques, s’affirmant en même temps comme fonction d’exploitation des ouvriers salariés par le capital. Le capitaliste n’est pas capitaliste parce qu’il administre une entreprise industrielle ; au contraire, il devient dirigeant d’une entreprise parce qu’il est capitaliste.
Déjà avec la coopération simple, le capitaliste se libère du travail physique. La coopération du travail étant réalisée à une plus grande échelle, il se libère aussi de la fonction de surveillance directe et constante des ouvriers. Ces fonctions sont confiées à une catégorie particulière de travailleurs salariés, administrateurs et contremaîtres, qui commandent dans l’entreprise au nom du capitaliste. Par son caractère, l’administration capitaliste est despotique.
Avec le passage à la fabrique s’achève la création par le capital d’une discipline particulière, la discipline capitaliste du travail. C’est la discipline de la faim. Avec elle l’ouvrier, constamment menacé de renvoi, vit dans la crainte de se retrouver dans les rangs des chômeurs. Une discipline de caserne est le propre de la fabrique capitaliste. Les ouvriers sont frappés d’amendes et de retenues sur le salaire.
La machine est par elle-même un puissant moyen pour alléger le travail et en augmenter le rendement. Mais en régime capitaliste, la machine sert à renforcer l’exploitation du travail salarié.
Dès son introduction, la machine devient le concurrent de l’ouvrier. L’emploi capitaliste des machines prive tout d’abord de moyens de subsistance, des dizaines et des centaines de milliers d’ouvriers manuels, devenus inutiles. Ainsi, avec l’introduction en grand des métiers à tisser à vapeur, 800 000 tisserands anglais ont été jetés à la rue. Des millions de tisserands de l’Inde ont été voués à la famine et à la mort, car les tissus indiens faits à la main ne pouvaient résister à la concurrence des tissus anglais de fabrication mécanique. L’emploi accru des machines et leur perfectionnement évincent une quantité toujours plus grande d’ouvriers salariés, les mettent à la porte de la fabrique capitaliste et ils viennent grossir l’armée toujours plus nombreuse des chômeurs.
La machine simplifie le processus de production, rend inutile l’emploi d’une grande force musculaire. Aussi, avec Je passage au machinisme le capital fait-il participer largement à la production femmes et enfants. Le capitaliste les fait travailler dans de dures conditions pour un salaire de misère. Cela entraîne une mortalité infantile élevée dans les familles ouvrières, la mutilation physique et morale des femmes et des enfants.
La machine crée de grandes possibilités pour réduire le temps de travail nécessaire à la production d’une marchandise, créant ainsi les conditions favorables à la réduction de la journée de travail. Cependant en régime capitaliste elle est un moyen de prolonger la durée de la journée de travail. Dans sa course aux profits, le capitaliste cherche à utiliser au maximum la machine. En premier lieu, plus l’action utile de la machine est longue dans le courant de la journée de travail, et plus vite elle s’amortit. En second lieu, plus longue est la journée de travail et plus complète est l’utilisation de la machine, moins on risque de la voir vieillir au point de vue technique et de voir d’autres capitalistes réussir à introduire chez eux des machines plus perfectionnées ou moins coûteuses, ce qui les ferait bénéficier de conditions plus avantageuses de fabrication. Aussi bien le capitaliste cherche-t-il à prolonger au maximum la journée de travail.
La machine aux mains du capitaliste est utilisée pour tirer de l’ouvrier plus de travail dans un temps donné. L’intensité excessive du travail, l’exiguïté des locaux industriels, le manque d’air et de lumière, l’absence des mesures nécessaires à la protection du travail entraînent l’apparition massive de maladies professionnelles, ruinent la santé et raccourcissent la vie des ouvriers.
Le machinisme ouvre un large champ à l’utilisation de la science, dans le cours de la production ; il permet d’utiliser davantage dans le travail les facultés intellectuelles et créatrices. Mais l’emploi capitaliste des machines fait de l’ouvrier un appendice de la machine. Il ne lui reste qu’un travail physique uniforme et exténuant. Le travail intellectuel devient le privilège de travailleurs spécialisés : ingénieurs, techniciens, savants. La science passe au service du capital. En régime capitaliste l’opposition entre le travail manuel et le travail intellectuel devient de plus en plus profonde.
La machine marque le pouvoir accru de l’homme sur les forces de la nature. En augmentant la productivité du travail, la machine augmente la richesse de la société. Mais cette richesse va aux capitalistes, tandis que la condition de la classe ouvrière — principale force productive de la société — s’aggrave sans cesse.
Marx a prouvé dans son Capital que ce ne sont pas les machines par elles-mêmes qui sont l’ennemi de la classe ouvrière, mais le régime capitaliste sous lequel elles sont employées. Il disait que
la machine… moyen infaillible pour raccourcir le travail quotidien… le prolonge entre les mains capitalistes… ; triomphe de l’homme sur les forces naturelles, elle devient entre les mains capitalistes l’instrument de l’asservissement de l’homme à ces mêmes forces… ; baguette magique pour augmenter la richesse du producteur, elle l’appauvrit entre les mains capitalistes.( K. Marx, Le Capital, livre 1, t. 2, p. 122. )Dès l’apparition des rapports capitalistes, commence la lutte de classes entre ouvriers salariés et capitalistes. Elle se poursuit durant toute la période manufacturière, et lorsque apparaît la production mécanique elle prend une grande ampleur et une acuité sans précédent.
La première expression de la protestation du mouvement ouvrier à ses débuts contre les conséquences néfastes de l’emploi capitaliste de la technique mécanique, a été la tentative de détruire les machines. Inventée en 1758, la première tondeuse a été brûlée par les ouvriers qui, avec l’introduction de cette machine, étaient restés sans travail. Au début du 19e siècle, dans les comtés industriels d’Angleterre, s’est développé un vaste mouvement de «briseurs de machines», dirigé tout d’abord contre le métier à tisser à vapeur. Il fallut à la classe ouvrière un certain temps et une certaine expérience pour se rendre compte que l’oppression et la misère ne provenaient pas des machines, mais de leur usage capitaliste.
Les capitalistes ont largement utilisé la machine comme instrument de répression des soulèvements périodiques des ouvriers, des grèves, etc., dirigés contre l’arbitraire du capital. Après 1830, un nombre important d’inventions en Angleterre n’ont dû leur apparition qu’aux intérêts de la lutte de classe des capitalistes contre les ouvriers, aux efforts des capitalistes pour briser la résistance opposée par les ouvriers à l’oppression du capital, en réduisant le nombre des ouvriers qu’ils employaient et en utilisant une main-d’œuvre moins qualifiée.
Ainsi l’usage capitaliste des machines aggrave la situation des ouvriers, ainsi que les contradictions de classes entre le travail et le capital.
6.6. La grande industrie et l’agriculture.
Le développement de la grande industrie entraîna aussi remploi des machines dans l’agriculture. La possibilité de faire usage des machines est un des avantages les plus importants de la grande production agricole. Les machines élèvent énormément la productivité du travail dans l’agriculture. Mais elles ne sont pas à la portée de la petite exploitation paysanne, car pour en faire l’achat, il faut disposer de sommes considérables. L’emploi de la machine peut être efficace dans les grandes exploitations possédant de grandes surfaces emblavées, introduisant, dans la production, les cultures industrielles, etc. Dans les grandes exploitations, fondées sur l’utilisation des machines, les dépenses de travail par unité de production sont sensiblement inférieures à celles des petites exploitations paysannes, fondées sur une technique arriérée et le travail manuel. Il s’ensuit que la petite exploitation paysanne ne peut soutenir la concurrence de la grande exploitation capitaliste. L’emploi des machines agricoles accélère, dans le cadre du capitalisme, le processus de différenciation de la paysannerie.
L’emploi systématique des machines dans l’agriculture élimine le paysan « moyen » patriarcal aussi inexorablement que le métier à vapeur élimine le tisseur-artisan travaillant sur son métier à main.
( V. Lénine, « Le développement du capitalisme en Russie », Œuvres, t. 3, p. 240. )Le capitalisme, en faisant progresser la technique agricole, ruine la masse des petits producteurs. De plus, la main-d’œuvre salariée dans l’agriculture est tellement bon marché que beaucoup de grandes exploitations n’emploient pas de machines ; elles préfèrent se servir de la main-d’œuvre manuelle. Cela retarde le développement du machinisme dans la production agricole.
L’usage capitaliste des machines dans l’agriculture s’accompagne nécessairement d’une exploitation accrue du prolétariat agricole par l’intensification du travail. Par exemple, une espèce de moissonneuse largement répandue à un moment donné a reçu en russe le nom de « lobogreïka » (chauffe-front), parce qu’il fallait un gros effort physique pour la faire fonctionner.
Dans la période du machinisme capitaliste s’achève la séparation de l’industrie et de l’agriculture, s’approfondit et s’aggrave l’opposition entre la ville et la campagne. En régime capitaliste, l’agriculture retarde de plus en plus dans son développement sur l’industrie. Lénine disait que l’agriculture des pays capitalistes au début du 20e siècle par son niveau technique et économique, était plutôt voisine de la phase manufacturière.
L’introduction du machinisme dans la production agricole en régime capitaliste s’opère avec beaucoup plus de lenteur que dans l’industrie. Si le moteur à vapeur a permis des transformations techniques fondamentales dans l’industrie, il n’a pu être utilisé dans l’agriculture que sous forme de batteuse à vapeur. Plus tard la batteuse mécanique complexe mènera de front les opérations de battage, de nettoyage et de triage du grain. Ce n’est que dans le dernier quart du 19e siècle qu’apparaissent les machines à récolter le blé à traction hippomobile : les moissonneuses-lieuses. Le tracteur à chenilles a été inventé après 1880, et le tracteur à roues, au début du 20e siècle, mais les grandes exploitations capitalistes n’ont commencé à faire un usage plus ou moins étendu du tracteur qu’à partir de 1920, principalement aux États-Unis.
Cependant, dans l’agriculture de la plupart des pays du monde capitaliste, la force motrice fondamentale est jusqu’à nos jours la bête de trait, et pour le travail du sol on emploie la charrue, la herse, le cultivateur à cheval.
6.7. La socialisation capitaliste du travail et de la production. Les limites de l’usage des machines en régime capitaliste.
Sur la base du machinisme, en régime capitaliste, un grand progrès a été réalisé dans le développement des forces productives de la société par rapport au mode de production féodal. La machine a été la force révolutionnaire qui a transformé la société.
Le passage de la manufacture à la fabrique constitue une révolution technique complète qui réduit à néant toute l’habileté manuelle acquise au cours des siècles par les maîtres-artisans, révolution suivie de la démolition la plus brutale des rapports sociaux de production, d’une scission définitive entre les différents groupes participant à la production, d’une rupture totale avec la tradition, de l’aggravation et de l’extension de tous les côtés sombres du capitalisme, et en même temps de la socialisation en masse du travail par le capitalisme. On voit donc que la grande industrie mécanique est le dernier mot du capitalisme, le dernier mot de ses facteurs négatifs et de ses « éléments positifs ».
( V. Lénine, « Le développement du capitalisme en Russie », Œuvres, t. 3, p. 480-481. )Sur la base de la grande industrie mécanique s’opère un processus spontané de vaste socialisation du travail par le capital.
Premièrement, grâce à l’emploi des machines la production industrielle se concentre de plus en plus dans les grandes entreprises. La machine exige par elle-même le travail collectif de nombreux ouvriers.
En second lieu, avec le capitalisme se développe de façon continue la division sociale du travail. Le nombre des branches industrielles et agricoles augmente. En même temps, l’interdépendance des branches et des entreprises devient de plus en plus étroite. Avec la haute spécialisation des branches d’industrie, le fabricant qui produit, par exemple, des tissus, dépend directement du fabricant qui produit les filés ; ce dernier, du capitaliste produisant le coton, du propriétaire de l’usine de constructions mécaniques, des houillères, etc.
Troisièmement, le morcellement des petites unités économiques propre à l’ disparaît, et les petits marchés locaux se fondent en un immense marché national et mondial.
Quatrièmement, le capitalisme avec son industrie mécanique refoule les diverses formes de dépendance personnelle du travailleur. Le travail salarié devient la base de la production. Il se crée une grande mobilité de la population, ce qui assure un afflux constant de main-d’œuvre dans les branches ascendantes de l’industrie.
Cinquièmement, avec l’expansion de la production mécanique, on voit apparaître une multitude de centres industriels et de grandes villes. La société se scinde de plus en plus en deux classes antagonistes fondamentales : la classe des capitalistes et la classe des ouvriers salariés.
La socialisation du travail et de la production, réalisée sur la base du machinisme, constitue un grand pas en avant dans le développement progressif de la société. Mais le bas égoïsme des capitalistes, âpres au gain, met des limites au développement des forces productives.
Du point de vue social, l’emploi de la machine est avantageux si le travail que nécessite la fabrication de la machine est inférieur à celui que son emploi permet d’économiser, et aussi si la machine allège le travail. Mais ce qui importe pour le capitaliste, ce n’est pas l’économie du travail social ni l’allègement du travail de l’ouvrier, mais l’économie réalisée sur le salaire. Les limites de l’emploi des machines pour le capitaliste sont donc plus étroites. Elles sont déterminées par la différence entre le prix de la machine et le salaire des ouvriers qu’elle élimine. Plus le salaire est bas, plus faible est la tendance du capitaliste à introduire des machines. Aussi le travail manuel est-il encore jusqu’à présent largement utilisé dans l’industrie des pays capitalistes même les plus développés.
La grande industrie mécanique a aggravé la concurrence entre les capitalistes, renforcé le caractère spontané, l’anarchie de toute la production sociale. L’usage capitaliste des machines a contribué non seulement au développement rapide des forces productives de la société, mais aussi à l’oppression du travail par le capital, à l’aggravation de toutes les contradictions inhérentes au mode de production capitaliste.
Résumé du chapitre 6
-
Le passage de la manufacture à la grande industrie mécanique a constitué la révolution industrielle. Particulièrement importante pour le passage à l’industrie mécanique furent l’invention de la machine à vapeur, l’amélioration des procédés de fabrication du métal et la création de machines produisant des machines, La machine a conquis, les unes après les autres, les branches de la production.
-
Avec le développement du capitalisme s’opère le processus d’industrialisation capitaliste des pays les plus importants de l’Europe et de l’Amérique. L’industrialisation capitaliste commence généralement par le développement de l’industrie légère. Le pillage des colonies et des pays vaincus et l’obtention d’emprunts asservissants jouent un grand rôle dans l’industrialisation des pays capitalistes. Celle-ci est fondée sur l’exploitation du travail salarié et elle accentue la ruine des grandes masses de la paysannerie et de l’artisanat. Elle conduit à de nouveaux progrès de la division sociale du travail, achève la séparation de l’industrie et de l’agriculture, aggrave l’opposition entre la ville et la campagne.
-
La fabrique capitaliste est une grande entreprise fondée sur l’exploitation des ouvriers salariés et qui fait usage d’un système de machines pour la production des marchandises. L’administration de la fabrique capitaliste revêt un caractère despotique. Dans la société capitaliste l’emploi des machines augmente le fardeau du travail salarié, renforce l’exploitation de l’ouvrier, entraîne à l’usine des femmes et des enfants qui touchent un salaire de misère. Le machinisme capitaliste achève la séparation du travail intellectuel et du travail manuel et aggrave leur opposition.
-
Le développement de la grande industrie mécanique contribue à l’agrandissement des villes, à l’accroissement de la population urbaine aux dépens de la population rurale, à la formation de la classe des ouvriers salariés — le prolétariat —, à l’augmentation de ses effectifs. L’emploi des machines dans l’agriculture est un avantage de la grande production, il entraîne l’élévation de la productivité du travail et accélère le processus de différenciation de la paysannerie. En régime capitaliste, l’agriculture retarde de plus en plus sur l’industrie, ce qui aggrave l’opposition de la ville et de la campagne.
-
La grande industrie mécanique joue dans l’histoire un rôle progressif, elle mène à l’accroissement de la productivité du travail et à la socialisation du travail par le capital. Les limites de l’emploi capitaliste des machines sont déterminées par le fait que les capitalistes n’introduisent la machine que lorsque son prix est inférieur à la masse des salaires des ouvriers qu’elle élimine.
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par Pcautunois le 16 Avril 2011 à 17:04
A. — Le capitalisme prémonopoliste
Chapitre 7 — Le capital et la plus-value — La loi économique fondamentale du capitalisme
7.1. La base des rapports de production en régime capitaliste.
Avec le passage de la manufacture à la grande industrie mécanique, le mode de production capitaliste est devenu prédominant. Dans l’industrie, les ateliers artisanaux et les manufactures fondés sur le travail manuel, font place aux fabriques et aux usines dans lesquelles le travail s’effectue à l’aide de machines complexes. Dans l’agriculture, de grandes exploitations capitalistes apparaissent, qui introduisent la technique agronomique relativement perfectionnée et les machines agricoles. Une nouvelle technique est née, de nouvelles forces productives se sont formées, des rapports de production nouveaux, capitalistes, ont prévalu. L’étude des rapports de production de la société capitaliste dans leur naissance, leur développement et leur déclin fait l’objet principal du Capital de Marx.
La propriété capitaliste des moyens de production forme la base des rapports de production dans la société bourgeoise. La propriété capitaliste des moyens de production est la propriété privée des capitalistes, qui n’est pas le fruit du travail et qui est utilisée aux fins d’exploitation des ouvriers salariés. D’après la définition classique de Marx,
le mode de production capitaliste …consiste en ceci que les conditions matérielles de production sont attribuées aux non-travailleurs sous forme de propriété capitaliste et de propriété foncière, tandis que la masse ne possède que les conditions personnelles de production : la force de travail.( K. Marx et F. Engels, Critique des programmes de Gotha et d’Erfurt, p. 25-26, Éditions sociales, Paris, 1950. )La production capitaliste est fondée sur le travail salarié. Les ouvriers salariés sont libérés des liens du servage. Mais ils sont privés des moyens de production et, sous peine de mourir de faim, ils sont obligés de vendre leur force de travail aux capitalistes. L’exploitation du prolétariat par la bourgeoisie constitue le principal trait caractéristique du capitalisme, et le rapport entre bourgeoisie et prolétariat est le rapport de classe fondamental du régime capitaliste.
Les pays où règne le mode de production capitaliste conservent, à côté des formes capitalistes, des survivances plus ou moins importantes des formes précapitalistes d’économie. Le « capitalisme à l’état pur » n’existe dans aucun pays. Outre la propriété capitaliste, il y a dans les pays bourgeois la grande propriété foncière, de même que la petite propriété privée des simples producteurs — paysans et artisans — qui vivent de leur travail. La petite production joue en régime capitaliste un rôle subalterne. La masse des petits producteurs des villes et des campagnes est exploitée par les capitalistes et les propriétaires fonciers, possesseurs des fabriques et des usines, des banques, des entreprises commerciales et de la terre.
Le mode de production capitaliste dans son développement comprend deux phases : prémonopoliste et monopoliste. Les lois économiques générales du capitalisme agissent à ces deux phases de son développement. Mais le capitalisme monopoliste se distingue par toute une série de particularités essentielles, dont nous parlerons plus loin.
Passons à l’examen de la nature de l’exploitation capitaliste.
7.2. La transformation de l’argent en capital.
Tout capital commence sa carrière sous la forme d’une somme déterminée d’argent. L’argent par lui-même n’est pas un capital. Lorsque, par exemple, de petits producteurs indépendants échangent des marchandises, l’argent intervient comme moyen de circulation, mais non comme capital. La formule de la circulation des marchandises est la suivante : M (marchandise) — A (argent) — M (marchandise), c’est-à-dire vente d’une marchandise pour achat d’une autre marchandise. L’argent devient capital quand il est employé aux fins d’exploitation du travail d’autrui. La formule générale du capital est A — M — A. c’est-à-dire acheter pour vendre aux fins d’enrichissement.
La formule M — A — M signifie qu’une valeur d’usage est échangée contre une autre : le producteur livre la marchandise dont il n’a pas besoin et reçoit en échange une autre marchandise dont il a besoin pour sa consommation. La valeur d’usage est le but de la circulation. Inversement, avec la formule A — M — A, les points de départ et d’arrivée du mouvement coïncident : au départ le capitaliste avait de l’argent, et il en a au terme de l’opération. Le mouvement du capital serait inutile si, à la fin de l’opération, le capitaliste avait la même somme d’argent qu’au début. Tout le sens de son activité est qu’à la suite de l’opération il se trouve avoir une plus grande somme d’argent qu’auparavant. Le but de la circulation est l’augmentation de la valeur. La formule générale du capital dans sa forme intégrale est donc celle-ci : A — M — A′ où A′ désigne la somme d’argent accrue.
Le capital avancé, c’est-à-dire le capital mis en circulation, retourne à son possesseur avec un certain excédent.
D’où vient l’excédent du capital ? Les économistes bourgeois, soucieux de masquer la vraie source de l’enrichissement des capitalistes, affirment fréquemment que ce surplus provient de la circulation des marchandises. Affirmation gratuite ! En effet, si l’on fait l’échange de marchandises et d’argent d’égale valeur, c’est-à-dire d’équivalents, aucun des possesseurs de marchandises ne peut tirer de la circulation une valeur plus grande que celle qui est incorporée dans sa marchandise. Et si les vendeurs réussissent à vendre leurs marchandises à un prix plus élevé que leur valeur, par exemple de 10 %, ils doivent, en devenant acheteurs, payer aux vendeurs en sus de la valeur les mêmes 10 %. Ainsi, ce que les possesseurs de marchandises gagnent comme vendeurs, ils le perdent comme acheteurs. Or, en réalité, toute la classe des capitalistes bénéficie d’un accroissement de capital. Il est évident que le possesseur d’argent, devenu capitaliste, doit trouver sur le marché une marchandise dont la consommation crée une valeur, et une valeur supérieure à celle qu’elle possède elle-même. En d’autres termes, le possesseur d’argent doit trouver sur le marché une marchandise dont la valeur d’usage posséderait elle-même la faculté d’être source de valeur. Cette marchandise est la force de travail.
7.3. La force de travail en tant que marchandise. La valeur et la valeur d’usage de la marchandise force de travail.
La force de travail, l’ensemble des facultés physiques et morales dont l’homme dispose et qu’il met en action lorsqu’il produit des biens matériels, quelle que soit la forme de la société, est un élément indispensable de la production. Mais c’est seulement en régime capitaliste que la force de travail devient marchandise.
Le capitalisme est la production marchande au plus haut degré de son développement, quand la force de travail elle-même devient marchandise. Avec la transformation de la force de travail en marchandise, la production marchande prend un caractère universel. La production capitaliste est fondée sur le travail salarié, et l’embauchage de l’ouvrier par le capitaliste n’est autre chose qu’une opération de vente-achat de la marchandise force de travail : l’ouvrier vend sa force de travail, le capitaliste l’achète.
En embauchant un ouvrier, le capitaliste reçoit sa force de travail dont il dispose sans réserve. Il l’utilise dans le processus de production capitaliste, dans lequel s’opère l’accroissement du capital.
De même que toute autre marchandise, la force de travail est vendue à un prix déterminé, à la base duquel se trouve la valeur de cette marchandise. Quelle est cette valeur ?
Pour que l’ouvrier conserve sa capacité de travail, il doit satisfaire ses besoins en nourriture, vêtements, chaussures, logement Satisfaire les besoins vitaux, c’est reconstituer l’énergie vitale dépensée par l’ouvrier : l’énergie des muscles, des nerfs, du cerveau ; c’est reconstituer sa capacité de travail. En outre, le capital a besoin d’un afflux incessant de force de travail ; l’ouvrier doit donc avoir la possibilité non seulement de s’entretenir lui-même, mais d’entretenir aussi sa famille. Par là se trouve assurée la reproduction, c’est-à-dire le renouvellement constant de la force de travail. Enfin, le capital a besoin non seulement d’ouvriers non spécialisés, mais aussi d’ouvriers qualifiés sachant manier les machines complexes ; or, acquérir une qualification comporte certaines dépenses de travail pour l’apprentissage. Aussi les frais de production et de reproduction de la force de travail comprennent-ils un minimum de dépenses pour la formation des générations montantes de la classe ouvrière.
Il ressort de tout cela que la valeur de la marchandise force de travail est égale à la valeur des moyens de subsistance nécessaires à l’entretien de l’ouvrier et de sa famille.
Cette marchandise, de même que toute autre, possède une valeur. Comment la détermine-t-on ? Par le temps de travail nécessaire à sa production.
( K. Marx, Le Capital, livre 1, t. 1, p. 173. )Avec le développement historique de la société se modifient le niveau des besoins habituels de l’ouvrier, mais aussi les moyens de satisfaire ces besoins. Dans les différents pays, le niveau des besoins usuels de l’ouvrier n’est pas le même. Les particularités de l’évolution historique suivie par un pays donné, ainsi que celles des conditions dans lesquelles s’est formée la classe des ouvriers salariés, déterminent sous bien des rapports le caractère de ses besoins. Les conditions climatiques et autres exercent également une certaine influence sur les besoins de l’ouvrier en nourriture, en vêtements, en logement. La valeur de la force de travail renferme non seulement la valeur des objets de consommation nécessaires à la restauration des forces physiques de l’homme, mais aussi les frais que comporte la satisfaction des besoins culturels de l’ouvrier et de sa famille, tels qu’ils résultent des conditions sociales dans lesquelles vivent et sont élevés les ouvriers (éducation des enfants, achat de journaux, de livres, cinéma, théâtre, etc.) Les capitalistes cherchent toujours et partout à ramener les conditions matérielles et culturelles de vie de la classe ouvrière au niveau le plus bas.
Pour engager une affaire, le capitaliste commence par acheter tout ce qui est nécessaire à la production : bâtiments, machines, équipement, matières premières, combustible. Ensuite, il embauche la main-d’œuvre et le processus de production commence à l’entreprise. Dès que la marchandise est prête, le capitaliste la vend. La valeur de la marchandise produite renferme, premièrement, la valeur des moyens de production dépensés : matières premières traitées, combustible, une partie déterminée de la valeur des bâtiments, des machines et des outils ; en second lieu, la valeur nouvelle créée par le travail des ouvriers de l’entreprise.
Qu’est-ce que cette nouvelle valeur ?
Le mode de production capitaliste suppose un niveau relativement élevé de la productivité du travail, tel que l’ouvrier, pour créer une valeur égale à celle de sa force de travail, n’a besoin que d’une partie de la journée de travail. Admettons qu’une heure de travail moyen simple crée une valeur égale à un dollar, et que la valeur journalière de la force de travail soit égale à six dollars. Alors, pour compenser la valeur journalière de sa force de travail, l’ouvrier doit travailler pendant 6 heures. Mais le capitaliste ayant acheté la force de travail pour toute la journée fait travailler le prolétaire non pas 6 heures, mais pendant une journée de travail entière qui comporte, par exemple, 12 heures. Pendant ces 12 heures, l’ouvrier crée une valeur égale à 12 dollars, cependant que sa force de travail ne vaut que 6 dollars.
Nous voyons maintenant en quoi consiste la valeur d’usage spécifique de la marchandise force de travail pour l’acheteur de cette marchandise, le capitaliste. La valeur d’usage de la marchandise force de travail est sa propriété d’être une source de valeur, d’une valeur plus grande qu’elle n’en possède elle-même.
7.4. La production de la plus-value est la loi économique fondamentale du capitalisme.
La valeur de la force de travail et la valeur créée dans le processus de sa consommation sont deux grandeurs différentes. La différence entre ces deux grandeurs est la condition préalable nécessaire de l’exploitation capitaliste.
Dans notre exemple, le capitaliste, en dépensant 6 dollars pour embaucher un ouvrier, reçoit une valeur créée par le travail de l’ouvrier, égale à 12 dollars. Le capitaliste récupère le capital qu’il a d’abord avancé avec une augmentation ou un excédent égal à 6 dollars. Cet excédent constitue la plus-value.
La plus-value est la valeur créée par le travail de l’ouvrier salarié en plus de la valeur de sa force de travail, et que le capitaliste s’approprie gratuitement. Ainsi, la plus-value est le fruit du travail non payé de l’ouvrier.
La journée de travail dans l’entreprise capitaliste comporte deux parties: le temps de travail nécessaire et le temps de travail supplémentaire ; le travail de l’ouvrier salarié se décompose en travail nécessaire et surtravail. Pendant le temps de travail nécessaire, l’ouvrier reproduit la valeur de sa force de travail, et pendant le temps de surtravail, il crée la plus-value.
Le travail de l’ouvrier en régime capitaliste est processus de consommation par le capitaliste de la marchandise force de travail, c’est-à-dire processus pendant lequel le capitaliste soutire à l’ouvrier la plus-value. Le processus de travail en régime capitaliste est caractérisé par deux particularités fondamentales.
Premièrement, l’ouvrier travaille sous le contrôle du capitaliste à qui appartient le travail de l’ouvrier. En second lieu, au capitaliste appartient non seulement le travail de l’ouvrier, mais aussi le produit de ce travail. Ces particularités du processus de travail font du travail de l’ouvrier salarié un dur et odieux fardeau.
Le but immédiat de la production capitaliste est la production de la plus-value. En conséquence, seul un travail créateur de plus-value est considéré comme travail productif en régime capitaliste. Si donc l’ouvrier ne crée pas de plus-value, son travail est un travail improductif, inutile pour le capitaliste.
Contrairement aux anciennes formes d’exploitation — esclavagiste et féodale — l’exploitation capitaliste se présente sous une forme déguisée. Lorsque l’ouvrier salarié vend sa force de travail au capitaliste, cette transaction apparaît au premier abord comme une transaction habituelle entre possesseurs de marchandises, comme un échange ordinaire d’une marchandise contre de l’argent, effectué en accord avec la loi de la valeur. Mais la transaction vente-achat de la force de travail n’est qu’une forme extérieure derrière laquelle se cachent l’exploitation de l’ouvrier par le capitaliste, l’appropriation par l’entrepreneur, sans aucun équivalent, du travail non payé de l’ouvrier.
En analysant l’essence de l’exploitation capitaliste, nous supposons que le capitaliste, en louant l’ouvrier, lui paie la valeur intégrale de sa force de travail, déterminée par la loi de la valeur. Plus tard, en examinant le salaire, nous montrerons qu’à la différence des prix des autres marchandises, le prix de la force de travail, en règle générale, oscille au-dessous de sa valeur. Cela a pour effet d’augmenter encore l’exploitation de la classe ouvrière par la classe des capitalistes.
Le capitalisme permet à l’ouvrier salarié de travailler et, par conséquent, de vivre, dans la mesure seulement où il travaille un certain temps à titre gratuit pour le capitaliste. Lorsqu’il quitte une entreprise capitaliste, l’ouvrier, dans le meilleur des cas, entre dans une autre entreprise capitaliste où il subit la même exploitation. En dénonçant le travail salarié comme un système d’esclavage salarié, Marx disait que si l’esclave romain était chargé de fers, l’ouvrier salarié est attaché à son maître par des fils invisibles. Ce maître, c’est la classe des capitalistes dans son ensemble.
La plus-value créée par le travail non payé des ouvriers salariés constitue la source commune des revenus, non acquis par le travail, des différents groupes de la bourgeoisie : industriels, commerçants, banquiers, ainsi que de la classe des propriétaires fonciers.
La production de la plus-value est la loi économique fondamentale du capitalisme. En définissant le capitalisme, Marx disait :
Fabriquer de la plus-value, telle est la loi absolue de ce mode de production.
( K. Marx, Le Capital, livre 1, t. 3, p. 59. )Les traits essentiels de cette loi consistent dans la production sans cesse croissante de plus-value, et dans l’appropriation de celle-ci par les capitalistes sur la base de la propriété privée des moyens de production et grâce à l’intensification de l’exploitation du travail salarié et à l’élargissement de la production. La loi économique fondamentale exprime l’essence même des rapports de production capitalistes ; elle est la loi du mouvement du capitalisme ; elle détermine le caractère inévitable de l’accroissement et de l’aggravation de ses contradictions.
Le capital n’a pas inventé le surtravail. Partout où la société est composée d’exploiteurs et d’exploités, la classe dominante soutire du surtravail aux classes exploitées. Mais contrairement au maître d’esclaves et au seigneur féodal, qui, par suite du régime d’ qui régnait alors, consacraient la plus grande partie des produits du surtravail des esclaves et des serfs à la satisfaction immédiate de leurs besoins et de leurs caprices, le capitaliste convertit en argent tout le produit du surtravail des ouvriers salariés. Le capitaliste consacre une partie de cet argent à l’achat d’objets de consommation et d’objets de luxe ; l’autre partie de cet argent, il !a met de nouveau en œuvre à titre de capital additionnel qui produit une nouvelle plus-value. Aussi le capital manifeste-t-il, selon l’expression de Marx, une voracité de loup pour le surtravail.
La course à la plus-value est le principal moteur du développement des forces productives en régime capitaliste. Aucune des formes antérieures de régime d’exploitation — ni l’esclavage ni la féodalité — ne possédait un tel stimulant du progrès technique.
Lénine a appelé la théorie de la plus-value la pierre angulaire de la théorie économique de Marx. En révélant dans sa théorie de la plus-value l’essence de l’exploitation capitaliste, Marx a porté un coup mortel à l’économie politique bourgeoise et à ses affirmations sur l’harmonie des intérêts des classes en régime capitaliste et il a donné à la classe ouvrière une arme spirituelle pour renverser le capitalisme.
7.5. Le capital en tant que rapport social de production. Le capital constant et le capital variable.
Les économistes bourgeois appellent capital tout instrument de travail, tout moyen de production, à commencer par la pierre et le bâton de l’homme primitif. Cette définition du capital a pour but d’estomper l’essence de l’exploitation de l’ouvrier par le capitaliste, de présenter le capital comme une condition éternelle et immuable de l’existence de toute société humaine.
En réalité, la pierre et le bâton servaient d’outil de travail à l’homme primitif, mais n’étaient point du capital. Ne sont pas non plus du capital les instruments et les matières premières de l’artisan, le matériel, les semences et les bêtes de trait du paysan qui exploite son terrain sur la base de son travail personnel. Les moyens de production ne deviennent du capital qu’à une phase déterminée du développement historique, lorsqu’ils sont propriété privée du capitaliste et servent de moyen d’exploitation du travail salarié. Avec la liquidation du régime capitaliste les moyens de production deviennent propriété sociale et ils cessent d’être du capital. Ainsi le capital n’est pas une chose, mais un rapport social de production qui a un caractère historique transitoire.
Le capital est une valeur qui — par l’exploitation des ouvriers salariés — rapporte la plus-value. Selon Marx, le capital est
du travail mort, qui, semblable au vampire, ne s’anime qu’en suçant le travail vivant, et sa vie est d’autant plus allègre qu’il en pompe davantage.( K. Marx, Le Capital, livre 1, t. 1, p. 229. )Le capital incarne le rapport de production entre la classe des capitalistes et la classe ouvrière, rapport qui consiste en ce que les capitalistes, en tant que possesseurs des moyens et des conditions de production, exploitent les ouvriers salariés qui créent pour eux la plus-value. Ce rapport de production, comme d’ailleurs tous les autres rapports de production de la société capitaliste, prend la forme d’un rapport entre objets et apparaît comme la propriété de ces objets (moyens de production) de procurer un revenu au capitaliste.
C’est en cela que consiste le caractère fétiche du capital : avec le mode de production capitaliste se crée une apparence trompeuse, selon laquelle les moyens de production (ou une certaine somme d’argent avec laquelle on peut acheter les moyens de production) possèdent par eux-mêmes la faculté miraculeuse de procurer à leur possesseur un revenu régulier ne provenant pas du travail.
Les différentes parties du capital ne jouent pas le même rôle dans le processus de production de la plus-value.
L’entrepreneur dépense une certaine partie du capital pour construire les bâtiments d’une fabrique, acquérir de l’équipement et des machines, acheter les matières premières, le combustible, les matériaux accessoires. La valeur de cette partie du capital est transférée à la marchandise nouvellement produite à mesure que les moyens de production sont consommés ou usés au cours du travail. La partie du capital, qui existe sous forme de valeur des moyens de production, ne change pas de grandeur en cours de production ; aussi porte-t-elle le nom de capital constant.
L’entrepreneur consacre l’autre partie du capital à l’achat de la force de travail, à l’embauchage des ouvriers. En échange de cette partie du capital dépensé, l’entrepreneur, le processus de production terminé, reçoit une nouvelle valeur créée par les ouvriers dans son entreprise. Cette nouvelle valeur, on l’a vu, est supérieure à celle de la force de travail achetée par le capitaliste. C’est ainsi que la partie du capital, dépensée pour l’embauchage d’ouvriers, change de grandeur au cours de la production : elle augmente à la suite de la création par les ouvriers d’une plus-value que le capitaliste accapare. La partie du capital qui est consacrée à l’achat de la force de travail (c’est-à-dire à l’embauchage d’ouvriers) et qui augmente en cours de production, s’appelle capital variable.
On désigne le capital constant par la lettre c, et le capital variable par la lettre v. La division du capital en partie constante et partie variable a été établie pour la première fois par Marx. Cette division a mis en lumière le rôle particulier du capital variable destiné à l’achat de la force de travail. L’exploitation des ouvriers salariés par les capitalistes constitue la source véritable de la plus-value.
La découverte du double caractère du travail incarné dans la marchandise, a été la clef qui a permis à Marx d’établir la distinction entre le capital constant et le capital variable, et de dégager l’essence de l’exploitation capitaliste. Marx a montré que l’ouvrier par son travail crée simultanément une nouvelle valeur et transfère la valeur des moyens de production à la marchandise fabriquée. Comme travail concret et déterminé, le travail de l’ouvrier transmet au produit la valeur des moyens de production dépensés, et comme travail abstrait, en tant que dépense de la force de travail en général, le travail de ce même ouvrier crée une nouvelle valeur. Ces deux aspects du processus du travail se distinguent de façon très marquée. Par exemple, en doublant la productivité du travail dans sa branche, le fileur transmet au produit, pendant une journée de travail, une valeur de moyens de production deux fois plus grande (puisqu’il traite deux fois plus de coton) ; pour ce qui est de la nouvelle valeur, il en créera autant qu’auparavant.
7.6. Le taux de la plus-value.
Le degré d’exploitation de l’ouvrier par le capitaliste trouve son expression dans le taux de la plus-value.
Le taux de la plus-value est le rapport exprimé en pourcentage de la plus-value au capital variable. Le taux de la plus-value montre dans quelle proportion le travail dépensé par les ouvriers se divise en travail nécessaire et en surtravail ; autrement dit, quelle est la partie de la journée de travail que le prolétaire dépense pour compenser la valeur de sa force de travail et quelle partie de la journée il travaille gratuitement pour le capitaliste. On désigne la plus-value par la lettre p et le taux de la plus-value par p′=pv. Dans le cas cité plus haut (p. 121) le taux de la plus-value, exprimé en pourcentage, est :
p′=pv=6 dollars6 dollars×100=100 %.
Le taux de la plus-value est ici égal à 100 %. Cela veut dire que dans le cas présent le travail de l’ouvrier est divisé pour moitié en travail nécessaire et en surtravail. Avec le développement du capitalisme s’élève le taux de la plus-value, ce qui marque l’élévation du degré d’exploitation du prolétariat par la bourgeoisie. La masse de plus-value s’accroît encore plus rapidement, du fait qu’augmente le nombre des ouvriers salariés exploités par le capital.
Dans son article « Salaire des ouvriers et profit des capitalistes en Russie », rédigé en 1912, Lénine présente le calcul suivant qui montre le degré d’exploitation du prolétariat dans la Russie d’avant la Révolution. Une enquête officielle effectuée en 1908 sur les fabriques et les usines, et dont les chiffres sans aucun doute surestiment les salaires des ouvriers et sous-estiment les profits des capitalistes, établissait que les salaires des ouvriers se montaient à 555,7 millions de roubles, tandis que les profits des capitalistes étaient de 568,7 millions de roubles. Le nombre total des ouvriers des entreprises inspectées de la grande industrie était de 2 254 000. Ainsi, la moyenne du salaire d’un ouvrier était de 246 roubles par an, et chaque ouvrier apportait en moyenne au capitaliste 252 roubles de bénéfice annuel.
Ainsi donc, dans la Russie des tsars, l’ouvrier travaillait un peu moins de la moitié de la journée pour lui-même, et un peu plus de la moitié de cette journée pour le capitaliste.
7.7. Deux moyens d’augmentation du degré d’exploitation du travail par le capital. La plus-value absolue et la plus-value relative.
Tout capitaliste, afin d’accroître la plus-value, cherche par tous les moyens à augmenter la part du surtravail qu’il extorque à l’ouvrier. L’augmentation de la plus-value se réalise par deux moyens principaux.
Prenons à titre d’exemple une journée de travail de 12 heures, dont 6 heures forment le travail nécessaire et 6 heures le surtravail. Représentons cette journée de travail sous la forme d’une ligne dont chaque division est égale à une heure.

 Journée de travail = 12 heures|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
Journée de travail = 12 heures|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
 Temps de travail nécessaire= 6 heures|—|—|—|—|—|—|
Temps de travail nécessaire= 6 heures|—|—|—|—|—|—| Temps de surtravail= 6 heures|—|—|—|—|—|—|
Temps de surtravail= 6 heures|—|—|—|—|—|—|Le premier moyen d’augmenter le degré d’exploitation de l’ouvrier consiste pour le capitaliste à augmenter la plus-value qu’il reçoit, en allongeant la journée de travail, par exemple, de 2 heures. Alors la journée de travail se présentera comme suit :

 Journée de travail = 14 heures|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
Journée de travail = 14 heures|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
 Temps de travail nécessaire= 6 heures|—|—|—|—|—|—|
Temps de travail nécessaire= 6 heures|—|—|—|—|—|—| Temps de surtravail= 8 heures|—|—|—|—|—|—|—|—|
Temps de surtravail= 8 heures|—|—|—|—|—|—|—|—|La durée du surtravail a augmenté par suite de rallongement absolu de la journée de travail dans son ensemble, tandis que le temps de travail nécessaire est resté invariable. La plus-value produite par la prolongation de la journée de travail s’appelle plus-value absolue.
Le second moyen d’augmenter le degré d’exploitation de l’ouvrier consiste, sans modifier la durée générale de la journée de travail, à augmenter la plus-value que reçoit le capitaliste en réduisant le temps de travail nécessaire. L’augmentation de la productivité du travail dans les branches fabriquant les objets de consommation pour les ouvriers, et aussi dans celles qui fournissent les instruments et les matériaux pour la production des objets de consommation, aboutit à réduire le temps de travail nécessaire à leur production. Il en résulte que la valeur des moyens de subsistance des ouvriers diminue et la valeur de la force de travail décroît en conséquence. Si auparavant on dépensait 6 heures pour la production des moyens de subsistance de l’ouvrier, maintenant on ne dépense, par exemple, que 4 heures. La journée de travail se présente alors comme suit :

 Journée de travail = 12 heures|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
Journée de travail = 12 heures|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
 Temps de travail nécessaire= 4 heures|—|—|—|—|
Temps de travail nécessaire= 4 heures|—|—|—|—| Temps de surtravail= 8 heures|—|—|—|—|—|—|—|—|
Temps de surtravail= 8 heures|—|—|—|—|—|—|—|—|La longueur de la journée de travail reste invariable, mais la durée de surtravail augmente du fait que le rapport s’est modifié entre le temps de travail nécessaire et le temps de surtravail. La plus-value résultant, par suite de l’augmentation de la productivité du travail, de la diminution du temps du travail nécessaire et de l’augmentation correspondante du temps de surtravail s’appelle plus-value relative.
Ces deux moyens d’augmenter la plus-value renforcent l’exploitation du travail salarié par le capital. En même temps ils jouent un rôle différent aux différentes phases du développement historique du capitalisme. Dans les premières phases du développement du capitalisme, alors que la technique était rudimentaire et avançait relativement lentement, l’augmentation de la plus-value absolue avait une importance primordiale. Le capital à la poursuite de la plus-value réalisa une révolution radicale dans les méthodes de production, la révolution industrielle, qui donna le jour à la grande industrie mécanique. La coopération capitaliste simple, la manufacture et l’industrie mécanique, dont il a été question plus haut (ch. 5 et 6), représentent des degrés successifs de l’élévation de la productivité du travail par le capital. Dans la période du machinisme, alors que la technique hautement développée permet d’accroître rapidement la productivité du travail, les capitalistes s’attachent à élever considérablement le degré d’exploitation des ouvriers, avant tout par l’augmentation de la plus-value relative. En même temps, ils cherchent comme par le passé à prolonger au maximum la journée de travail et surtout à intensifier encore le travail. L’intensification du travail des ouvriers a pour le capitaliste la même importance que l’allongement de la journée du travail : l’allongement de la journée de travail de 10 à 11 heures ou l’augmentation d’un dixième de l’intensité du travail lui fournit le même résultat.
7.8. La plus-value extra.
La course à la plus-value extra joue un grand rôle dans le développement du capitalisme. Elle s’obtient dans les cas où certains capitalistes introduisent chez eux des machines et des méthodes de production plus perfectionnées que celles qui sont employées dans la plupart des entreprises de la même branche d’industrie. C’est ainsi que tel capitaliste obtient dans son entreprise une plus haute productivité du travail par rapport au niveau moyen existant dans une branche d’industrie donnée. Dès lors, la valeur individuelle de la marchandise produite dans l’entreprise de ce capitaliste se trouve être inférieure à la valeur sociale de cette même marchandise. Mais comme le prix de la marchandise est déterminé par sa valeur sociale, ce capitaliste reçoit un taux de plus-value supérieur au taux ordinaire.
Prenons l’exemple suivant. Admettons que, dans une manufacture de tabac, un ouvrier produise 1 000 cigarettes à l’heure et travaille 12 heures, dont 6 lui servent à créer une valeur égale à celle de sa force de travail. Si l’on introduit dans la manufacture une machine doublant la productivité du travail, l’ouvrier, tout en continuant à travailler 12 heures, ne produit plus 12 000, mais 24 000 cigarettes. Le salaire de l’ouvrier est compensé par une partie de la valeur nouvellement créée, incarnée (déduction faite de la valeur de la part transférée du capital constant) dans 6 000 cigarettes, c’est-à-dire dans le produit de 3 heures. Au fabricant revient l’autre partie de la valeur nouvellement créée, incarnée (déduction faite de la valeur de la part transférée du capital constant) dans 18 000 cigarettes, c’est-à-dire dans le produit de 9 heures.
Ainsi, le temps de travail nécessaire est réduit et le temps de surtravail de l’ouvrier est allongé en conséquence. L’ouvrier compense la valeur de sa force de travail, non plus en 6 heures, mais en 3 heures ; son surtravail passe de 6 heures à 9 heures. Le taux de la plus-value a triplé.
La plus-value extra est l’excédent de plus-value que reçoivent, en sus du taux ordinaire, les capitalistes en abaissant la valeur individuelle des marchandises produites dans leurs entreprises.
L’obtention de la plus-value extra ne constitue, dans chaque entreprise, qu’un phénomène passager. Tôt ou tard, la plupart des entrepreneurs de la même branche d’industrie introduisent chez eux des machines nouvelles ; quiconque ne possède pas un capital suffisant pour cela finit par se ruiner dans cette concurrence. Résultat : le temps socialement nécessaire à la production d’une marchandise donnée diminue, la valeur de la marchandise baisse, et le capitaliste qui a appliqué avant les autres les perfectionnements techniques, cesse de recevoir une plus-value extra. Cependant, en disparaissant dans une entreprise, la plus-value extra apparaît dans une autre où sont introduites des machines nouvelles encore plus perfectionnées.
Chaque capitaliste ne vise qu’à s’enrichir personnellement. Cependant l’action dispersée des différents entrepreneurs a pour résultat le progrès technique, le développement des forces productives de la société capitaliste. En même temps, la course à la plus-value incite chaque capitaliste à protéger ses réalisations techniques contre ses concurrents, elle engendre le secret sur le plan commercial et technique. Il apparaît ainsi que le capitalisme pose des limites au développement des forces productives. Les forces productives, en régime capitaliste, se développent sous une forme contradictoire. Les capitalistes ne font usage de nouvelles machines que si leur emploi donne lieu à un accroissement de la plus-value. L’introduction de nouvelles machines sert de base à l’élévation systématique du degré d’exploitation du prolétariat, à l’allongement de la journée de travail et à l’intensification du travail ; le progrès technique se réalise au prix d’infinis sacrifices et privations de nombreuses générations de la classe ouvrière. Ainsi le capitalisme traite avec une rapacité extrême la principale force productive de la société, la classe ouvrière, les masses laborieuses.
7.9. La journée de travail et ses limites. La lutte pour sa réduction.
Dans leur course au relèvement du taux de la plus-value, les capitalistes s’efforcent d’allonger la journée de travail au maximum. La journée de travail, c’est le temps pendant lequel l’ouvrier se trouve à l’entreprise, à la disposition du capitaliste. Si la chose était possible, l’entrepreneur contraindrait ses ouvriers à travailler 24 heures par jour. Mais, pendant une certaine partie de la journée, l’homme doit rétablir ses forces, se reposer, dormir, manger. Par là, des limites purement physiques sont assignées à la journée de travail. Celle-ci a de plus des limites morales, puisqu’il faut à l’ouvrier du temps pour satisfaire ses besoins culturels et sociaux.
Le capital, dans sa soif ardente de surtravail, refuse de tenir compte non seulement des limites morales, mais encore des limites purement physiques de la journée de travail. Selon Marx, le capital ne ménage ni la vie ni la santé du travailleur. L’exploitation effrénée de la force de travail réduit la durée de la vie du prolétaire, provoque une extraordinaire élévation de la mortalité parmi la population ouvrière.
À l’époque où le capitalisme naissait, le pouvoir d’État a promulgué, en faveur de la bourgeoisie, des lois spéciales pour contraindre les ouvriers salariés à travailler le plus d’heures possible. Alors la technique demeurait à un niveau inférieur, des masses de paysans et d’artisans pouvaient travailler pour leur propre compte, et de ce fait le capital ne disposait pas d’un excédent de main-d’œuvre. La situation s’est modifiée avec l’introduction des machines et les progrès de la prolétarisation de la population. Le capital disposait alors d’une quantité suffisante d’ouvriers qui, sous peine de mourir de faim, durent se laisser asservir aux capitalistes. La nécessité d’avoir des lois officielles, tendant à allonger la journée de travail, avait disparu. Le capital eut la possibilité, par des contraintes économiques, de prolonger la durée du travail à l’extrême. Dès lors la classe ouvrière engagea une lutte opiniâtre pour la réduction de la journée de travail. Cette lutte s’est déroulée tout d’abord en Angleterre.
À la suite d’une lutte prolongée, les ouvriers anglais obtinrent la promulgation en 1833 d’une loi sur les fabriques qui limitait le travail des enfants au-dessous de 13 ans à 8 heures et celui des adolescents de 13 à 18 ans, à 12 heures. En 1844 fut promulguée la première loi limitant le travail des femmes à 12 heures et celui des enfants à 6 heures et demie. La plupart du temps la main-d’œuvre enfantine et féminine était utilisée parallèlement au travail des hommes. Aussi, dans les entreprises que visait la loi, la journée de 12 heures fut-elle étendue à tous les ouvriers. La loi de 1847 limitait le travail des adolescents et des femmes à 10 heures. La loi de 1901 limitait la journée de travail des ouvriers adultes à 12 heures pendant les cinq premiers jours de la semaine et à 5 heures et demie le samedi.
Au fur et à mesure que la résistance des ouvriers augmentait, les lois limitant la journée de travail apparurent aussi dans les autres pays capitalistes. Après la promulgation de chacune de ces lois, les ouvriers durent lutter inlassablement pour en assurer l’application.
La lutte pour la limitation législative du temps de travail fut particulièrement intense, après que la classe ouvrière eut adopté comme mot d’ordre de combat la revendication de la journée de huit heures. Cette revendication fut proclamée en 1866 par le Congrès ouvrier en Amérique et le Congrès de la 1re Internationale sur la proposition de Marx. La lutte pour la journée de 8 heures devint partie intégrante non seulement de la lutte économique, mais aussi de la lutte politique du prolétariat.
Dans la Russie tsariste, les premières lois ouvrières parurent à la fin du 19e siècle. Après les fameuses grèves du prolétariat de Saint-Pétersbourg, la loi de 1897 limita la journée de travail à 11 heures et demie. Cette loi fut, d’après Lénine, une concession imposée, conquise par les ouvriers russes sur le gouvernement du tsar.
À la veille de la première guerre mondiale, dans la plupart des pays développés au point de vue capitaliste, prédominait la journée de travail de 10 heures. En 1919, sous l’influence de la peur devant le mouvement révolutionnaire ascendant, les représentants d’une série de pays capitalistes passèrent à Washington un accord sur l’introduction de la journée de 8 heures à l’échelle internationale, mais ensuite tous les grands États capitalistes se refusèrent à ratifier cet accord. Pourtant sous la pression de la classe ouvrière, dans de nombreux pays capitalistes fut introduite la journée de travail de 8 heures. Mais les entrepreneurs compensaient la diminution de la journée de travail par un accroissement brutal de l’intensité du travail. Dans une série de pays capitalistes, à une intensité du travail exténuante s’ajoute une longue journée de travail, notamment dans l’industrie de l’armement. Une journée de travail excessivement longue est le lot du prolétariat des pays coloniaux et dépendants.
7.10. La structure de classe de la société capitaliste. L’État bourgeois.
Ce qui caractérisait les modes de production esclavagiste et féodal, c’était la division de la société en différentes classes et castes, division qui lui donnait une structure hiérarchique complexe. L’époque bourgeoise a simplifié les antagonismes de classes et substitué aux diverses formes de privilèges héréditaires et de dépendance personnelle le pouvoir impersonnel de l’argent, le despotisme illimité du capital. Avec le mode de production capitaliste, la société se scinde de plus en plus en deux grands camps ennemis, en deux classes opposées : la bourgeoisie et le prolétariat.
La bourgeoisie est la classe qui possède les moyens de production et les utilise pour exploiter le travail salarié. Elle est la classe dominante de la société capitaliste.
Le prolétariat est la classe des ouvriers salariés, dépourvus de moyens de production et obligés, par suite, de vendre leur force de travail aux capitalistes. Sur la base de la production mécanique le capital a entièrement mis sous sa coupe le travail salarié. Pour la classe des ouvriers salariés, la condition prolétarienne est devenue son lot pour la vie. La situation économique du prolétariat en fait la classe la plus révolutionnaire.
Bourgeoisie et prolétariat sont les classes fondamentales de la société capitaliste. Tant qu’existe le mode de production capitaliste, ces deux classes sont indissolublement liées entre elles : la bourgeoisie ne peut exister et s’enrichir sans exploiter les ouvriers salariés ; les prolétaires ne peuvent vivre sans se louer aux capitalistes. En même temps, la bourgeoisie et le prolétariat sont des classes antagonistes, dont les intérêts s’opposent et sont irréductiblement hostiles. Le capitalisme, en se développant, approfondit l’abîme entre la minorité exploiteuse et les masses exploitées.
À côté de la bourgeoisie et du prolétariat en régime capitaliste existent la classe des propriétaires fonciers et celle des paysans. Ces classes sont des survivances du régime féodal antérieur, mais elles ont pris un caractère sensiblement différent, en rapport avec les conditions du capitalisme.
Les propriétaires fonciers en régime capitaliste sont la classe des grands propriétaires terriens, qui, d’ordinaire, afferment leurs terres à des fermiers capitalistes ou à de petits paysans producteurs, ou bien qui pratiquent sur la propriété qui leur appartient la grande production capitaliste à l’aide de travail salarié.
La paysannerie est la classe des petits producteurs possédant leur propre exploitation, fondée sur la propriété privée des moyens de production, sur une technique arriérée et le travail manuel. La paysannerie constitue dans les pays bourgeois une partie importante de la population. La masse essentielle de la paysannerie, exploitée sans merci par les propriétaires fonciers, les paysans riches, les marchands et les usuriers, court à sa ruine. Dans le processus de sa différenciation, la paysannerie dégage constamment de son sein, d’une part, des masses de prolétaires, et de l’autre, des paysans enrichis, des capitalistes.
L’État bourgeois qui, à la suite de la révolution bourgeoise, est venu remplacer l’État féodal, est par son caractère de classe, entre les mains des capitalistes, un instrument d’asservissement et d’oppression de la classe ouvrière et de la paysannerie. L’État bourgeois protège la propriété privée capitaliste des moyens de production, garantit l’exploitation des travailleurs et réprime leur lutte contre le régime capitaliste. Gomme les intérêts de la classe capitaliste s’opposent foncièrement à ceux de l’immense majorité de la population, la bourgeoisie est obligée de cacher par tous les moyens le caractère de classe de son État. Elle s’efforce de le présenter comme un État de « démocratie pure », soi-disant au-dessus des classes et appartenant au peuple tout entier. Mais en fait la « liberté » bourgeoise est la liberté pour le capital d’exploiter le travail d’autrui, l’ « égalité » bourgeoise est une apparence qui masque l’inégalité de fait entre l’exploiteur et l’exploité, entre l’homme rassasié et l’affamé, entre les propriétaire moyens de production et la masse des prolétaires qui ne possèdent que leur force de travail.
L’État bourgeois réprime les masses populaires à l’aide de son appareil administratif, de sa police, de son armée, de ses tribunaux, de ses prisons, de ses camps de concentration, et d’autres moyens de coercition. L’action idéologique à l’aide de laquelle la bourgeoisie maintient sa domination est le complément indispensable de ces moyens de coercition. Cela comprend la presse bourgeoise, la radio, le cinéma, la science et l’art bourgeois, les Églises.
L’État bourgeois est le comité exécutif de la classe des capitalistes. Les constitutions bourgeoises ont pour but de renforcer le régime social, agréable et avantageux pour les classes possédantes. L’État bourgeois déclare sacré et inviolable le fondement du régime capitaliste, la propriété privée des moyens de production.
Les formes de l’État bourgeois sont très variées, mais leur essence est la même : dans tous ces États, la dictature est exercée par la bourgeoisie qui essaie par tous les moyens de conserver et de fortifier le régime d’exploitation du travail salarié par le capital.
À mesure que se développe la grande production capitaliste, augmentent les effectifs du prolétariat qui prend conscience de plus en plus de ses intérêts de classe, progresse politiquement et s’organise pour la lutte contre la bourgeoisie
Le prolétariat est la classe de travailleurs liée à la forme d’avant-garde de l’économie, la grande production.
Étant donné le rôle économique qu’il joue dans la grande production, le prolétariat est seul capable d’être le guide de toutes les masses laborieuses et exploitées […]
( V. Lénine, « L’État et la révolution », Œuvres, t. 25, p. 437. )Le prolétariat industriel qui est la classe la plus révolutionnaire, la plus avancée de la société capitaliste, est appelé à réunir autour de lui les masses travailleuses de la paysannerie, toutes les couches exploitées de la population et de les mener à l’assaut du capitalisme.
Résumé du chapitre 7
-
En régime capitaliste, la base des rapports de production est la propriété capitaliste des moyens de production, utilisée pour l’exploitation des ouvriers salariés. Le capitalisme est la production marchande au plus haut degré de son développement, quand la force de travail elle-même devient marchandise. En tant que marchandise, la force de travail en régime capitaliste a une valeur et une valeur d’usage. La valeur de la marchandise force de travail est déterminée par la valeur des moyens de subsistance nécessaires à l’entretien de l’ouvrier et de sa famille. La valeur d’usage de la marchandise force de travail réside dans sa propriété d’être source de valeur et de plus-value.
-
La plus-value est la valeur créée par le travail de l’ouvrier en plus de la valeur de sa force de travail, et que le capitaliste accapare gratuitement La production de la plus-value est la loi économique fondamentale du capitalisme.
-
Le capital est de la valeur qui rapporte — au moyen de l’exploitation des ouvriers salariés — de la plus-value. Le capital incarne en lui le rapport social entre la classe des capitalistes et la classe ouvrière. Dans le cours de la production de la plus-value, les différentes parties du capital ne jouent pas un rôle identique. Le capital constant est la partie du capital qui est dépensée en moyens de production ; cette partie du capital ne crée pas de nouvelle valeur, ne change pas de grandeur. Le capital variable est la partie du capital qui est dépensée pour l’achat de la force de travail ; cette partie du capital augmente du fait de la création par les ouvriers d’une plus-value, que s’approprie le capitaliste.
-
Le taux de la plus-value est le rapport de la plus-value au capital variable. Il exprime le degré d’exploitation de l’ouvrier par le capitaliste. Les capitalistes augmentent le taux de plus-value par deux moyens : la production de la plus-value absolue et la production de la plus-value relative. La plus-value absolue est celle qui est créée par l’allongement de la journée de travail ou par l’intensification du travail. La plus-value relative est celle qui est créée par la réduction du temps de travail nécessaire et par l’augmentation correspondante du temps de surtravail.
-
Les intérêts de classe de la bourgeoisie et ceux du prolétariat sont inconciliables. La contradiction entre la bourgeoisie et le prolétariat constitue la principale contradiction de classe de la société capitaliste. L’État bourgeois, dictature de la bourgeoisie, est l’organe de protection du régime capitaliste et d’oppression de la majorité laborieuse et exploitée de la société.
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par Pcautunois le 14 Avril 2011 à 17:14
A. — Le capitalisme prémonopoliste
Chapitre 8 — Le salaire
8.1. Le prix de la force de travail. La nature du salaire.
Avec le mode de production capitaliste, la force de travail, comme toute autre marchandise, possède une valeur. La valeur de la force de travail, exprimée en argent, est le prix de la force de travail.
Le prix de la force de travail se distingue du prix des autres marchandises. Quand le producteur vend sur le marché, par exemple, de la toile, la somme d’argent qu’il en retire n’est autre chose que le prix de la marchandise vendue. Quand le prolétaire vend au capitaliste sa force de travail et en reçoit une somme d’argent déterminée sous forme de salaire, cette somme d’argent n’apparaît pas comme le prix de la marchandise force de travail, mais comme le prix du travail.
Cela tient à plusieurs causes. Premièrement, le capitaliste paye son salaire à l’ouvrier après que celui-ci a accompli son travail. En second lieu, le salaire est établi soit au prorata du temps de travail fourni (heures, jours, semaines), soit au prorata de la quantité du produit fabriqué. Prenons l’exemple de tout à l’heure. Supposons que l’ouvrier travaille 12 heures par jour. En 6 heures, il produit la valeur de 6 dollars, égale à la valeur de sa force de travail. Pendant les 6 autres heures, il produit la valeur de 6 dollars qui constitue la plus-value que le capitaliste s’approprie. L’entrepreneur ayant loué le prolétaire pour une journée de travail complète, lui paye pour ce total de 12 heures de travail 6 dollars. De là, l’apparence trompeuse selon laquelle le salaire serait le prix du travail, et 6 dollars le paiement complet de toute une journée de travail de 12 heures. En réalité, les 6 dollars ne représentent que la valeur journalière de la force de travail, tandis que le travail du prolétaire a créé une valeur égale à 12 dollars. Et si l’entreprise paye selon la quantité du produit fourni, l’apparence se crée que l’ouvrier est payé pour le travail dépensé par lui pour chaque unité de marchandise fabriquée, c’est-à-dire que, cette fois encore, tout le travail dépensé par l’ouvrier est payé intégralement.
Cette apparence trompeuse n’est pas une erreur due au hasard. Elle est engendrée par les conditions mêmes de la production capitaliste dans lesquelles l’exploitation est masquée, estompée, et où les rapports de l’entrepreneur et de l’ouvrier salarié sont présentés de façon déformée comme des rapports entre possesseurs égaux de marchandises.
En réalité, le salaire de l’ouvrier salarié n’est pas la valeur ou le prix de son travail. Si l’on admet que le travail est une marchandise ayant une valeur, la grandeur de cette valeur doit pouvoir se mesurer. Il est évident que la grandeur de la « valeur du travail », comme celle de toute autre marchandise, doit se mesurer par la quantité de travail qui y est incorporée. Une telle hypothèse conduit à un cercle vicieux : le travail est mesuré par le travail.
De plus, si le capitaliste payait à l’ouvrier la « valeur du travail », c’est-à-dire tout son travail, il n’y aurait pas de source d’enrichissement pour le capitaliste, pas de plus-value, autrement dit il ne pourrait y avoir de mode de production capitaliste.
Le travail est créateur de la valeur des marchandises, mais lui-même n’est pas une marchandise et ne saurait avoir une valeur. Ce qu’on appelle dans la vie courante la « valeur du travail » est en réalité la valeur de la force de travail.
Le capitaliste achète sur le marché non pas le travail, mais une marchandise particulière, la force de travail. La consommation de force de travail, c’est-à-dire la dépense d’énergie musculaire, nerveuse, cérébrale de l’ouvrier, est le processus du travail. La valeur de la force de travail est toujours inférieure à la valeur nouvellement créée par le travail de l’ouvrier. Le salaire n’est le paiement que d’une partie de la journée de travail, du temps de travail nécessaire. Mais comme le salaire apparaît sous forme de paiement du travail, on a l’impression que la journée de travail est payée intégralement. C’est pourquoi Marx qualifie le salaire dans la société bourgeoise de forme transformée de la valeur, ou du prix, de la force du travail.
Le salaire du travail n’est pas ce qu’il paraît être, à savoir la valeur (ou le prix) du travail, mais seulement une forme déguisée de la valeur (ou du prix) de la force de travail.
( K. Marx et F. Engels, Critique des programmes de Gotha et d’Erfurt, p. 30, Éditions sociales, Paris, 1950. )Le salaire est l’expression monétaire de la valeur de la force de travail, son prix qui apparaît extérieurement comme le prix du travail.
Sous le régime de l’esclavage, entre le maître et l’esclave, il n’y a pas de transaction vente-achat de la force de travail. L’esclave est la propriété du maître. C’est pourquoi il semble que tout le travail de l’esclave est fait gratuitement, que même la partie du travail qui couvre les frais d’entretien de l’esclave est un travail non payé, travail fait pour le compte du maître. Dans la société féodale, le travail nécessaire du paysan dans son exploitation et le surtravail sur le domaine du seigneur sont nettement délimités, dans le temps et l’espace. En régime capitaliste même le travail non payé de l’ouvrier salarié apparaît comme du travail payé.
Le salaire dissimule toutes les traces de la division de la journée de travail en temps de travail nécessaire et en temps de surtravail, en travail payé et non payé, et c’est ainsi qu’il masque le rapport d’exploitation capitaliste.
8.2. Les formes principales du salaire.
Les formes principales du salaire sont le salaire au temps et le salaire aux pièces.
Le salaire an temps est une forme de salaire dans laquelle la grandeur du salaire de l’ouvrier dépend du temps qu’il a fourni : heures, jours, semaines, mois. Il y a donc lieu de distinguer : le paiement à l’heure, à la journée, à la semaine, au mois.
Pour un salaire au temps de même grandeur, le salaire effectif de l’ouvrier peut être différent, selon la durée de la journée de travail.
La mesure de la rémunération de l’ouvrier pour le travail fourni par unité de temps est le prix d’une heure de travail. Bien que, comme on l’a déjà dit, le travail par lui-même n’ait pas de valeur, ni par conséquent de prix, pour déterminer la grandeur de la rémunération de l’ouvrier, on adopte l’appellation conventionnelle de « prix du travail ». L’unité de mesure du « prix du travail » est la rémunération ou le prix d’une heure de travail. Ainsi, si la durée moyenne de la journée de travail est de 12 heures, et si la valeur journalière moyenne de la force de travail est égale à 6 dollars, le prix moyen d’une heure de travail (600 cents : 12) sera égal à 50 cents.
Le salaire au temps permet au capitaliste de renforcer l’exploitation de l’ouvrier en allongeant la journée de travail, de diminuer le prix de l’heure de travail, en laissant inchangé le salaire journalier, hebdomadaire ou mensuel. Supposons que le salaire journalier demeure comme précédemment de 6 dollars, mais que la journée de travail passe de 12 à 13 heures ; en ce cas, le prix d’une heure de travail (600 cents : 13) s’abaissera de 50 à 46 cents. Sous la pression des revendications des ouvriers, le capitaliste est parfois contraint d’augmenter le salaire journalier (et, en proportion, les salaires hebdomadaire et mensuel), mais le prix d’une heure de travail peut rester invariable ou même diminuer. Ainsi, si le salaire journalier est augmenté de 6 dollars à 6 dollars 20 cents, la journée de travail passant de 12 à 14 heures, le prix d’une heure de travail tombera alors (620 cents : 14) à 44 cents.
Au fond, l’intensification du travail signifie aussi la baisse du prix de l’heure de travail car, avec une plus grande dépense d’énergie (ce qui équivaut en fait à l’allongement de la journée de travail) la rémunération reste la même. Avec la baisse du prix de l’heure de travail le prolétaire, pour vivre, est obligé d’accepter un nouvel allongement de la journée de travail. L’allongement de la journée de travail et l’intensification excessive du travail entraînent une dépense plus élevée de force de travail et son épuisement. Moins est payée chaque heure de travail, et plus grande est la quantité de travail ou bien plus longue est la journée de travail nécessaires pour que l’ouvrier soit assuré ne serait-ce que d’un faible salaire. D’autre part, la prolongation du temps de travail provoque à son tour une baisse de la rémunération de l’heure de travail. Le capitaliste utilise dans son intérêt le fait qu’avec l’allongement de la journée de travail ou avec l’intensification du travail, le salaire horaire baisse.
Quand les conditions de la vente des marchandises sont favorables, il allonge la journée de travail, introduit les heures supplémentaires, c’est-à-dire un travail en plus de la durée établie de la journée de travail. Mais si les conditions du marché sont défavorables et si le capitaliste est obligé de diminuer momentanément le volume de sa production, il réduit la journée de travail et introduit la rémunération à l’heure. La rémunération à l’heure, la journée ou la semaine de travail étant incomplètes, diminue notablement le salaire. Si, dans notre exemple, la journée de travail est diminuée de 12 à 6 heures avec maintien de l’ancien salaire horaire de 50 cents, le salaire à la journée de l’ouvrier sera de 3 dollars en tout, c’est-à-dire deux fois moins crue la valeur journalière de la force de travail. Par conséquent, l’ouvrier perd non seulement si la journée de travail est excessivement allongée, mais également quand il est obligé de travailler à temps réduit.
Le capitaliste peut maintenant extorquer à l’ouvrier un certain quantum de surtravail, sans lui accorder le temps de travail nécessaire à son entretien. Il peut anéantir toute régularité d’occupation et faire alterner arbitrairement, suivant sa commodité et ses intérêts du moment, le plus énorme excès de travail avec un chômage partiel ou complet.
( K. Marx, Le Capital, livre 1, t. 2, p. 216. )Avec le salaire au temps, la grandeur du salaire de l’ouvrier n’est pas en raison directe du degré d’intensité de son travail : si celui-ci augmente, le salaire au temps n’augmente pas, et le prix de l’heure de travail baisse en fait. Afin de renforcer l’exploitation, le capitaliste entretient des surveillants spéciaux, qui veillent au respect — par les ouvriers — de la discipline capitaliste du travail, ainsi qu’à son intensification ultérieure.
Le salaire au temps était appliqué dès les premières phases du développement du capitalisme, quand l’entrepreneur qui ne rencontrait pas encore de résistance tant soit peu organisée de la part des ouvriers, pouvait rechercher un accroissement de la plus-value en allongeant la journée de travail. Mais le salaire au temps se maintient aussi au stade supérieur du capitalisme. Dans nombre de cas, il offre au capitaliste de notables avantages : en accélérant la vitesse des machines, le capitaliste fait travailler les ouvriers avec plus d’intensité, sans augmenter pour autant leur salaire.
Le salaire aux pièces est une forme de salaire dans laquelle la grandeur du salaire de l’ouvrier dépend de la quantité d’articles ou de pièces détachées fabriquées en une unité de temps, ou bien du nombre des opérations exécutées. Avec le salaire au temps, le travail dépensé par l’ouvrier se mesure par sa durée ; avec le salaire aux pièces, par la quantité des articles fabriqués (ou des opérations exécutées), dont chacun est payé d’après un tarif déterminé.
En fixant les tarifs, le capitaliste tient compte, premièrement, du salaire au temps journalier et, en second lieu, de la quantité d’articles ou de pièces que l’ouvrier fournit au cours d’une journée, en prenant d’ordinaire pour norme le plus haut rendement de l’ouvrier. Si, dans une branche de production donnée, la moyenne du salaire au temps est de 6 dollars par jour, et si la quantité d’articles d’une espèce déterminée fabriqués par l’ouvrier est de 60 unités, le tarif aux pièces pour un article ou une pièce détachée sera de 10 cents. Le tarif aux pièces est établi par le capitaliste de telle sorte que le salaire par heure (par jour, par semaine) ne soit pas supérieur au salaire au temps. Ainsi, le salaire aux pièces est, à l’origine, une forme modifiée du salaire au temps.
Le salaire aux pièces, plus encore que le salaire au temps, crée l’illusion que l’ouvrier vend au capitaliste non pas sa force de travail, mais son travail et reçoit une rémunération complète, proportionnelle à la quantité de production fournie.
Le salaire aux pièces capitaliste aboutit à l’intensification constante du travail. Il facilite, d’autre part, pour l’entrepreneur la surveillance des ouvriers. Le degré d’intensité du travail est contrôlé ici par la quantité et la qualité des produits que l’ouvrier doit confectionner pour acquérir les moyens de subsistance qui lui sont nécessaires. L’ouvrier est obligé d’augmenter le rendement aux pièces, de travailler avec de plus en plus d’intensité. Mais dès qu’une partie plus ou moins importante des ouvriers atteint un niveau plus élevé d’intensité du travail, le capitaliste diminue les tarifs aux pièces. Si, dans notre cas, le tarif aux pièces est diminué, par exemple, de moitié, l’ouvrier pour conserver le salaire précédent est obligé de travailler le double, c’est-à-dire d’augmenter son temps de travail ou d’intensifier son travail encore davantage pour produire dans le cours d’une journée non plus 60, mais 120 pièces.
L’ouvrier cherche à conserver la masse de son salaire en travaillant davantage, soit en faisant plus d’heures, soit en fournissant davantage dans la même heure… Le résultat est que plus il travaille, moins il reçoit de salaire.
( K. Marx, Travail salarié et capital suivi de Salaire, prix et profit, p. 42, Éditions sociales, Paris, 1952. )C’est là la particularité essentielle du salaire aux pièces en régime capitaliste.
Les formes de salaire au temps et aux pièces sont appliquées assez souvent simultanément dans les mêmes entreprises. En régime capitaliste, ces deux formes de salaire ne sont que des méthodes différentes pour renforcer l’exploitation de la classe ouvrière.
Le salaire aux pièces capitaliste se trouve à la base des systèmes de surexploitation pratiqués dans les pays bourgeois.
8.3. Les systèmes de salaires de surexploitation.
Un trait essentiel du salaire aux pièces capitaliste est l’intensification excessive du travail qui épuise toutes les forces du travailleur. Cependant le salaire ne compense pas les dépenses accrues de force de travail. Au-delà d’une certaine durée et d’une certaine intensité du travail, aucune compensation additionnelle n’est capable de conjurer la destruction pure et simple de la force de travail.L’emploi, dans les entreprises capitalistes, de méthodes d’organisation du travail exténuantes, amène généralement, en fin de journée, un surmenage des forces musculaires et nerveuses de l’ouvrier, qui conduit à la baisse de la productivité du travail. Soucieux d’augmenter sa plus-value, le capitaliste a recours à toutes sortes de systèmes de salaires fondés sur le surmenage pour obtenir une haute intensité du travail durant toute la journée. En régime capitaliste, l’ « organisation scientifique du travail » poursuit les mêmes buts. Les formes les plus répandues de cette organisation du travail, avec application de systèmes de salaire qui épuisent complètement le travailleur, sont le taylorisme et le fordisme, à la base desquels se trouve le principe de l’intensification maxima du travail.
Le taylorisme (système qui porte le nom de son auteur, l’ingénieur américain F. Taylor) consiste essentiellement en ceci : On choisit dans l’entreprise les ouvriers les plus forts et les plus habiles. On les fait travailler avec le maximum d’intensité. L’exécution de chacune des opérations est évaluée en secondes et en fractions de secondes. Sur la base des données du chronométrage, on établit le régime de production et les normes de temps de travail pour l’ensemble des ouvriers. La norme — la « tâche » — étant dépassée, l’ouvrier reçoit un petit supplément à son salaire journalier, une prime ; si la norme n’est pas remplie, l’ouvrier est payé d’après des tarifs fortement diminués. L’organisation capitaliste du travail d’après le système Taylor épuise complètement les forces de l’ouvrier, fait de lui un automate qui exécute mécaniquement toujours les mêmes mouvements.
Lénine cite un exemple concret (le chargement de la fonte dans une benne), qui montre qu’avec l’introduction du système Taylor le capitaliste a pu, rien que pour l’exécution d’une seule opération, réduire le nombre des ouvriers de 500 à 140, soit de 72 % ; c’est en intensifiant monstrueusement le travail qu’on est arrivé à augmenter la norme journalière de l’ouvrier occupé au chargement, de 16 à 59 tonnes, soit de 270 %. En accomplissant, durant une journée, un travail qui demandait auparavant trois ou quatre jours, l’ouvrier voit son salaire journalier augmenter nominalement (et seulement dans les premiers temps) de 63 % au total. En d’autres termes, avec l’introduction de ce système de paiement, le salaire journalier de l’ouvrier a diminué en fait, par rapport aux dépenses de travail, de 56,5 %. « Et le résultat, écrivait Lénine, c’est qu’en neuf ou dix heures de travail, on arrive à pressurer l’ouvrier pour lui faire produire trois plus de travail, on l’épuise sans pitié, on pompe avec une vitesse triplée chaque goutte d’énergie nerveuse et musculaire de l’esclave salarié. Et s’il meurt plus avant l’âge ? Il y en a beaucoup d’autres qui attendent à la porte !… » (V. Lénine : « Un système “scientifique” pour pressurer l’ouvrier », Œuvres, t. 18, p. 619.)
Cette organisation du travail et du salaire ouvrier, Lénine l’a qualifiée de sweating-system scientifique.
Le système d’organisation du travail et du salaire, introduit par le « roi de l’automobile » américain H. Ford et beaucoup d’autres capitalistes (système du fordisme) poursuit le même but : tirer de l’ouvrier la plus grande quantité de plus-value sur la base de l’intensification maxima du travail. On y arrive en accélérant le plus possible les cadences des chaînes et en introduisant des systèmes de salaires de surexploitation. La simplicité des opérations sur les chaînes de Ford permet d’employer largement les ouvriers non qualifiés et d’établir pour eux de bas salaires. L’intensification énorme du travail ne s’accompagne pas d’une augmentation des salaires ou d’une réduction de la journée de travail. Il s’ensuit donc que l’ouvrier s’use rapidement, devient invalide : on le renvoie de l’entreprise pour incapacité, et il va grossir les rangs des chômeurs.
Le renforcement de l’exploitation des ouvriers s’obtient aussi par d’autres systèmes d’organisation du travail et des salaires, qui sont des variétés du taylorisme et du fordisme. Parmi eux, citons par exemple, le système de Hantt (États-Unis). Contrairement au système de salaire aux pièces de Taylor, le système de Hantt est un système de salaire au temps et aux primes. On assigne à l’ouvrier une « tâche » et on lui fixe un paiement garanti très bas par unité de temps fourni, indépendamment de l’exécution de la norme. On paye à l’ouvrier qui accomplit la « tâche » un petit supplément au minimum garanti, une « prime ». À la base du système Halsey (États-Unis) se trouve le principe du paiement d’une prime pour le temps « économisé » en supplément de « la paye moyenne » par heure de travail. Avec ce système, par exemple, si l’intensité du travail est doublée, chaque heure « économisée » comporte une « prime » de l’ordre d’un tiers environ de la rémunération horaire. Dans ces conditions, plus le travail est intense, et plus le salaire de l’ouvrier diminue par rapport au travail qu’il a dépensé. Le système Rowan (Angleterre) repose sur les mêmes principes.
Un des moyens d’augmenter la plus-value, qui n’est qu’une duperie des ouvriers, est celui que l’on appelle participation des ouvriers aux bénéfices. Sous prétexte d’intéresser l’ouvrier à l’augmentation de la rentabilité de l’entreprise, le capitaliste diminue le salaire de base et organise ainsi un fonds de « répartition des bénéfices entre ouvriers ». Puis, en fin d’année, sous forme de « bénéfices », on remet en fait à l’ouvrier la retenue effectuée précédemment sur son salaire. En fin do compte, l’ouvrier « qui participe aux bénéfices » reçoit en fait une somme inférieure à son salaire habituel. Dans le même but, on pratique le placement parmi les ouvriers d’actions d’une entreprise donnée.
Les subterfuges des capitalistes, quel que soit le système de rémunération, visent à tirer de l’ouvrier la plus grande quantité possible de plus-value. Les entrepreneurs utilisent tous les moyens pour intoxiquer la conscience des ouvriers par l’intérêt qu’ils ont soi-disant à voir s’intensifier le travail, diminuer les dépenses de salaires par unité de production, augmenter la rentabilité de l’entreprise. C’est ainsi que les capitalistes s’efforcent d’affaiblir la résistance du prolétariat face à l’offensive du capital, d’obtenir la scission du mouvement ouvrier, le refus des ouvriers de se syndiquer, de prendre part aux grèves. Malgré la multiplicité des formes du salaire aux pièces capitaliste, son essence reste inchangée : avec l’intensification du travail, de sa productivité, le salaire de l’ouvrier diminue en fait, les revenus du capitaliste augmentent.
8.4. Le salaire nominal et le salaire réel.
Aux premiers stades du développement du capitalisme, la rémunération des salariés en nature était pratiquée sur une grande échelle : l’ouvrier recevait un gîte, une maigre pitance et un peu d’argent.
Le salaire en nature subsiste dans une certaine mesure à la période du machinisme. Il était pratiqué, par exemple, dans l’industrie extractive et textile de la Russie d’avant la Révolution. La rémunération en nature est répandue dans l’agriculture capitaliste, lorsqu’elle utilise le travail des ouvriers agricoles, dans certaines industries des pays capitalistes, dans les pays coloniaux et dépendants. Les formes de rémunération en nature sont variées. Les capitalistes mettent les ouvriers dans une situation qui les contraint à prendre à crédit les produits dans le magasin de l’usine, à utiliser les logements de la mine ou des plantations, à des conditions onéreuses établies par l’entrepreneur, etc. Le capitaliste, en payant un salaire en nature, exploite l’ouvrier salarié non seulement comme vendeur de la force de travail, mais aussi comme consommateur.
Le salaire en argent est caractéristique du mode de production capitaliste évolué.
Il faut distinguer entre le salaire nominal et le salaire réel.
Le salaire nominal est celui qui est exprimé en argent ; c’est la somme d’argent que l’ouvrier reçoit pour la force de travail qu’il a vendue au capitaliste. Le salaire nominal ne donne pas par lui-même une idée du niveau réel de la rémunération de l’ouvrier. Il peut, par exemple, demeurer inchangé, mais si, en même temps, les prix des objets de consommation et les impôts augmentent, le salaire effectif de l’ouvrier baissera. Le salaire nominal peut même augmenter, mais si le coût de la vie durant cette période vient à s’élever plus encore que le salaire nominal, le salaire effectif diminuera.
Le salaire réel est celui qui s’exprime en moyens de subsistance de l’ouvrier ; il indique la quantité et la qualité des objets de consommation et des services que l’ouvrier peut se procurer pour son salaire en argent. Pour déterminer le salaire réel de l’ouvrier, il faut partir du taux du salaire nominal, du niveau des prix des objets de consommation, du loyer, des charges fiscales acquittées par l’ouvrier, des journées non payées avec la semaine de travail réduite, du nombre des chômeurs totaux et partiels qui sont entretenus aux frais de la classe ouvrière. Il faut tenir compte également de la durée de la journée de travail et du degré d’intensité du travail.
En établissant le niveau moyen du salaire, les statistiques bourgeoises déforment la réalité : elles rangent dans la catégorie des salaires les revenus des couches dirigeantes de la bureaucratie industrielle et financière (administrateurs d’entreprises, directeurs de banques, etc.), n’introduisent dans leurs calculs que le salaire des ouvriers qualifiés et en excluent celui de la couche nombreuse des ouvriers non qualifiés et mal payés, du prolétariat agricole ; elles ne font pas état de l’armée nombreuse des chômeurs totaux ou partiels, de la hausse des prix des objets de consommation courante et du relèvement des impôts ; elles ont recours à d’autres méthodes de falsification pour présenter sous un jour favorable la situation de fait de la classe ouvrière en régime capitaliste.
Mais même les statistiques bourgeoises falsifiées ne peuvent dissimuler le fait que le salaire en régime capitaliste, par suite de son bas niveau, du renchérissement du coût de la vie et de la croissance du chômage, n’assure pas à la majorité des ouvriers le minimum vital.
En 1938, les économistes bourgeois des États-Unis, adoptant des normes très inférieures, ont évalué pour les États-Unis le minimum vital d’une famille ouvrière de quatre personnes, à 2 177 dollars par an. Or, en 1938 la moyenne du salaire annuel d’un ouvrier industriel aux États-Unis était de 1 176 dollars, soit un peu plus de la moitié de ce minimum vital, et en tenant compte des chômeurs, de 740 dollars, c’est-à-dire un tiers seulement de ce minimum vital. En 1937, le minimum vital très restreint d’une famille ouvrière moyenne en Angleterre était évalué par les économistes bourgeois à 55 shillings par semaine. D’après les chiffres officiels, 80 % des ouvriers de l’industrie houillère, 75 % des ouvriers de l’industrie extractive (sans l’industrie houillère), 57 % des ouvriers des entreprises municipales d’Angleterre gagnaient moins que ce minimum vital.
8.5. La baisse du salaire réel en régime capitaliste.
Sur la base de l’analyse du mode de production capitaliste, Marx a établi la loi fondamentale suivante en ce qui concerne le salaire.
La tendance générale de la production capitaliste n’est pas d’élever le salaire normal moyen, mais de l’abaisser.
( K. Marx, Travail salarié et capital, suivi de Salaire, prix et profit, p. 114. )Le salaire en tant que prix de la force de travail, de même que le prix de toute marchandise, est déterminé par la loi de la valeur. Les prix des marchandises dans l’économie capitaliste oscillent autour de leur valeur sous l’influence de l’offre et de la demande. Mais à la différence des prix des autres marchandises, le prix de la force de travail, en règle générale, oscille au-dessous de sa valeur.
Le décalage du salaire par rapport à la valeur de la force de travail est dû avant tout au chômage. Le capitaliste entend acheter la force de travail à meilleur compte. Avec le chômage, l’offre de la force de travail excède la demande. Ce qui distingue la marchandise force de travail des autres marchandises, c’est que le prolétaire ne peut en différer la vente. Pour ne pas mourir de faim, il est obligé de la vendre aux conditions que lui offre le capitaliste. Dans les périodes de chômage total ou partiel l’ouvrier ou bien ne reçoit aucun salaire ou un salaire considérablement réduit. Le chômage accentue la concurrence entre ouvriers. Le capitaliste en profite et paye à l’ouvrier un salaire inférieur à la valeur de sa force de travail. Ainsi donc, la situation misérable des chômeurs, qui font partie de la classe ouvrière, influe sur la situation matérielle des ouvriers occupés à la production, abaisse le niveau de leur salaire.
Ensuite, le machinisme ouvre aux capitalistes de larges possibilités de remplacer dans la production la main-d’œuvre masculine par le travail des femmes et des enfants. La valeur de la force de travail est déterminée par la valeur des moyens de subsistance nécessaires à l’ouvrier et à sa famille. Aussi, lorsque la femme et les enfants de l’ouvrier sont entraînés dans la production, le salaire diminue, toute la famille reçoit dès lors à peu près autant que recevait auparavant le seul chef de famille. L’exploitation de la classe ouvrière dans son ensemble s’en trouve encore aggravée. Dans les pays capitalistes, les ouvrières qui fournissent un travail égal à celui de l’homme touchent un salaire sensiblement inférieur.
Le capital extorque la plus-value par une exploitation effrénée de la main-d’œuvre enfantine. Le salaire des enfants et des adolescents dans tous les pays capitalistes et coloniaux est de plusieurs fois inférieur à celui des ouvriers adultes.
Le salaire moyen d’une ouvrière était inférieur au salaire moyen d’un ouvrier, aux États-Unis (en 1949) de 41 %, en Angleterre (en 1951) de 46 %, en Allemagne occidentale (en 1951) de 42 %. Cette différence est encore plus importante dans les pays coloniaux et dépendants.
Aux États-Unis, en 1949, selon des données inférieures à la réalité, on compte parmi les salariés plus de 3,3 millions d’enfants et d’adolescents. La durée de la journée de travail des enfants et des adolescents est très longue. Ainsi dans les amidonneries, les usines de conserves et de viande, dans les blanchisseries et les entreprises pour le dégraissage des vêtements, les enfants travaillent de 12 à 13 heures par jour.
Au Japon, on pratique couramment la vente des enfants pour le travail dans les fabriques. La main-d’œuvre enfantine était largement employée dans la Russie des tsars. Une partie assez importante des ouvriers des fabriques textiles et de certaines autres entreprises se composait d’enfants de 8 à 10 ans. Dans l’industrie cotonnière de l’Inde les enfants forment de 20 à 25 % de la totalité des ouvriers. L’exploitation de la main-d’œuvre enfantine par le capital prend des formes particulièrement féroces dans les pays coloniaux et dépendants. En Turquie, dans les fabriques de textile et les manufactures de tabac, les enfants de 7 à 14 ans travaillent, tout comme les adultes, une journée complète.
Les bas salaires des ouvrières et l’exploitation des enfants provoquent de nombreuses maladies, un accroissement de la mortalité infantile, exercent une action néfaste sur l’éducation et l’instruction des jeunes générations.
La baisse du salaire réel des ouvriers est aussi conditionnée par le fait qu’avec le développement du capitalisme, la situation d’une grande partie des ouvriers qualifiés s’aggrave. Comme on l’a déjà dit, la valeur de la force de travail comprend aussi les frais nécessités par l’apprentissage du travailleur. Le travailleur qualifié crée dans une unité de temps plus de valeur, donc plus de plus-value, que l’ouvrier non spécialisé. Le capitaliste est obligé de payer le travail qualifié plus que le travail des manœuvres. Mais avec le développement du capitalisme et le progrès technique, d’une part, on demande des ouvriers hautement qualifiés, capables de manier des mécanismes complexes ; d’autre part, beaucoup d’opérations sont simplifiées, le travail d’une partie importante des ouvriers qualifies devient mutile. De larges couches d’ouvriers spécialisés perdent leur qualification, ils sont éliminés de la production et se voient obligés de faire un travail non qualifié, payé beaucoup moins.
L’augmentation du coût de la vie et la baisse du niveau du salaire réel qu’elle entraîne sont déterminées avant tout par la hausse des prix systématique des objets de consommation courante. Ainsi, en France, par suite de l’inflation, les prix de détail des denrées alimentaires en 1938 avaient dépassé de plus de sept fois leur niveau de 1914.
Le loyer absorbe une grande partie du salaire de l’ouvrier. En Allemagne, de 1900 à 1930, le loyer a augmenté en moyenne de 69 %. D’après les chiffres du Bureau International du Travail, après 1930, les ouvriers dépensaient pour le loyer, le chauffage et l’éclairage aux États-Unis 25 %, en Angleterre 20 %, au Canada 27 % du budget de la famille. Dans la Russie tsariste, les frais de logement chez les ouvriers atteignaient jusqu’à un tiers du salaire.
Une somme importante à décompter du salaire est constituée par les impôts perçus sur les travailleurs. Dans les principaux pays capitalistes, après la guerre, les contributions directes et indirectes absorbent au moins un tiers du salaire de la famille ouvrière.
Un moyen très répandu de réduire le salaire est le système des amendes. En Russie tsariste, avant la promulgation de la loi sur les amendes (1886), qui limita un peu l’arbitraire des fabricants, les retenues sur les salaires sous forme d’amendes atteignaient, dans certains cas, la moitié du salaire mensuel. On infligeait des amendes à tout propos : pour un « travail mal fait », pour « infraction au règlement », pour bavardage, participation à une manifestation, etc. Les amendes sont non seulement un moyen de renforcer la discipline capitaliste du travail, mais aussi une source de revenu supplémentaire pour le capitaliste.
La baisse du salaire réel est également conditionnée par les salaires extrêmement bas du prolétariat agricole. La grande armée de travailleurs en surnombre de la campagne exerce une pression constante sur le niveau des salaires des ouvriers occupés, dans le sens de la baisse.
Ainsi, par exemple, de 1910 à 1939, le salaire moyen mensuel de l’ouvrier agricole aux États-Unis a oscillé entre 28 et 47 % du salaire de l’ouvrier d’usine. La situation des ouvriers agricoles de la Russie tsariste était extrêmement dure. Avec une journée de 16 à 17 heures de travail, le salaire journalier moyen d’un ouvrier agricole saisonnier, en Russie, de 1901 à 1910, était de 69 kopeks, et avec ce salaire dérisoire qu’il touchait durant la période des travaux des champs, il lui fallait se tirer d’embarras pendant les autres mois de chômage complet ou partiel.
Ainsi, avec le développement du mode de production capitaliste, le salaire réel de la classe ouvrière est en baisse.
En 1924, le salaire réel des ouvriers allemands, par rapport au niveau de 1900, était de 75 % ; en 1935, de 66 %. Aux États-Unis, de 1900 à 1938, le salaire nominal moyen (compte tenu des chômeurs) a augmenté de 68 % ; mais, pour la même période, le coût de la vie a été multiplié par 2,3, ce qui ramenait le salaire réel des ouvriers en 1938 à 74 % du niveau de 1900 ; en France, en Italie, au Japon, sans parler des pays coloniaux et dépendants, la baisse du salaire réel, au cours des 19e et 20e siècles, a été beaucoup plus sensible qu’aux États-Unis. En Russie tsariste, en 1913, le salaire réel des ouvriers d’usine était tombé à 90 % du niveau de 1900.
Dans les différents pays, la valeur de la force de travail est inégale. Les conditions qui déterminent la valeur de la force de travail changent dans chaque pays. De là des différences nationales dans le salaire. Marx écrivait qu’en comparant les salaires dans les différents pays, il fallait mettre en ligne de compte tous les facteurs qui déterminent des modifications dans la grandeur de la valeur de la force de travail : les conditions historiques qui ont présidé à la constitution de la classe ouvrière, ainsi que le niveau de ses besoins, les dépenses nécessitées par la formation de l’ouvrier, le rôle de la main-d’œuvre féminine et enfantine, la productivité du travail et son intensité, les prix des objets de consommation, etc.
On observe un niveau particulièrement bas des salaires dans les pays coloniaux et dépendants. Dans sa politique d’asservissement et de pillage systématique des pays coloniaux et dépendants, le capital bénéficie d’un important excédent de main-d’œuvre dans ces pays et rétribue la force de travail à un prix de beaucoup inférieur à sa valeur. Ce faisant, on tient compte de la nationalité de l’ouvrier. Ainsi, par exemple, les Blancs et les Noirs, qui fournissent un travail égal sont payés différemment. En Afrique du Sud, le salaire moyen du Noir est le dixième du salaire moyen de l’ouvrier anglais. Aux États-Unis, le salaire des Noirs dans les villes est inférieur de 60 % et, dans l’agriculture, de 66 % à celui des Blancs pour un même travail.
En diminuant les salaires de la masse essentielle des ouvriers et en pillant les colonies, la bourgeoisie crée des conditions privilégiées pour une couche relativement réduite d’ouvriers hautement qualifiés. La bourgeoisie utilise cette aristocratie ouvrière, formée de ces couches hautement payées et comprenant des représentants de la bureaucratie des syndicats et des coopératives, une partie des contremaîtres, etc., pour diviser le mouvement ouvrier et intoxiquer la conscience de la grande masse des prolétaires en prêchant la paix sociale, la communauté des intérêts des exploiteurs et des exploités.
8.6. La lutte de la classe ouvrière pour l’augmentation des salaires.
Dans chaque pays, le niveau du salaire est établi sur la base de la loi de la valeur, à la suite d’une lutte de classe acharnée entre le prolétariat et la bourgeoisie.
Les écarts du salaire par rapport à la valeur de la force de travail ont leurs limites.
La limite minima du salaire en régime capitaliste est déterminée par des conditions purement physiques : l’ouvrier doit disposer de la quantité de moyens de subsistance qui lui est absolument nécessaire pour s’entretenir et reproduire sa force de travail.
Quand il tombe à ce minimum, le prix [de la force de travail] est descendu au-dessous de la valeur de la force de travail, qui alors ne fait plus que végéter.
( K. Marx, Le Capital, livre 1, t. 1, p. 176. )Lorsque le salaire descend au-dessous de cette limite, il se produit un processus accéléré de destruction physique pure et simple de la force de travail, de dépérissement de la population ouvrière. Il s’exprime par une diminution de la durée moyenne de la vie, un abaissement de la natalité, une augmentation de la mortalité de la population ouvrière aussi bien dans les pays capitalistes développés que surtout dans les colonies.
La limite maxima du salaire en régime capitaliste est la valeur de la force de travail. Le niveau moyen du salaire se rapproche plus ou moins de cette limite selon le rapport des forces de classe du prolétariat et de la bourgeoisie.
Dans sa chasse aux profits, la bourgeoisie cherche à abaisser le salaire au-dessous de la limite du minimum physique. La classe ouvrière lutte contre les amputations du salaire, pour son augmentation, pour l’établissement d’un minimum garanti, pour l’introduction des assurances sociales et la réduction de la journée de travail. Dans cette lutte, la classe ouvrière fait face à la classe des capitalistes dans son ensemble et à l’État bourgeois.
La lutte acharnée de la classe ouvrière pour l’augmentation des salaires a commencé en même temps que naissait le capitalisme industriel. Elle s’est déroulée d’abord en Angleterre, puis dans les autres pays capitalistes et coloniaux.
À mesure que le prolétariat se forme en tant que classe, les ouvriers, pour mener à bien la lutte économique, s’unissent en syndicats. Aussi l’entrepreneur se trouve-t-il en face non plus d’un prolétaire isolé, mais de toute une organisation. Avec le développement de la lutte de classe, à côté des organisations professionnelles locales et nationales se créent des fédérations syndicales internationales. Les syndicats sont une école de la lutte de classe pour les grandes masses des ouvriers.
Les capitalistes forment de leur côté des unions patronales. Ils corrompent les chefs des syndicats réactionnaires, organisent les briseurs de grèves, divisent les organisations ouvrières, utilisent pour réprimer le mouvement ouvrier la police, la troupe, les tribunaux et les prisons.
Un des moyens efficaces de lutte des ouvriers pour l’augmentation des salaires, la réduction de la journée de travail et l’amélioration des conditions de travail en régime capitaliste, est la grève. À mesure que les antagonismes de classe s’aggravent et que le mouvement prolétarien se renforce dans les pays capitalistes et coloniaux, des millions d’ouvriers sont entraînés dans les mouvements de grève. Lorsque les ouvriers en lutte contre le capital font preuve de résolution et de ténacité, les grèves économiques obligent les capitalistes à accepter les conditions des grévistes.
C’est seulement grâce à la lutte opiniâtre de la classe ouvrière pour ses intérêts vitaux que les États bourgeois sont amenés à promulguer des lois sur le salaire minimum, la réduction de la journée de travail, la limitation du travail des enfants.
La lutte économique du prolétariat a une grande importance : avec une direction judicieuse, animée d’une haute conscience de classe, les syndicats résistent avec succès au patronat. La lutte de la classe ouvrière arrête dans une certaine mesure la chute des salaires. Mais la lutte économique de la classe ouvrière est impuissante à supprimer les lois du capitalisme et à soustraire les ouvriers à l’exploitation et aux privations.
Tout en reconnaissant le rôle important de la lutte économique de la classe ouvrière contre la bourgeoisie, le marxisme-léninisme enseigne que cette lutte est dirigée uniquement contre les conséquences du capitalisme et non contre la cause première de l’oppression et de la misère du prolétariat. Cette cause est le mode de production capitaliste lui-même.
C’est seulement par la lutte politique révolutionnaire que la classe ouvrière peut supprimer le système d’esclavage salarié, source de son oppression économique et politique.
Résumé du chapitre 8
-
Le salaire dans la société capitaliste est l’expression monétaire de la valeur de la force de travail, son prix qui apparaît comme le prix du travail. Le salaire masque le rapport de l’exploitation capitaliste, en créant une apparence trompeuse qui fait croire que l’ouvrier est payé pour tout le travail fourni, alors qu’en réalité le salaire n’est que le prix de sa force de travail.
-
Les formes essentielles du salaire sont le salaire au temps et le salaire aux pièces. Avec le salaire au temps, la grandeur du gain de l’ouvrier se trouve dépendre du temps qu’il a fourni. Avec le salaire aux pièces, la grandeur du gain de l’ouvrier est déterminée par la quantité des articles fabriqués par lui. Afin d’augmenter la plus-value, les capitalistes appliquent toutes sortes de systèmes de surexploitation qui mènent à l’intensification extrême du travail et à la prompte usure de la force de travail.
-
Le salaire nominal est la somme d’argent que l’ouvrier reçoit pour la force de travail qu’il vend au capitaliste. Le salaire réel est le salaire exprimé en moyens de subsistance de l’ouvrier ; il indique la quantité de moyens de subsistance et de services que l’ouvrier peut acheter avec son salaire.
-
Le développement du capitalisme a pour effet de diminuer le salaire réel. Contrairement au prix des autres marchandises, le prix de la force de travail, en règle générale, oscille au-dessous de sa valeur. Cela est dû avant tout au chômage, à l’emploi en grand du travail des femmes et des enfants, au salaire extrêmement bas des ouvriers agricoles, et aussi des ouvriers des pays coloniaux et dépendants. L’augmentation des prix des objets de consommation, les loyers élevés et l’accroissement des impôts sont des éléments importants de la baisse du salaire réel.
-
La classe ouvrière, unie dans les syndicats, lutte pour la réduction de la journée de travail et pour l’augmentation du salaire. La lutte économique du prolétariat contre le capital ne peut, par elle-même, le soustraire à l’exploitation. Ce n’est qu’avec la liquidation du mode de production capitaliste, par la lutte politique révolutionnaire, que seront éliminées les conditions de l’oppression économique et politique de la classe ouvrière.
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par Pcautunois le 13 Avril 2011 à 14:07
A. — Le capitalisme prémonopoliste
Chapitre 9 — L’accumulation du capital et la paupérisation du prolétariat
9.1. La production et la reproduction.
Pour vivre et se développer, la société doit produire des biens matériels. Elle ne peut en arrêter la production, comme elle ne peut s’arrêter de consommer.
De jour en jour, d’une année à l’autre, les hommes consomment du pain, de la viande et d’autres aliments, usent vêtements et chaussures, mais en même temps des quantités nouvelles de pain, de viande, de vêtements, de chaussures et d’autres produits sont fabriquées par le travail de l’homme. Le charbon est brûlé dans les poêles et les chaufferies, mais en même temps de nouvelles quantités de charbon sont extraites des entrailles de la terre. Les machines s’usent peu à peu, les locomotives vieillissent tôt ou tard, mais dans les entreprises on fabrique de nouvelles machines-outils, de nouvelles locomotives. Quelle que soit la structure des rapports sociaux, le processus de production doit constamment se renouveler.
Ce renouvellement incessant, cette répétition ininterrompue du processus de production porte le nom de reproduction.
Considéré, non sous son aspect isolé, mais dans le cours de sa rénovation incessante, tout procès de production sociale est donc en même temps procès de reproduction.
( K. Marx, Le Capital, livre 1, t. 2,p. 9. )Les conditions de la production sont aussi celles de la reproduction. Si la production revêt la forme capitaliste, la reproduction revêt la même forme.
Le processus de reproduction consiste non seulement en ce que les hommes fabriquent des quantités toujours nouvelles de produits pour remplacer et au-delà les produits consommés, mais aussi en ce que, dans la société, les rapports de production correspondants se renouvellent sans cesse.
Il faut distinguer deux types de reproduction : la reproduction simple et la reproduction élargie.
La reproduction simple est la répétition du processus de production dans ses proportions précédentes, les produits nouvellement fabriqués ne faisant que compenser la dépense des moyens de production et des objets de consommation individuelle.
La reproduction élargie est la répétition du processus de production dans des proportions plus étendues, la société ne se bornant pas à compenser les biens matériels consommés, mais produisant, en plus, un supplément de moyens de production et d’objets de consommation.
Avant l’apparition du capitalisme, les forces productives se développaient avec beaucoup de lenteur. Le volume de la production sociale ne s’est guère modifié d’une année à l’autre, d’une décennie à l’autre. Avec le capitalisme, l’état ancien d’immobilisme relatif et de stagnation de la production sociale a fait place à un développement beaucoup plus rapide des forces productives. La reproduction élargie, interrompue par des crises économiques, au cours desquelles il y a une baisse de la production, est caractéristique du mode de production capitaliste.
9.2. La reproduction capitaliste simple.
Avec la reproduction capitaliste simple, le processus de production se renouvelle sans changer de volume ; la plus-value est entièrement dépensée par le capitaliste pour sa consommation personnelle. L’analyse de la reproduction simule suffit déjà pour approfondir l’étude de certains traits essentiels du capitalisme.
Dans le processus de reproduction capitaliste se renouvellent sans cesse non seulement les produits du travail, mais aussi les rapports d’exploitation capitalistes. D’une part, dans le cours de la reproduction se crée constamment la richesse qui appartient au capitaliste et qu’il utilise pour s’approprier la plus-value. Au terme de chaque processus de production, l’entrepreneur se retrouve en possession d’un capital qui lui permet de s’enrichir par l’exploitation des ouvriers. D’autre part, l’ouvrier demeure à l’issue du processus de production un prolétaire non possédant ; il est donc obligé, pour ne pas mourir de faim, de vendre sans cesse sa force de travail au capitaliste. La reproduction de la force de travail salariée demeure la condition nécessaire de la reproduction du capital.
Le procès de production capitaliste reproduit donc de lui-même la séparation entre travailleur et conditions de travail. Il reproduit et éternise par cela même les conditions qui forcent l’ouvrier à se vendre pour vivre et mettent le capitaliste en état de l’acheter pour s’enrichir.
( K. Marx, Le Capital, livre 1, t. 3, p. 19-20. )Ainsi, dans le processus de production, le rapport capitaliste fondamental se renouvelle constamment : le capitaliste d’un côté, l’ouvrier salarié de l’autre. L’ouvrier, avant même d’aliéner sa force de travail à tel ou tel entrepreneur, appartient déjà au capitaliste collectif, c’est-à-dire à la classe des capitalistes dans son ensemble. Lorsque le prolétaire change de lieu de travail, il ne fait que changer d’exploiteur. L’ouvrier est sa vie durant enchaîné au char du capital.
Si l’on considère un processus de production isolé, il semble à première vue qu’en achetant la force de travail, le capitaliste prélève sur ses propres fonds une somme d’argent pour l’avancer à l’ouvrier, puisque, à la date du paiement du salaire, le capitaliste peut ne pas avoir eu le temps de vendre la marchandise fabriquée par l’ouvrier dans une période donnée (par exemple en un mois). Mais si l’on prend la vente et l’achat de la force de travail non pas isolément, mais comme un élément de la reproduction, comme un rapport sans cesse répété, alors apparaît en pleine lumière le véritable caractère de cette transaction.
Premièrement, alors que l’ouvrier par son travail crée, dans une période donnée, une nouvelle valeur renfermant la plus-value, le produit fabriqué par l’ouvrier dans la période précédente, est réalisé sur le marché et se convertit en argent. Il apparaît donc clairement que le capitaliste paye au prolétaire le salaire non pas sur ses propres fonds, mais sur la valeur créée par le travail des ouvriers dans la période précédente de production (par exemple, pendant le mois précédent). Selon l’expression de Marx, la classe des capitalistes agit suivant la vieille recette du conquérant : elle achète la marchandise des vaincus avec leur propre argent, avec l’argent dont elle les a dépouillés.
En second lieu, contrairement aux autres marchandises, la force de travail n’est payée par le capitaliste qu’après que l’ouvrier a fourni un travail déterminé. Il se trouve donc que ce n’est pas le capitaliste qui avance au prolétaire; c’est au contraire, le prolétaire qui avance au capitaliste. Aussi bien, les entrepreneurs s’efforcent-ils de payer les salaires aux dates les plus espacées possible (par exemple, une fois par mois), afin de prolonger les délais du crédit gratuit que les ouvriers leur ont consenti.
La classe des capitalistes verse constamment aux ouvriers de l’argent, sous forme de salaire, pour leur permettre d’acheter les moyens de subsistance, c’est-à-dire une certaine partie du produit créé par le travail des ouvriers et que les exploiteurs se sont approprié. Cet argent, les ouvriers le restituent aussi régulièrement aux capitalistes, en acquérant avec lui les moyens de subsistance produits par la classe ouvrière elle-même.
L’analyse des rapports capitalistes dans le cours de la reproduction fait apparaître la source véritable du salaire, mais aussi celle de tout capital.
Admettons que le capital avancé par l’entrepreneur — 100 000 livres sterling — rapporte une plus-value de 10 000 livres sterling par an, et que cette somme soit entièrement dépensée par le capitaliste pour sa consommation individuelle.
Si l’entrepreneur ne s’appropriait pas le travail non payé de l’ouvrier, son capital se trouverait au bout de dix ans entièrement englouti. Il n’en est pas ainsi parce que la somme de 100 000 livres sterling dépensée par le capitaliste pour sa consommation personnelle, se renouvelle entièrement durant les délais indiqués grâce à la plus-value créée par le travail non payé des ouvriers.
Par conséquent, quelle que soit la source initiale du capital, celui-ci, dans le cours même de la reproduction simple, devient, au bout d’une période déterminée, de la valeur créée par le travail des ouvriers et accaparée gratuitement par le capitaliste. C’est là la preuve de l’absurdité des affirmations des économistes bourgeois, selon lesquels le capital serait une richesse gagnée par le propre travail de l’entrepreneur.
La reproduction simple fait partie intégrante, elle est un élément de la reproduction élargie. Les rapports d’exploitation, inhérents à la reproduction simple, sont encore plus accusés dans le cadre de la reproduction capitaliste élargie.
9.3. La reproduction capitaliste élargie. L’accumulation du capital.
Avec la reproduction élargie, une partie de la plus-value est consacrée par le capitaliste à l’accroissement de la production : achat de moyens de production supplémentaires et embauchage d’un supplément de main-d’œuvre. Par conséquent, une partie de la plus-value est ajoutée au capital précédent, elle est accumulée.
L’accumulation du capital est l’adjonction d’une partie de la plus-value au capital ou sa conversion en capital. La plus-value constitue donc la source de l’accumulation. C’est par l’exploitation de la classe ouvrière que le capital grandit et, qu’en même temps, les rapports de production capitalistes se reproduisent sur une base élargie.
L’élément moteur de l’accumulation pour l’entrepreneur capitaliste, c’est avant tout la course à l’augmentation de la plus-value. Avec le mode de production capitaliste, la soif d’enrichissement ne connaît point de bornes. Avec l’élargissement de la production augmente la masse de plus-value que s’approprie le capitaliste, et, par suite, aussi la partie de la plus-value destinée à satisfaire les besoins individuels et les caprices des capitalistes. D’un autre côté les capitalistes obtiennent la possibilité, grâce à l’accroissement de la plus-value, d’élargir de plus en plus la production, d’exploiter une quantité de plus en plus grande d’ouvriers et de s’approprier une masse sans cesse croissante de plus-value.
Un autre élément moteur de l’accumulation est la concurrence acharnée, qui place les grands capitalistes en meilleure position et leur permet d’écraser les petits. La concurrence oblige chaque capitaliste, sous peine de faillite, à améliorer son outillage, à élargir sa production. Arrêter le progrès technique, l’élargissement de la production, c’est rester en arrière, et les retardataires se font battre par leurs concurrents. La concurrence oblige donc chaque capitaliste à augmenter son capital, et il ne peut le faire que par l’accumulation constante d’une partie de la plus-value.
L’accumulation du capital est la source de la reproduction élargie.
9.4. La composition organique du capital.
La concentration et la centralisation du capital.Au cours de l’accumulation capitaliste, la masse générale du capital augmente et ses différentes parties subissent des changements inégaux, d’où résulte un changement de la structure du capital.
En accumulant la plus-value et en élargissant son entreprise, le capitaliste introduit généralement de nouvelles machines et des perfectionnements techniques, qui lui assureront une augmentation de ses bénéfices. Le progrès technique marque un accroissement plus rapide de la partie du capital qui existe sous forme de moyens de production : machines, bâtiments, matières premières, etc., c’est-à-dire du capital constant. Au contraire, la partie du capital dépensée à l’achat de force de travail, c’est-à-dire de capital variable, s’accroît avec beaucoup plus de lenteur.
Le rapport entre capital constant et capital variable, considéré comme rapport entre la masse des moyens de production et la force de travail vivante, est appelé composition organique du capital Prenons, par exemple, un capital de 100 000 livres sterling réparti en 80 000 livres de bâtiments, machines, matières premières, etc., et 20 000 livres de salaires. Alors la composition organique du capital est égale à 80 c : 20 v, ou 4 : 1.
Dans les différentes branches de l’industrie et dans les différentes entreprises d’une même industrie, la composition organique du capital est inégale : elle est plus élevée là où il y a par ouvrier une quantité plus grande de machines complexes et coûteuses, de matières premières transformées ; elle est inférieure là où prévaut le travail vivant, où par ouvrier il y a moins de machines et de matières premières qui coûtent relativement moins cher.
Avec l’accumulation du capital, la composition organique du capital augmente : la part du capital variable diminue, celle du capital constant augmente. Ainsi, dans l’industrie des États-Unis la composition organique du capital est passée de 4,4 : 1 en 1889, à 5,7 : 1 en 1904, à 6,1 : 1 en 1929 et à 6,5 : 1 en 1939.
Dans le cours de la reproduction capitaliste les capitaux augmentent de volume du fait de la concentration et de la centralisation du capital.
On appelle concentration du capital l’accroissement du capital par l’accumulation de la plus-value créée dans une entreprise donnée. Le capitaliste, en investissant dans l’entreprise une partie de la plus-value qu’il s’est appropriée, devient possesseur d’un capital sans cesse accru.
On appelle centralisation du capital l’accroissement du capital par la fusion de plusieurs capitaux en un seul capital plus important. Avec la concurrence, le gros capital ruine et absorbe les petites et les moyennes entreprises, moins importantes, qui ne résistent pas à la compétition. En accaparant à vil prix les entreprises d’un concurrent ruiné ou en les liant à la sienne d’une manière ou d’une autre (par exemple, par endettement), le gros fabricant augmente les capitaux qu’il détient. La fusion de nombreux capitaux en un seul se fait également par l’organisation de sociétés en commandite, de sociétés par actions, etc.
La concentration et la centralisation du capital rassemblent entre les mains d’un nombre restreint de personnes d’immenses richesses. L’accroissement des capitaux ouvre de larges possibilités à la concentration de la production dans de grandes entreprises.
La grande production a des avantages décisifs sur la petite. Les grandes entreprises peuvent introduire des machines et des perfectionnements techniques, pratiquer largement la division et la spécialisation du travail, ce qui n’est pas à la portée des petites entreprises. De ce fait, la fabrication des produits revient moins cher aux grandes entreprises qu’aux petites. La concurrence entraîne de gros frais et de grandes pertes. Une grande entreprise peut supporter ces pertes pour, ensuite, les compenser largement, tandis que les petites entreprises et souvent aussi les moyennes se ruinent. Les grands capitalistes reçoivent des crédits avec beaucoup plus de facilité et à des conditions plus favorables ; or, le crédit est une des armes les plus importantes dans la concurrence. Tous ces avantages permettent à des entreprises toujours plus importantes, puissamment équipées, de prendre le premier rang dans les pays capitalistes, tandis qu’une multitude de petites et moyennes entreprises se ruinent et disparaissent. Grâce à la concentration et à la centralisation du capital, une minorité de capitalistes, possesseurs de fortunes énormes, préside aux destinées de dizaines et de centaines de milliers d’ouvriers.
Dans l’agriculture, la concentration capitaliste aboutit à ce que la terre et d’autres moyens de production se concentrent de plus en plus dans les mains des gros propriétaires, tandis que les larges couches des petits et moyens paysans, privés de terre, de matériel et d’attelage sont asservis par le capital. Des masses de paysans et d’artisans se ruinent et deviennent des prolétaires.
Ainsi donc, la concentration et la centralisation du capital ont pour effet d’aggraver les contradictions de classes, d’approfondir l’abîme entre la minorité bourgeoise, exploiteuse, et la majorité non possédante, exploitée, de la société. En même temps, par suite de la concentration de la production, les grandes entreprises capitalistes et les centres industriels rassemblent des masses toujours plus grandes du prolétariat. Cela facilite le rassemblement et l’organisation des ouvriers pour la lutte contre le capital.
9.5. L’armée industrielle de réserve.
L’accroissement de la production en régime capitaliste, comme on l’a déjà dit, s’accompagne d’une augmentation de la composition organique du capital. La demande de main-d’œuvre est déterminée par la grandeur, non du capital tout entier, mais seulement de sa partie variable. Or, la partie variable du capital, avec le progrès technique, diminue relativement par rapport au capital constant. Aussi, avec l’accumulation du capital et le progrès de sa composition organique, la demande de main-d’œuvre se réduit-elle relativement, encore que les effectifs d’ensemble du prolétariat augmentent en même temps que le capitalisme se développe.
Il en résulte qu’une masse importante d’ouvriers ne peut trouver à s’employer. Une partie de la population ouvrière se trouve être « en surnombre » ; il se produit ce qu’on appelle une surpopulation relative. Cette surpopulation est relative, parce qu’une partie de la force de travail ne s’avère en surnombre que par rapport aux besoins d’accumulation du capital. Ainsi, dans la société bourgeoise, au fur et à mesure qu’augmente la richesse sociale, une partie de la classe ouvrière est vouée à un travail toujours plus dur et excessif, tandis que l’autre partie est condamnée à un chômage forcé.
Il faut distinguer les formes essentielles suivantes de surpopulation relative.
La surpopulation flottante est constituée par les ouvriers qui perdent leur travail pour un certain temps par suite de la réduction de la production, de l’emploi de nouvelles machines, de la fermeture d’entreprises. Avec l’élargissement de la production, une partie de ces chômeurs trouve à s’employer, de même qu’une partie des nouveaux ouvriers de la jeune génération. Le nombre total des ouvriers employés augmente, mais dans une proportion sans cesse décroissante par rapport à l’échelle de la production.
La surpopulation latente est constituée par les petits producteurs ruinés, et avant tout par les paysans pauvres et les ouvriers agricoles qui ne sont occupés dans l’agriculture que pendant une faible partie de l’année, ne trouvent pas à s’employer dans l’industrie et traînent une misérable existence, en vivotant tant bien que mal à la campagne. Contrairement à ce qui se passe dans l’industrie, le progrès technique dans l’agriculture entraîne une diminution absolue de la demande de main-d’œuvre.
La surpopulation stagnante est constituée par les groupes nombreux de gens qui ont perdu leur emploi permanent, et dont les occupations irrégulières sont payées bien au-dessous du niveau habituel du salaire. Ce sont de larges couches de travailleurs occupés dans la sphère du travail capitaliste à domicile, et aussi ceux qui vivent d’un travail occasionnel à la journée.
Enfin, la couche inférieure de la surpopulation relative est constituée par les gens qui ont été depuis longtemps éliminés de la production, sans aucun espoir de retour, et qui vivent d’un gagne-pain de hasard. Une partie de ces gens est réduite à la mendicité.
Les ouvriers éliminés de la production forment l’armée industrielle de réserve, l’armée des chômeurs. Cette armée est un attribut nécessaire de l’économie capitaliste, sans lequel elle ne peut ni exister, ni se développer. Dans les périodes d’essor industriel, quand l’élargissement rapide de la production s’impose, une quantité suffisante de chômeurs se trouve à la disposition des entrepreneurs. L’élargissement de la production a pour effet de réduire momentanément le chômage. Mais ensuite une crise de surproduction arrive et, de nouveau, des masses importantes d’ouvriers sont jetées à la rue et vont grossir l’armée de réserve des chômeurs.
L’existence de cette armée permet aux capitalistes de renforcer l’exploitation des ouvriers. Les chômeurs sont contraints d’accepter les plus dures conditions de travail. Le chômage crée une situation instable pour les ouvriers employés dans la production, et réduit considérablement le niveau de vie de la classe ouvrière tout entière. Voilà pourquoi les capitalistes n’ont pas intérêt à voir supprimer l’année industrielle de réserve, qui pèse sur le marché du travail et assure au capitaliste une main-d’œuvre à bon marché.
Avec le développement du mode de production capitaliste l’armée des chômeurs, diminuant dans les périodes d’essor de la production et augmentant pendant les crises, dans l’ensemble s’accroît.
En Angleterre, 1,7 % des membres des trade-unions étaient chômeurs en 1853 ; en 1880, 5,5 % ; en 1908, 7,8 % ; en 1921, 16,6 %. Aux États-Unis, d’après les données officielles, le nombre des chômeurs par rapport à la totalité de la classe ouvrière, était : de 5,1 % en 1890, de 10 % en 1900, de 15,5 % en 1915, de 23,1 % en 1921. En Allemagne, le nombre des chômeurs parmi les syndiqués était : de 0,2 % en 1887, de 2 % en 1900, de 18 % en 1926. La surpopulation relative dans les pays coloniaux et semi-coloniaux d’Orient atteint des proportions énormes.
Avec le développement du capitalisme, le chômage partiel prend des proportions toujours plus étendues : l’ouvrier ne travaille alors qu’une partie de la journée ou de la semaine.
Le chômage est un véritable fléau pour la classe ouvrière. Les ouvriers n’ont pas de quoi vivre, si ce n’est de la vente de leur force de travail. Renvoyés de l’entreprise, ils sont menacés de mourir de faim. Souvent, les chômeurs restent sans toit, car ils n’ont pas de quoi payer un gîte. Ainsi, la bourgeoisie s’avère incapable d’assurer aux esclaves salariés du capital, ne fût-ce qu’une existence d’esclave.
Les économistes bourgeois tentent de justifier le chômage en régime capitaliste en invoquant des lois éternelles de la nature. C’est à ce but que servent les inventions pseudo-scientifiques de Malthus, économiste réactionnaire anglais de la fin du 18e – début du 19e siècles. D’après la « loi de population », inventée par Malthus, depuis l’origine de la société humaine la population se multiplierait suivant les termes d’une progression géométrique (comme 1, 2, 4, 8, etc.), et les moyens d’existence, étant donné le caractère limité des richesses naturelles, augmenteraient suivant les termes d’une progression arithmétique (comme 1, 2, 3, 4, etc.) C’est là, d’après Malthus, la cause première du surplus de population, de la famine et de la misère des masses populaires. Le prolétariat, d’après Malthus, peut se libérer de la misère et de la famine, non pas par l’abolition du régime capitaliste, mais en s’abstenant du mariage et en réduisant artificiellement les naissances. Malthus considérait comme autant de bienfaits les guerres et les épidémies qui diminuent la population laborieuse. La théorie de Malthus est foncièrement réactionnaire. Elle permet à la bourgeoisie de justifier les tares incurables du capitalisme. Les inventions de Malthus n’ont rien de commun avec la réalité. Les moyens techniques puissants dont l’humanité dispose sont à même d’augmenter la quantité des moyens d’existence à des rythmes que l’accroissement même le plus rapide de la population est incapable d’égaler. Le seul obstacle est le régime capitaliste, qui est la cause véritable de la misère des masses.
Marx a découvert la loi capitaliste de la population, selon laquelle dans la société bourgeoise, l’accumulation du capital fait qu’une partie de la population ouvrière devient inévitablement superflue, est éliminée de la production et vouée aux affres de la misère et de la faim. La loi capitaliste de la population a été engendrée par les rapports de production de la société bourgeoise.
9.6. La surpopulation agraire.
Comme il a été indiqué plus haut une des formes de surpopulation relative est la surpopulation latente ou surpopulation agraire. La surpopulation agraire est, dans l’agriculture des pays capitalistes, l’excédent de la population qui résulte de la ruine des grandes masses de la paysannerie ; cette population ne peut être que partiellement occupée dans la production agricole et ne trouve pas à s’employer dans l’industrie.
Le développement accentue la différenciation de la paysannerie. Il se forme une armée nombreuse d’ouvriers agricoles et de paysans pauvres. Les grandes exploitations capitalistes créent une demande d’ouvriers salariés. Mais à mesure crue la production capitaliste s’étend d’une branche de l’agriculture à l’autre et que l’emploi des machines se répand et se développe, la masse de la paysannerie se ruine de plus en plus, et la demande en salariés agricoles diminue. Les couches ruinées de la population rurale se transforment constamment en prolétariat industriel ou viennent grossir l’armée des sans-travail dans les villes. Mais une grande partie de la population rurale ne trouvant pas de travail dans l’industrie, reste à la campagne où elle ne trouve que partiellement à s’employer dans l’agriculture.
Le caractère latent de la surpopulation agraire consiste en ce que la force de travail excédentaire dans les campagnes est toujours plus ou moins liée à la petite et à la très petite exploitation paysanne. Le salarié agricole exploite généralement un petit lopin de terre qui lui permet de compléter son gagne-pain ou de végéter misérablement à la morte-saison. Ces exploitations sont nécessaires au capitalisme pour disposer de main-d’œuvre à bon marché.
La surpopulation agraire en régime capitaliste prend des proportions énormes. En Russie tsariste, à la fin du 19e siècle, le chômage latent à la campagne frappait 13 millions d’individus. En Allemagne, en 1907, sur 5 millions d’exploitations paysannes, 3 millions de petites exploitations formaient l’armée de réserve du travail. Aux États-Unis, après 1930 on comptait selon les données officielles manifestement inférieures à la réalité, 2 millions de fermiers « en trop ». Chaque année, pendant la saison d’été, un à 2 millions d’ouvriers agricoles américains, avec leurs familles et leurs maigres biens, errent à travers le pays en quête d’un gagne-pain.
La surpopulation agraire est particulièrement grande dans les pays économiquement arriérés. Ainsi, dans l’Inde où l’agriculture emploie les trois quarts environ de la population du pays, la surpopulation agraire forme une armée forte de millions d’hommes. Une grande partie de la population agricole est réduite à l’état de famine chronique.
9.7. La loi générale de l’accumulation capitaliste.
La paupérisation relative et absolue du prolétariat.Le développement du capitalisme a pour résultat qu’avec l’accumulation du capital, à un pôle de la société bourgeoise d’immenses richesses se concentrent, le luxe et le parasitisme, le gaspillage et l’oisiveté des classes exploiteuses augmentent ; tandis qu’à l’autre pôle de la société s’intensifie de plus en plus le joug, l’exploitation, s’accroissent le chômage et la misère de ceux dont le travail crée toutes les richesses.
L’armée industrielle de réserve est d’autant plus nombreuse que la richesse sociale, le capital en fonction, l’étendue et l’énergie de son accroissement, donc aussi la masse absolue du prolétariat et la force productive de son travail, sont plus considérables… La grandeur relative de l’armée industrielle de réserve s’accroît donc en même temps que les ressorts de la richesse. Mais plus cette armée de réserve grossit, comparativement à l’armée active du travail, plus grossit la surpopulation consolidée, excédent de population, dont la misère est inversement proportionnelle aux tourments de son travail… Voilà la loi absolue, générale, de l’accumulation capitaliste.
( K. Marx, Le Capital, livre 1, t. 3, p. 87 (trad. sur l’édit. allemande). )La loi générale de l’accumulation capitaliste est l’expression concrète du fonctionnement de la loi économique fondamentale du capitalisme, la loi de la plus-value. La course à la plus-value aboutit à l’accumulation des richesses entre les mains des classes exploiteuses et à l’augmentation de l’appauvrissement et de l’oppression des classes non possédantes.
Le développement du capitalisme s’accompagne de la paupérisation relative et absolue du prolétariat.
La paupérisation relative du prolétariat consiste en ce que dans la société bourgeoise la part de la classe ouvrière dans le montant global du revenu national décroît sans cesse, alors que la part des classes exploiteuses est en progression constante.
Malgré l’accroissement absolu de la richesse sociale, la part des revenus de la classe ouvrière diminue rapidement. Les salaires des ouvriers de l’industrie américaine par rapport aux profits des capitalistes, étaient de 70 % en 1889, de 61 % en 1919, de 47 % en 1929 et de 45 % en 1939.
Dans la Russie tsariste, de 1900 à 1913, l’ensemble des salaires nominaux, étant donné le nombre accru des ouvriers d’usine, avait augmenté d’environ 80 %, malgré une diminution du salaire réel, tandis que les bénéfices des industriels avaient plus que triplé.
D’après les données d’économistes bourgeois, américains, vers 1920, aux États-Unis 1 % des propriétaires possédait 59 % de toutes les richesses, tandis que les couches pauvres formant 87 % de la population ne possédaient que 8 % de la richesse nationale.
En 1920-1921, les plus gros propriétaires anglais, qui représentaient moins de 2 % de la totalité des propriétaires, détenaient 64 % de toute la richesse nationale, tandis que 76 % de la population n’en possédaient que 7,6 %.
La paupérisation absolue du prolétariat consiste dans l’abaissement pur et simple de son niveau de vie.
L’ouvrier connaît une paupérisation absolue, c’est-à-dire qu’il devient tout simplement plus pauvre qu’avant, qu’il est obligé de vivre moins bien, d’avoir une nourriture plus chiche, de moins souvent manger à sa faim, de vivre dans les caves et dans les greniers.
[…]
Dans la société capitaliste la richesse grandit à une vitesse invraisemblable, en même temps que les masses ouvrières sont frappées par la paupérisation.
( V. Lénine, « La paupérisation dans la société capitaliste », Œuvres, t. 18, p. 451. )Pour enjoliver la réalité capitaliste, l’économie politique bourgeoise s’efforce de nier la paupérisation absolue du prolétariat. Les faits cependant attestent qu’en régime capitaliste le niveau de vie de la classe ouvrière est en baisse constante. Gela se manifeste sous bien des formes.
La paupérisation absolue du prolétariat se traduit par la baisse du salaire réel. Comme on l’a déjà dit, la hausse des prix des objets de consommation courante, l’augmentation des loyers et des impôts entraînent la diminution constante du salaire réel des ouvriers.
La paupérisation absolue du prolétariat se manifeste par l’ampleur et la durée accrues du chômage.
Elle se manifeste dans l’intensification et dans l’aggravation des conditions de travail, qui aboutissent au vieillissement rapide de l’ouvrier, à la perte de sa capacité de travail, à sa transformation en invalide. L’intensification du travail et l’absence de mesures nécessaires à la protection du travail multiplient les accidents et les cas de mutilation.
La paupérisation absolue du prolétariat se manifeste dans de plus mauvaises conditions d’alimentation et de logement des travailleurs, ce qui a pour effet de ruiner la santé et d’abréger la vie des travailleurs.
Dans l’industrie houillère des États-Unis, de 1878 à 1914, sur mille ouvriers occupés, le nombre d’accidents mortels a augmenté de 71,5 %. Dans la seule année 1952, dans les entreprises des États-Unis, environ 15 000 personnes ont été tuées et plus de deux millions ont été mutilées. Le nombre d’accidents augmente également dans les charbonnages d’Angleterre : avant-guerre, chaque année un mineur sur six a été victime d’un accident ; de 1949 à 1953 la proportion est passée à un sur trois.
Les données officielles des recensements relatifs à l’habitat établissent que près de 40 % des locaux d’habitation aux États-Unis ne répondent pas aux exigences minima d’hygiène et de sécurité. Le taux de mortalité de la population ouvrière est de beaucoup supérieur à celui des classes dominantes. La mortalité infantile dans les taudis de la ville de Détroit est six fois plus élevée que la moyenne des États-Unis.
Le niveau de vie du prolétariat est particulièrement bas dans les pays coloniaux, où la misère extrême et la mortalité exceptionnellement élevée des ouvriers, par suite d’un travail exténuant et d’une famine chronique, revêtent un caractère de masse.
Le niveau de vie de la paysannerie pauvre, en régime capitaliste, n’est pas supérieur, mais souvent même inférieur à celui des ouvriers salariés. Dans la société capitaliste, on assiste non Seulement à la paupérisation absolue et relative du prolétariat, mais aussi à la ruine et à la paupérisation de la paysannerie. On comptait en Russie tsariste des dizaines de millions de paysans pauvres qui souffraient de la faim. Les recensements américains établissent qu’au cours des dernières décennies, près des deux tiers des fermiers des États-Unis, en règle générale, n’ont pas le minimum vital. Aussi bien, leurs intérêts vitaux poussent les paysans à s’unir à la classe ouvrière.
La voie du développement du capitalisme est celle de l’appauvrissement et de la sous-alimentation pour l’immense majorité des travailleurs. En régime bourgeois, l’essor des forces productives n’apporte pas aux masses laborieuses un allégement de leur situation, mais une aggravation de leur misère et de leurs privations.
En même temps se développe la lutte de la classe ouvrière contre la bourgeoisie, pour la libération du joug du capital, et grandissent sa conscience et son organisation. Dans cette lutte sont entraînées de plus en plus les masses de la paysannerie.
9.8. La contradiction fondamentale du mode de production capitaliste.
À mesure qu’il se développe, le capitalisme associe de plus en plus étroitement le travail d’une multitude d’hommes. La division sociale du travail s’étend. Des branches d’industrie autrefois plus ou moins indépendantes se transforment en une série de productions réciproquement liées et dépendantes les unes des autres. Les relations économiques se resserrent entre entreprises, régions, pays entiers.
Le capitalisme crée la grande production aussi bien dans l’industrie que dans l’agriculture. Le progrès des forces productives engendre des instruments et des méthodes de production qui exigent le travail en commun de centaines et de milliers d’ouvriers. La concentration de la production s’accroît. Il se produit ainsi une socialisation capitaliste du travail, une socialisation de la production.
Mais la socialisation de la production progresse dans l’intérêt d’un petit nombre d’entrepreneurs privés, soucieux d’augmenter leurs profits. Le produit du travail social de millions d’hommes devient la propriété privée des capitalistes.
Par conséquent, une contradiction profonde est inhérente au régime capitaliste : la production revêt un caractère social, alors que la propriété des moyens de production demeure propriété capitaliste privée, incompatible avec le caractère social du processus de production. La contradiction entre le caractère social du processus de production et la forme capitaliste privée d’appropriation des résultats de la production est la contradiction fondamentale du mode de production capitaliste ; cette contradiction va s’aggravant à mesure que le capitalisme se développe. Elle se manifeste par une anarchie accrue de la production capitaliste, par l’accentuation des antagonismes de classe entre le prolétariat et toutes les masses laborieuses d’une part et la bourgeoisie de l’autre.
Résumé du chapitre 9
-
La reproduction est le renouvellement constant, la répétition ininterrompue du processus de production. La reproduction simple est le renouvellement de la production sous un volume constant. La reproduction élargie signifie que la production se renouvelle sous un volume accru. Le capitalisme est caractérisé par la reproduction élargie, coupée périodiquement de crises économiques, pendant lesquelles la production est en baisse. La reproduction capitaliste élargie renouvelle sans cesse et approfondit les rapports d’exploitation.
-
La reproduction élargie en régime capitaliste suppose l’accumulation du capital. L’accumulation est l’addition au capital d’une partie de la plus-value, ou la transformation de la plus-value en capital. L’accumulation capitaliste aboutit à une élévation de la composition organique du capital, c’est-à-dire que le capital constant s’accroît plus rapidement que le capital variable. La reproduction capitaliste s’accompagne de la concentration et de la centralisation du capital. La grande production possède des avantages décisifs sur la petite, ce qui permet aux grandes ou très grandes entreprises d’éliminer et de se subordonner les petites et moyennes entreprises capitalistes.
-
Avec l’accumulation du capital et l’élévation de sa composition organique, la demande de main-d’œuvre subit une diminution relative. Il se forme une armée industrielle de réserve de chômeurs. L’excédent de main-d’œuvre dans l’agriculture capitaliste, dû à la ruine des masses essentielles de la paysannerie, crée la surpopulation agraire. La loi générale de l’accumulation capitaliste signifie la concentration des richesses entre les mains d’une minorité exploiteuse et l’accroissement de la misère des travailleurs, c’est-à-dire de l’immense majorité de la société. La reproduction élargie en régime capitaliste aboutit nécessairement à la paupérisation relative et absolue de la classe ouvrière. La paupérisation relative est la diminution de la part de la classe ouvrière dans le revenu national des pays capitalistes. La paupérisation absolue est l’abaissement pur et simple du niveau de vie de la classe ouvrière.
-
La contradiction fondamentale du capitalisme est la contradiction entre le caractère social du processus de production et la forme capitaliste privée de l’appropriation. Avec le développement du capitalisme cette contradiction s’aggrave sans cesse et les antagonismes de classe deviennent plus profonds entre la bourgeoisie et le prolétariat.
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par Pcautunois le 12 Avril 2011 à 14:13
A. — Le capitalisme prémonopoliste
Chapitre 10 — Le cycle et la rotation du capital
10.1. Le cycle du capital. Les trois formes du capital industriel.
La condition d’existence du mode de production capitaliste est la circulation développée des marchandises, c’est-à-dire leur échange au moyen de l’argent. La production capitaliste est étroitement liée à la circulation.
Tout capital commence sa carrière sous la forme d’une somme déterminée d’argent ; c’est un capital-argent. Avec l’argent, le capitaliste achète des marchandises d’une espèce particulière : 1o des moyens de production et 2o de la force de travail. Cet acte de circulation peut être représenté par la formule :

A — désigne l’argent ; M la marchandise ; T la force de travail et Mp les moyens de production. Ce changement de la forme du capital permet à son possesseur de disposer de tout ce qui est nécessaire à la production. Auparavant, il possédait du capital sous forme monétaire ; maintenant, il possède un capital de même grandeur, mais désormais sous forme de capital productif.
Par conséquent, le premier stade du mouvement du capital consiste dans la conversion du capital-argent en capital productif.
Vient ensuite le processus de production dans lequel s’opère la consommation productive des marchandises achetées par le capitaliste : les ouvriers dépensent leur travail, la matière première est transformée, le combustible est brûlé, les machines s’usent. De nouveau le capital change de forme : à l’issue du processus de production le capital avancé se trouve incorporé dans une masse déterminée de marchandises ; il prend la forme de capital-marchandise. Mais d’abord, ce ne sont plus les marchandises que le capitaliste a achetées en montant son affaire ; en second lieu, la valeur de cette masse de marchandises est supérieure à la valeur initiale du capital, car elle renferme la plus-value créée par les ouvriers.
Ce stade du mouvement du capital peut être représenté comme suit :
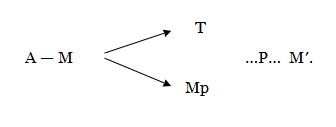
Dans cette formule la lettre P représente la production ; les points placés avant et après cette lettre indiquent que le processus de circulation a été interrompu et que s’opère le processus de production ; la lettre M′ désigne le capital sous sa forme marchandise, capital dont la valeur a augmenté du fait du surtravail des ouvriers.
Par conséquent, le deuxième stade du mouvement du capital consiste dans la conversion du capital productif en capital-marchandise.
Le mouvement du capital ne s’arrête pas là. Les marchandises produites doivent être réalisées. En échange des marchandises vendues, le capitaliste reçoit une somme déterminée d’argent.
Cet acte de circulation peut être représenté comme suit :
M′ — A′.
Le capital change de forme pour la troisième fois : il reprend la forme de capital-argent. Après quoi, son possesseur se trouve avoir une somme d’argent plus importante qu’au début. Le but de la production capitaliste, qui consiste à tirer de la plus-value, a été atteint.
Par conséquent, le troisième stade du mouvement du capital consiste dans la conversion du capital-marchandise en capital-argent.
Le capitaliste emploie de nouveau l’argent, qu’il a tiré de la vente des marchandises, à l’achat des moyens de production et de la force de travail nécessaires pour continuer la production, et tout le processus recommence.
Tels sont les trois stades par lesquels le mouvement du capital passe successivement. À chacun de ces stades, le capital remplit une fonction déterminée. La conversion du capital-argent en éléments du capital productif assure l’union des moyens de production appartenant aux capitalistes avec la force de travail des ouvriers salariés ; à défaut de cette union, le processus de production ne peut avoir lieu. La fonction du capital productif est de créer par le travail des ouvriers salariés une masse de marchandises, une valeur nouvelle et, par suite, de la plus-value. La fonction du capital-marchandise consiste, par la vente de la masse des marchandises produites : en premier lieu, à restituer au capitaliste, sous forme argent, le capital qu’il a avancé pour la production ; en second lieu, à réaliser sous forme argent la plus-value créée dans le processus de production.
C’est par ces trois stades que passe le capital industriel dans son mouvement. Par capital industriel on entend, en l’occurrence, tout capital engagé dans la production des marchandises, qu’il s’agisse de l’industrie ou de l’agriculture.
Le capital industriel est le seul mode d’existence du capital, où sa fonction ne consiste pas seulement en appropriation mais également en création de plus-value, autrement dit de surproduit. C’est pourquoi il conditionne le caractère capitaliste de la production ; son existence implique celle de la contradiction de classe entre capitalistes et ouvriers salariés.
( K. Marx, Le Capital, livre 2, t. 1, p. 53. )Ainsi, tout capital industriel accomplit un cycle.
On appelle cycle du capital, la transformation successive du capital d’une forme dans une autre, son mouvement à travers les trois stades. De ces trois stades, le premier et le troisième ont lieu dans la sphère de la circulation, le deuxième dans la sphère de la production. Sans circulation, c’est-à-dire sans transformation des marchandises en argent et reconversion de l’argent en marchandise, la reproduction capitaliste, c’est-à-dire le renouvellement constant du processus de production, devient impossible.
Le cycle du capital dans son ensemble peut être représenté comme suit :

Les trois stades du cycle du capital sont liés entre eux de la façon la plus étroite et dépendent l’un de l’autre. Le cycle du capital ne s’opère normalement que si ses différents stades se succèdent sans arrêt.
Si le capital est arrêté au premier stade, c’est que l’existence du capital-argent est inutile. S’il est arrêté au deuxième stade, c’est que les moyens de production restent inutilisés et que la force de travail est sans emploi. Si le capital subit un arrêt au troisième stade, les marchandises invendues s’amassent dans les entrepôts et obstruent les canaux de la circulation.
Le deuxième stade où le capital se trouve sous la forme de capital productif, a une importance décisive dans le cycle du capital industriel ; c’est à ce stade que s’opère la production des marchandises, de la valeur et de la plus-value. Aux deux autres stades, il n’y a pas création de valeur ni de plus-value ; il n’y a que succession des formes du capital.
Aux trois stades du cycle du capital correspondent trois formes du capital industriel : 1o le capital-argent, 2o le capital productif et 3o le capital-marchandise.
Chaque capital existe simultanément sous les trois formes : alors qu’une de ses parties représente un capital-argent qui se convertit en capital productif, l’autre partie représente un capital productif qui se convertit en capital-marchandise, et la troisième partie représente un capital-marchandise qui se convertit en capital-argent. Chacune de ces parties revêt et abandonne successivement chacune de ces trois formes. Il en est ainsi non seulement de chaque capital considéré à part, mais de tous les capitaux pris ensemble, ou, autrement dit, de l’ensemble du capital social. Aussi, comme l’indique Marx, ne peut-on concevoir le capital qu’en tant que mouvement et non en tant que chose au repos.
Il y a déjà là la possibilité d’une existence individualisée des trois formes du capital. Nous montrerons plus loin comment du capital engagé dans la production se détachent le capital commercial et le capital de prêt. C’est sur cette séparation que repose l’existence des différents groupes de la bourgeoisie — industriels, marchands, banquiers, — entre lesquels s’opère la répartition de la plus-value.
10.2. La rotation du capital.
Le temps de production et le temps de circulation.Tout capital accomplit son cycle sans arrêt, en le répétant constamment. Le capital accomplit ainsi sa rotation.
On appelle rotation du capital, son cycle non pas en tant qu’acte unique, mais en tant que processus qui se renouvelle et se répète périodiquement. Le temps de rotation du capital représente la somme du temps de production et du temps de circulation. En d’autres termes, le temps de rotation est l’intervalle de temps qui s’écoule entre le moment où le capital est avancé sous une forme déterminée et le moment où il retourne au capitaliste sous la même forme, mais augmenté de la grandeur de la plus-value.
Le temps de production est celui pendant lequel le capital se trouve dans la sphère de la production. La partie la plus importante du temps de production est la période de travail, pendant laquelle l’objet en cours de fabrication est soumis à l’action directe du travail. La période de travail dépend du caractère de chaque branche de la production, du niveau de la technique dans telle ou telle entreprise, ainsi que d’autres conditions. Ainsi, il ne faut que quelques jours dans une filature pour transformer une quantité déterminée de coton en filés prêts à être mis en vente ; dans une usine de construction de locomotives, la sortie de chaque locomotive nécessite des dépenses de travail d’un, grand nombre d’ouvriers pendant une longue période.
Le temps de production est généralement plus long que la période de travail. Il comprend aussi les temps d’arrêt dans l’opération, pendant lesquels l’objet du travail est soumis à l’action de processus naturels déterminés, comme, par exemple, la fermentation du vin, le tannage du cuir, la croissance du froment, etc.
Le temps de circulation est celui pendant lequel le capital passe de la forme argent à la forme productive et de la forme marchandise à la forme argent. La durée de la circulation dépend des conditions d’achat des moyens de production et des conditions de vente des produits finis, de la proximité du marché, du degré de développement des moyens de transport et de communication.
10.3. Le capital fixe et le capital circulant.
Les différentes parties du capital productif ne circulent pas de façon identique. Les différences de rotation des diverses parties du capital productif tiennent aux différentes façons dont chacune de ces parties transmet sa valeur au produit. De ce point de vue, le capital se divise en capital fixe et en capital circulant.
Le capital fixe est la partie du capital productif, qui, fonctionnant entièrement dans le processus de production, transfère sa valeur au produit non pas d’un coup, mais par portions, pendant une série de périodes de production. C’est la partie du capital dépensée pour la construction des bâtiments et des installations, pour l’achat des machines et de l’outillage.
Les éléments du capital fixe servent généralement à la production pendant de nombreuses années ; ils subissent chaque année une certaine usure et finissent par être inutilisables. C’est là l’usure matérielle des machines, de l’équipement.
Parallèlement à l’usure matérielle, les instruments de production sont également sujets à une usure morale. La machine qui a servi cinq à dix ans peut être encore suffisamment solide, mais si, à ce moment-là, il a été créé une autre machine du même genre, plus perfectionnée, plus productive et meilleur marché, il s’ensuit une dépréciation de l’ancienne machine. Aussi le capitaliste a-t-il intérêt à utiliser entièrement son outillage dans les délais les plus brefs. D’où la tendance des capitalistes à allonger la journée, à intensifier le travail, à introduire dans les entreprises plusieurs postes de travail sans interruption.
Le capital circulant est la partie du capital productif, dont la valeur durant une seule période de production est entièrement restituée au capitaliste sous forme d’argent lors de la réalisation de la marchandise. C’est la partie du capital dépensée pour l’achat de la force de travail, ainsi que pour l’achat de moyens de production : matières premières, combustible et autres matériaux auxiliaires, qui ne rentrent pas dans la composition du capital fixe. La valeur des matières premières, du combustible et des matériaux consommés est entièrement transférée à la marchandise durant une seule période de production, tandis que les dépenses consacrées à l’achat de la force de travail sont récupérées par le capitaliste avec excédent (avec addition de plus-value).
Pendant que le capital fixe ne fait qu’une seule rotation, le capital circulant a le temps d’en accomplir plusieurs.
La vente de la marchandise procure au capitaliste une certaine somme d’argent qui comporte : 1o la valeur de la partie du capital fixe qui, dans le processus de production, a été transférée à la marchandise ; 2o la valeur du capital circulant ; 3o la plus-value. Pour continuer la production, le capitaliste réengage la somme retirée qui correspond au capital circulant, pour embaucher des ouvriers, acheter des matières premières, du combustible, des matériaux auxiliaires. Le capitaliste utilise la somme correspondant à la partie de la valeur du capital fixe, qui a été transférée à la marchandise, pour compenser l’usure des machines, des machines-outils, des bâtiments, c’est-à-dire aux fins d’amortissement.
L’amortissement est la compensation progressive, sous forme argent, de la valeur du capital fixe par des versements périodiques correspondant à son degré d’usure. Une partie des fonds d’amortissement est consacrée aux grosses réparations, c’est-à-dire à une compensation partielle de l’usure de l’outillage, des instruments, des bâtiments d’exploitation, etc. Mais la partie la plus importante des amortissements, les capitalistes la conservent sous forme argent (généralement, dans les banques) pour acheter, quand le besoin s’en fera sentir, de nouvelles machines en remplacement des anciennes, ou pour construire de nouveaux bâtiments au lieu de ceux qui ne sont plus utilisables.
L’économie politique marxiste distingue entre la division du capital en capital fixe et circulant et la division du capital en capital constant et variable. Le capital constant et le capital variable se différencient d’après le rôle qu’ils jouent dans le processus d’exploitation des ouvriers par les capitalistes, tandis que le capital fixe et le capital circulant se différencient par le caractère de la rotation.
Ces deux modes de division du capital peuvent être représentés comme suit :
L’économie politique bourgeoise ne reconnaît que la division du capital en capital fixe et circulant, car cette division par elle-même ne montre pas le rôle de la force de travail dans la création de la plus-value ; au contraire, elle voile la distinction essentielle entre les dépenses du capitaliste pour l’embauchage de la main-d’œuvre et les dépenses consacrées aux matières premières, au combustible, etc.
10.4. Le taux annuel de la plus-value.
Les méthodes d’accélération de la rotation du capital.Pour une grandeur donnée du capital variable, la vitesse de rotation du capital influe sur le volume de la plus-value que le capitaliste extorque en l’espace d’un an aux ouvriers.
Prenons deux capitaux, comprenant chacun 25 000 dollars de capital variable, le taux de la plus-value étant de 100 %. Supposons que l’un d’eux accomplit une rotation par an, et que l’autre en accomplit deux. Cela veut dire que le détenteur du second capital, avec la même somme d’argent, peut embaucher et exploiter en l’espace d’un an deux fois plus d’ouvriers que le possesseur du premier capital. Aussi, en fin d’année, les résultats seront-ils différents chez les deux capitalistes. Le premier aura 25 000 dollars de plus-value pour l’année ; le second, 50 000 dollars. La vitesse de rotation du capital influe aussi sur la grandeur de la partie du capital circulant qui est avancée pour l’achat des matières premières, du combustible, des matériaux auxiliaires.
Le taux annuel de la plus-value est le rapport de la plus-value produite en l’espace d’un an au capital variable avancé. Dans notre exemple, le taux annuel de la plus-value, exprimé en pourcentage, est pour le premier capitaliste de 25 000 25 000 = 100 %, pour le deuxième de 50 000 25 000 = 200 %.
Il est donc évident que les capitalistes ont intérêt à accélérer la rotation du capital, puisque cette accélération leur permet de tirer la même somme de plus-value avec un moindre capital ou de toucher avec le même capital une plus grande somme de plus-value.
Marx a montré que, par elle-même, l’accélération de la rotation du capital ne crée pas un atome de valeur nouvelle. Une rotation plus rapide du capital et une réalisation plus rapide sous forme argent de la plus-value créée au cours de l’année ne permettent aux capitalistes, pour un même capital, que d’embaucher un plus grand nombre d’ouvriers dont le travail crée en l’espace d’un an une masse plus importante de plus-value.
Comme nous l’avons vu, le temps de rotation du capital comprend le temps de production et le temps de circulation. Le capitaliste s’efforce de réduire l’un et l’autre.
La période de travail nécessaire à la production des marchandises diminue avec le développement des forces productives et le progrès technique. Par exemple, les méthodes modernes de production de la fonte et de l’acier accélèrent considérablement les processus par rapport aux méthodes que l’on pratiquait il y a 100 ou 150 ans. Les progrès dans l’organisation de la production, par exemple le passage à la production en série ou en masse, fournissent de même des résultats importants.
Dans un grand nombre de cas, les temps d’arrêt dans le travail, qui représentent une partie du temps de production et s’ajoutent à la période de travail, sont, grâce au progrès technique, également réduits. Ainsi, le tannage du cuir durait autrefois des semaines ; aujourd’hui, grâce à l’emploi de nouvelles méthodes chimiques, il ne demande que quelques heures. Dans maintes productions les catalyseurs, c’est-à-dire des substances qui accélèrent les réactions chimiques, sont d’un emploi fréquent.
Afin d’accélérer la rotation du capital, l’entrepreneur recourt aussi à la prolongation de la journée et à l’intensification du travail. Si, avec une journée de travail de 10 heures, la période de travail est de 24 jours, la prolongation de la journée de travail à 12 heures réduit la période de travail à 20 jours et accélère d’autant la rotation du capital. Même résultat avec l’intensification du travail, l’ouvrier dépensant en 60 minutes autant d’énergie qu’il en dépensait précédemment, par exemple, en 72 minutes.
Ensuite, les capitalistes cherchent à accélérer la rotation du capital en réduisant le temps de circulation du capital. Cette réduction est rendue possible grâce au développement des moyens de transport, des P.T.T., grâce à une meilleure organisation du commerce. Cependant à la réduction du temps de circulation s’opposent, en premier lieu, la répartition extrêmement irrationnelle de la production dans le monde capitaliste, qui nécessite le transport des marchandises à de grandes distances, et en second lieu, l’aggravation de la concurrence capitaliste et la multiplication des difficultés d’écoulement.
Avec le capital circulant, la plus-value créée au cours d’une période donnée passe dans la circulation. Plus le temps de rotation du capital est court, et plus vite se réalise sous forme argent la plus-value créée par les ouvriers, plus vite aussi elle peut être employée à l’élargissement de la production.
Résumé du chapitre 10
-
Tout capital industriel individuel accomplit un cycle ininterrompu, qui comporte trois stades. À ces trois stades correspondent trois formes du capital industriel — capital-argent, capital productif et capital-marchandise — qui diffèrent par leurs fonctions.
-
Le cycle du capital, pris non comme un acte isolé, mais comme un processus qui se renouvelle périodiquement, est appelé rotation du capital. Le temps de rotation du capital représente la somme du temps de production et du temps de circulation. La période de travail est la partie la plus importante du temps de production.
-
Tout capital productif se décompose en deux parties qui diffèrent par le caractère de leur rotation : le capital fixe et le capital circulant. Le capital fixe est la partie du capital productif dont la valeur est transférée à la marchandise non pas d’un seul coup, mais par fractions pendant une série de périodes de production. Le capital circulant est la partie du capital productif dont la valeur durant une seule période de production retourne entièrement au capitaliste après la vente de cette marchandise.
-
L’accélération de la rotation du capital permet aux capitalistes, avec le même capital, d’accomplir dans l’année un plus grand nombre de rotations et d’embaucher, par conséquent, un plus grand nombre d’ouvriers qui produiront une masse plus importante de plus-value. Les capitalistes s’efforcent d’accélérer la rotation du capital en améliorant leur outillage et, surtout, en renforçant l’exploitation des ouvriers, en allongeant la journée de travail et en intensifiant le travail.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
-
" Face au capital, aujourd'hui, plus que jamais, le peuple a besoin du PCF"
















