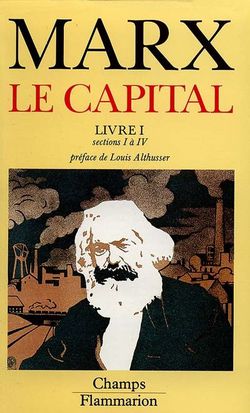Le 31 mars 2013
Suraccumulation et crise systémique du capitalisme
Michel Peyret
« Pour en rester à l’histoire récente du capitalisme, écrit Tom Thomas, on observera que les nombreuses crises qui se sont succédées au cours de ces trente dernières années ont pu être circonscrites et surmontées assez facilement. Elles n’ont pas, comme celle d’aujourd’hui, dégénéré en crise systémique généralisée parce que le capitalisme a pu mettre en œuvre plusieurs contre-tendances à la baisse du taux de profit. Ces contre-tendances ont des noms. Elles s’appellent défaites des prolétaires, mondialisation et extension du crédit. »
La suraccumulation généralisée du capital
CHAPITRE 1 du livre de Tom Thomas « La crise. Laquelle? Et après? »
Ce chapitre résume brièvement une des découvertes fondamentales de K. Marx, à savoir la cause profonde des crises systémiques récurrentes du capitalisme, cause profonde qui ne doit pas être confondue avec les causes immédiates qui jouent le rôle de déclencheur de la crise.
Il s’agit de la loi qui établit que le développement du capital, son procès d’accumulation, conduit toujours à une suraccumulation de capital. C’est-à-dire à un « excès » de capital sous toutes les formes qu’il revêt au cours du procès de valorisation: argent, moyens de production, force de travail, marchandises, et à nouveau argent. « Excès » s’entend bien sûr relativement à la possibilité pour le capital, considéré ici dans sa généralité comme capital unique, de réaliser une plus-value3 suffisante (sous forme de profit) par la vente des marchandises produites.
Suraccumulation de capital ou sous-consommation des masses sont deux façons de dire la même chose, par exemple, trop de moyens de production et de marchandises et pas assez de masse salariale pour les absorber, ou encore trop de capital produit (accumulé) et pas assez de plus-value (pl) produite4. Nous y reviendrons.
Autrement dit, ce sont deux manifestations du même phénomène, de la même contradiction qui provoque la crise, toutes deux abaissent le taux de profit, voire même, à partir d’un certain niveau de suraccumulation, la masse des profits.
Cette contradiction réside dans le fait que le capital tend à diminuer la quantité de travail vivant qu’il emploie en même temps qu’il tend à augmenter la puissance des machines et la quantité de marchandises produites. Or évidemment, seul le travail vivant peut produire la plus-value car il est à la fois seul fournisseur de surtravail et facteur indispensable de sa réalisation en plus-value lors de l’achat des marchandises par les salariés.
La compréhension de ce phénomène est indispensable à la compréhension de la crise généralisée du capital. Résumons-en l’argumentation.
Le capital n’existe que comme valeur se valorisant, s’accumulant ainsi sans cesse par la production de plus-value. De l’argent thésaurisé, des machines arrêtées, des marchandises invendues, bref, des valeurs immobiles ne sont pas du capital. Tout au plus sont-elles des valeurs en attente de le devenir. C’est bien pourquoi le capitaliste cherche à éliminer autant qu’il le peut cette immobilité. Il y parvient par le fonctionnement des machines en continu, par la limitation des stocks, par l’intensification et la flexibilité du travail, etc.
Le capital, n’existant que dans la valorisation et l’accumulation, développe « la production pour la production ». Mais pas seulement par un élargissement permanent de celle-ci, que cet élargissement soit géographique ou création de nouveaux produits et de nouveaux besoins, car cet accroissement de la production s’effectue nécessairement en tant que production capitaliste, c’est-à-dire production pour le profit.
Ceci amène chaque capitaliste, gérant (« fonctionnaire » dit Marx) d’un capital particulier, à devoir non seulement produire plus, conquérir de nouveaux marchés, mais à le faire en réduisant au maximum ses coûts de production afin d’augmenter ses profits. La concurrence l’y oblige qu’il le veuille ou non car s’il se montrait médiocre dans cet exercice, son capital disparaîtrait, ruiné ou englouti par d’autres plus performants.
Comme chacun le sait, réduire la part du salaire contenu dans les marchandises produites est pour chaque capitaliste particulier un moyen essentiel d’augmenter le profit. Pour le capital en général, dont la reproduction est en cause dans la crise systémique, cela revient évidemment à diminuer le capital variable (Cv) à engager (la quantité de « travail nécessaire ») afin d’augmenter la plus-value.
Il y a plusieurs façons de le faire. Toutes ont pour point commun la coercition du chômage et la violence étatique, légale ou illégale. Marx les a regroupées en deux grandes catégories.
D’une part, l’extraction de la plus-value « absolue » qui consiste à augmenter la quantité de travail vivant fournie, soit en allongeant le temps de travail, soit en augmentant son intensité sans augmenter le salaire en proportion.
D’autre part, l’extraction de la plus-value « relative » obtenue par des hausses de productivité grâce au perfectionnement des machines qui permet de diminuer le capital à engager (Cc + Cv). Cc augmentant moins que Cv ne diminue pour une production de valeur donnée. Mais si l’on s’en tient à l’extraordinaire ampleur du développement du capitalisme moderne depuis le 20ème siècle, c’est de loin l’augmentation de la plus-value relative qui a été le moyen essentiel mis en œuvre pour y parvenir.
Or une conséquence évidente de cette augmentation, toujours obtenue par un accroissement de la puissance et de l’efficacité des machines et une diminution corrélative de la quantité de travail humain contenu dans chaque marchandise, est que cette diminution finit par produire, à la longue, et malgré l’élargissement de la production et de la consommation5 qu’autorise cette productivité accrue, un effet contraire à celui attendu concernant la valorisation du capital.
Cet effet contraire se manifeste dans toutes les phases de la reproduction du capital, phases qui existent toutes simultanément du fait de l’enchevêtrement des cycles des multiples capitaux particuliers. Dans la phase de production proprement dite, cette diminution – qui porte d’abord sur Cv, c’est-à-dire sur la quantité du travail qui revient à l’ouvrier sous forme de salaire, direct et indirect – induit l’augmentation du rapport Cc/Cv ou « composition organique » du capital selon la formule de Marx. Laquelle est un facteur bien connu de diminution du taux de profit. D’une façon plus générale, la diminution relative de la quantité de travail vivant qui s’échange contre Cv finit par entraîner la diminution de la pl qui est la part non payée du travail et la base même du profit.
Dans la phase de réalisation du profit par la vente des marchandises, puisque cette diminution de la masse salariale relativement à l’augmentation plus rapide de la production, voire sa diminution absolue, entraîne le phénomène de la « sous-consommation », d’autant plus problématique pour le capital que les gains de productivité et l’énormité de la puissance et de la valeur des moyens de production qui les accompagnent impliquent la nécessité d’une consommation de masse pour répondre à une production de masse6.
Dans la phase de la circulation de la valeur réalisée (la valeur initiale additionnée de la pl) sous forme argent, puisque celui-ci, en partie ou totalement, ne parvient pas à se métamorphoser à nouveau en facteurs de production, en capital se valorisant – et cela manifeste bien la suraccumulation – du fait même de ces difficultés qui ruinent le profit, et le ruinent d’autant plus qu’elles attisent les résistances et la lutte des classes. Résultat: la reproduction du capital ne se fait plus en totalité, ou très difficilement, une partie part en fumée!
Bref, pour résumer en simplifiant, on peut dire que cette baisse de la quantité de travail employé relativement à l’augmentation des forces productives scientifiques incarnées dans les machines, à laquelle chaque capitaliste contribue en cherchant à augmenter son profit particulier, tourne périodiquement en catastrophe pour le capital en général et donc aussi pour tous les capitaux particuliers qui ont chacun de leur côté, et sans le savoir, scié la branche sur laquelle ils étaient tous assis: le travail prolétaire.
Citons quelques exemples de ce phénomène général.
En dix ans… « de 1994 à 2004, la production industrielle a progressé de 10 % au Japon, 25 % en zone euro, 40 % aux USA », et dans le même temps, les pertes d’emploi industriels se sont élevées de 15 % aux USA et en Allemagne, de 7,5 % en France7. Il en va de même pour la si célèbre croissance chinoise. Ce ne sont pas les délocalisations dans les pays à bas coûts de main-d’œuvre qui inversent fondamentalement cette tendance: « la part du capital dans la contribution à la croissance (chinoise) a atteint 62 %… La part de l’augmentation de l’emploi est donc devenue très faible »8.
Selon une étude du Bureau International du Travail (BIT), filiale de l’ONU, la croissance économique mondiale en 2007 a été de 5,2 %, tandis que celle du nombre de travailleurs n’a été que de 1,6 %, la différence s’expliquant par les progrès en matière de productivité9.
De telles crises générales ne sont pas nouvelles. Mais elles sont devenues d’autant plus explosives et dévastatrices que le capital s’est concentré, mondialisé, immensément accumulé en moyens de production mécanisés.
Ainsi, comme on le sait, la crise de 1929 ne s’est terminée que par la deuxième guerre mondiale. Cependant, les experts stipendiés de la bourgeoisie continuent à affirmer que chaque crise n’aurait que des causes spécifiques, dues à des difficultés ou des « erreurs » particulières. Leurs allégations se fondent sur certaines apparences réelles mais superficielles. En général, ils confondent les causes du déclenchement de la crise à tel ou tel moment ou en tel ou tel endroit du procès de valorisation avec celles qui en font une crise généralisée.
Ceci leur permet d’éviter de parler de ces dernières qui gisent dans le phénomène de suraccumulation/sous-consommation, lui-même résultat inéluctable des hausses de productivité générées nécessairement par le rapport social d’appropriation privée des moyens de production propre au capitalisme, rapport qui apparaît ainsi comme la cause ultime. Nous verrons au chapitre 4 que c’est encore ce qu’ils font aujourd’hui. Pensant avoir trouvé la cause particulière dans les excès de la finance seule, y ajoutant parfois la faiblesse des salaires et de la consommation qui serait, selon eux, la contrepartie de ces excès, ils proposent en conséquence des remèdes fallacieux ou utopiques mais ayant tous pour but de revigorer ce capitalisme, vraie cause des catastrophes.
C’est pourquoi, à l’encontre de ces experts, nous devons insister sur le fait que la suraccumulation du capital, révélée par la crise générale révèle, se manifeste comme suraccumulation de toutes les formes que le capital revêt dans le procès de production (A – M – A’). Dans ce procès de production de la plus-value, qui est son existence propre, il passe sans cesse de la forme argent à celles de moyens de production, matières premières, force de travail, marchandise, puis à nouveau argent. Et cela recommence indéfiniment. Un procès est relancé avant même que le précédent ne soit achevé, ce que permet le crédit. Il en résulte que tous les moments du procès s’enchevêtrent ainsi que les procès des multiples capitaux particuliers.
Toutes ces formes de capital existent donc simultanément. Elles dépendent toutes les unes des autres et croissent ou diminuent ensemble. Certes pas forcément au même rythme, ni nécessairement en proportions égales. La conséquence en est que la suraccumulation apparaît toujours dans un secteur particulier, (par exemple, l’immobilier en 2007-2008), ou la pénurie dans tel autre (par exemple, le « choc » pétrolier en 1974 et les suivants).
Evidemment, la crise se déclenche toujours pour une cause particulière de sorte que les « experts » la prennent pour « La » cause. Mais ce fait déclencheur n’implique pas que la suraccumulation n’existe pas partout, pour toutes les formes du capital, argent, marchandises, moyens de production, etc. S’il en était autrement d’ailleurs, la crise ne pourrait pas se généraliser à toutes les branches du capital, à toute son aire mondialisée. Elle serait vite circonscrite par des mesures particulières.
La crise dite des « subprimes », par exemple, est à la fois un « trop » de moyens de production, de marchandises et d’argent dans le secteur immobilier et une « sous-consommation » des masses. Elle illustre aussi le fait que le crédit, qui a mis le « trop » d’argent au débit des acheteurs au lieu qu’il ne soit avancé par le capitaliste constructeur et donc mis à son débit10, n’a été qu’un masque, un élément retardateur de l’éclatement de la contradiction, mais non la cause de cette crise, ni celle de sa généralisation.
Nous verrons au chapitre 2 pourquoi il y eut un tel développement du crédit, et pourquoi cela aboutit nécessairement à une hyper-enflure de titres financiers donnant droits à percevoir un intérêt11. Nous verrons aussi que cela n’enlève rien à ce qui vient d’être dit. Et que l’éclatement en « krachs » de ces « bulles » financières formées par cette hypertrophie n’est que la manifestation visible et spectaculaire des difficultés et des échecs que rencontre non pas seulement cette forme particulière de capital qu’est le capital financier, mais le capital en tant que tel, c’est-à-dire en tant que procès de valorisation.
C’est toujours la production de plus-value qui est l’objet et le résultat attendu (sous forme de profit) de ce procès. Et c’est donc fondamentalement dans ce que les « experts » eux-mêmes appellent « l’économie réelle » que « ça se passe ». Y aurait-il là une sorte d’aveu que le reste est irréel, imaginaire? Bref, c’est là où le capital est matérialisé en moyens et conditions de la production que se joue sa réussite ou son échec. C’est là que l’argent avancé aboutit ou non à la création et à la transformation en argent d’une valeur supérieure à l’initiale.
Au-delà de cette évidence que « l’argent ne produit pas d’argent comme le poirier des poires », bien des faits permettent cependant de confirmer cette vérité que ce sont les difficultés rencontrées par ce procès d’accumulation qui sont au cœur de la crise.
Ainsi, un « expert officiel » écrit que « le dérèglement de la machine économique américaine (considéré par lui comme cause principale de la crise, n.d.a.) qui avait débuté dès la fin 1997 avec la dégradation de la rentabilité des entreprises et qui s’est amplifié avec l’accroissement de leur dette, devait inévitablement déboucher sur une crise financière de grande ampleur »12.
Voilà une affirmation qui situe l’origine de la crise dans la dégradation du taux de profit, la crise financière n’étant qu’une conséquence. Mais si tel est le cas, c’est cette dégradation qu’il aurait fallu expliquer. Or l’auteur ne s’y attache pas; il n’y consacre qu’une dizaine de pages contre quelques 420 consacrées aux problèmes purement financiers. Il se contente de l’argument superficiel selon lequel ce serait la concurrence effrénée en provenance des pays asiatiques à bas salaires qui aurait rogné les bénéfices des entreprises US, européennes et japonaises.
Passons ici sur le fait que nombre de ces entreprises ont, au contraire, gonflé leurs productions et leurs profits grâce aux délocalisations qui ont permis une relance de l’accumulation du capital et retardé l’échéance de la crise. Contentons-nous d’observer que l’auteur se borne au constat suivant: il y a trop d’offres (surcapacités) et pas assez de demandes (sous-consommation), soit en résumé, pour lui, une concurrence trop exacerbée, ce qui fait baisser les profits.
Mais quelles sont les causes de cette situation? Ce n’est pas la concurrence qui est la cause de la pléthore de moyens de production, des gains de productivité, de la diminution relative de la masse salariale. Ce sont là, on vient de le rappeler, des phénomènes inhérents aux rapports d’appropriation privée des moyens de production, rapports qui sont l’essence du capitalisme.
La concurrence n’est qu’un facteur externe au procès de valorisation de chaque capital. Elle est action des capitaux les uns sur les autres et non cause interne de ce procès. Elle n’est que le gendarme qui oblige les capitalistes à se soumettre à la condition d’existence du capital, en l’occurrence la production d’un maximum de profits. C’est pour respecter cette condition qu’ils travaillent à augmenter sans cesse la production et la productivité, et c’est cela qui finit par aboutir pour tous au résultat inverse que chacun recherchait: la baisse du taux de profit. « C’est la baisse du taux de profit qui suscite la concurrence entre les capitaux et non l’inverse »13. Cette baisse contraint en effet les capitalistes individuels à une lutte toujours plus acharnée pour leur survie, ou si l’on préfère, pour la survie de la portion du capital qu’ils gèrent. Et pour cela, tous les moyens sont utilisés: accroissement de la productivité, exploitation accrue, dumping, coups fourrés, guerres.
En ce qui concerne la production de plus-value, l’auteur en reste donc au constat qu’il y a une suraccumulation. Certes, ce phénomène existe. Mais s’en tenir à cela est réducteur. Il faut en fait distinguer deux phénomènes qui se superposent: surcapacités et suraccumulation de capital.
Le premier exprime seulement un déséquilibre, un problème quantitatif tandis que le second est de nature qualitative puisqu’il pose la question du taux de profit, donc des rapports de production. En effet, la suraccumulation de capital sous forme de moyens de production se développe en même temps comme sous-consommation, à partir d’une même cause qui est les gains de productivité. Plus l’accumulation historique du capital est avancée, plus ce phénomène de suraccumulation/sous-consommation (de Cv qui croît moins vite que Cc) prend une ampleur ruineuse pour le taux de profit.
La composition organique du capital atteint un niveau structurellement et définitivement insupportable pour le capital, pour son taux de profit14. Ici, le capitaliste ne peut tenter de contrecarrer cette carence qu’en agissant sur les composantes de ce taux, notamment sur le taux d’exploitation (plus-value/Cv). Il ne peut se contenter comme nous le verrons au chapitre 5 de réduire les surcapacités. La surcapacité indique seulement que l’offre a fini par excéder la demande. Cela arrive toujours vers la fin des phases de croissance dans lesquelles règne l’euphorie. Dans ces périodes, le capital fonctionne « bien » comme il faut, il accumule, la croissance, c’est le bonheur!
La crise est alors perçue comme trop de marchandises sur le marché et « pas assez » de débouchés. On parle alors de « crise des débouchés ». Il suffirait alors de détruire cet excédent de moyens de production ou/et d’augmenter les salaires pour retrouver un équilibre satisfaisant. Il ne s’agirait que d’un problème conjoncturel d’ajustement quantitatif entre offre et demande, part des profits et part des salaires.
Ce raisonnement est basé sur une réalité, on l’a dit, les surcapacités existent. Mais on oublie une autre réalité: c’est que ce n’est pas là la cause fondamentale de la baisse du taux de profit. Et c’est pourtant cette dernière qui indique qu’il s’agit d’une crise structurelle du capitalisme, une crise dans les rapports de production qui ne permettent plus une production suffisante de plus-value. C’est donc eux que le capital doit modifier. La crise structurelle, systémique, est par conséquent toujours le moment d’une restructuration de ces rapports. C’est ce sur quoi nous reviendrons in fine. Pour le moment, contentons-nous du constat de ces surcapacités qui sont une part de la réalité, et doivent être considérées à ce titre.
Ainsi, notre expert observe que les surcapacités dans le secteur automobile étaient déjà très fortes dès l’année 2000. Elles n’étaient masquées « qu’à coups de crédits à taux zéro et de remises de plus en plus considérables »15. Cela conduisait à stimuler artificiellement la demande au prix « d’une réduction suicidaire des marges ». Mais malgré tout, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) tombait à 65 % dès 2006.
De la même façon, dans le secteur des « nouvelles technologies de l’information » (NTI) que les experts officiels s’enthousiasmaient à présenter comme une source de croissance et de profits extraordinaires, « leur TUC tombait de 92,5 % en mai 2000 à 56,5 % deux ans plus tard »16. En fait, les surcapacités touchaient quasiment tous les secteurs de l’économie U.S. En 2000, on constatait que « le niveau du TUC dans le secteur des produits finaux n’était jamais tombé aussi bas depuis l’après-guerre, à 70,5 % alors que la moyenne de longue période est de 80 % ».
Le même constat pouvait être fait pour l’U.E. et le Japon, puis un peu plus tard pour l’ensemble des pays industrialisés. Le fait qu’il y ait « trop » de capital relativement à la pl réalisable se manifeste d’ailleurs très clairement par un ralentissement des investissements productifs bien que les profits et plus encore les liquidités disponibles à bas taux d’intérêt soient encore importants. Puis, c’est le désinvestissement forcé, la destruction massive du capital « excédentaire » sous toutes ses formes, financières, moyens de production, marchandises, force de travail, etc. C’est alors le moment de la crise, ses premières manifestations.
Le ralentissement de la croissance mondiale depuis le début des années 70 était déjà symptomatique de ce phénomène. En croissance annuelle moyenne, elle fut respectivement de 5,5 %, 3,8 %, 3,1 % et 2,6 % dans les décennies 61-70, 71-80, 81-90, 91-2000, et inférieure à 2 % ensuite jusqu’à être devenue négative aujourd’hui17. Cette décélération fut encore plus forte dans les pays à haute technologie; elle fut respectivement de 5,5 %, 3,5 %, 3,2 % et 2,5 %.
Deux autres faits significatifs de cette tendance au blocage de l’accumulation (du réinvestissement productif) sont à signaler: d’une part, l’ampleur prise par les opérations de rachats de leurs propres actions par les sociétés cotées en bourse, et d’autre part, la distribution des profits plutôt que leur réinvestissement.
La distribution des profits n’a pas pour seule cause l’avidité immédiate des financiers car s’ils avaient des espoirs d’investissements juteux, ils les feraient (en effet, le capitaliste ne demeure capitaliste que pour autant qu’il travaille toujours à accumuler plutôt que de consommer). Ainsi, selon la célèbre agence financière Standard and Poors, les rachats d’actions des 500 premières sociétés US ont dépassé 1300 milliards $ au cours des 3 années 2005-2008, contre seulement 1276 milliards $ consacrés aux investissements. En France, les 40 plus importantes entreprises cotées au CAC 40 ont racheté en 2007 pour 19 milliards d’euros de leurs actions et distribué 38 milliards de dividendes. En 2008, elles ont 11 milliards de rachats et 43 milliards de dividendes (soit sur ces deux années, 111 milliards non réinvestis)18. En France toujours, « l’ensemble des revenus nets distribués par les sociétés non financières représente 26 % du résultat opérationnel en 2007, contre seulement 15 % en 1993 »19.
L’Europe dans son ensemble connaît le même phénomène, comme le montre cette observation faite dès 2001 par un expert: « sur l’ensemble des marchés européens, les émissions nettes d’actions, c’est-à-dire les montants bruts des émissions corrigés des rachats d’actions et des dividendes versés aux actionnaires, ont été négatives ces dernières années »20. Or, confesse un autre, « rien de plus inquiétant que ces rachats d’actions massifs puisqu’ils signifient que les entreprises concernées et leurs managements n’ont pas de projets d’investissement à long terme suffisamment créateurs de richesses (de profits, n.d.a.) et qu’ils préfèrent encore rendre l’argent à leurs actionnaires… »21. Voilà qui est bien dit!
Pour en terminer sur ce point, citons cet autre fait significatif qu’est l’ampleur des opérations de fusions-acquisitions, OPA et autres. « En 2007, celles-ci ont atteint 1600 milliards $ en Europe et 1800 aux USA »22. Or il s’agit là seulement d’éliminer un concurrent et de capter ses clients. Ces opérations ne créent aucune capacité de production supplémentaire. Au contraire, celles-ci sont le plus souvent réduites car elles servent à éliminer les doublons ou les capacités excédentaires. Et quand ces achats se font par des opérations à « effet de levier » (les fameux LBO: Leverage Buy Out), c’est-à-dire quand l’acquisition est financée essentiellement par emprunt mis à la charge de l’entreprise rachetée, il s’en suit en général un arrêt des investissements pour rembourser au plus vite l’emprunt et un dépeçage de l’entreprise pour prendre un bénéfice rapide.
A défaut de pouvoir vraiment l’expliquer comme une opération inhérente au capitalisme, de nombreux économistes se sont accordés néanmoins à constater une ancienne et forte tendance au ralentissement, voire parfois au blocage du procès d’accumulation. Ils entérinaient ainsi sans le vouloir le fait bien réel de la suraccumulation de capital bien qu’ils ne le comprenaient que comme un problème d’équilibre quantitatif entre des surcapacités dans la production d’un côté et des faiblesses du pouvoir d’achat de l’autre, ce qui, selon eux, conduisait à une concurrence toujours plus virulente qui abaissait les prix ainsi que les taux de profit.
Observons que ce ralentissement puis cette régression de l’accumulation, phénomènes significatifs de la suraccumulation, se manifestent aussi bien comme insuffisance que comme « excès » de profits.
Insuffisance de profit par rapport au capital engagé (faiblesse du taux de profit). Excès de profit parce que la pl produite sous forme d’argent à la fin d’un cycle de production ne trouve pas, en tout ou partie, à se réinvestir en capital additionnel, c’est-à-dire en moyens de valorisation, du fait même de la faiblesse du taux de profit et donc du risque accru d’une perte. C’est de l’argent « décapitalisé », de l’argent qui ne peut plus être capital (sauf sous forme de capital financier fictif dont nous parlerons au chapitre 3).
Cela ne rend pas pour autant valable la thèse « régulationniste » qui prétend que cet excès de pl provient d’un excès d’affaiblissement des salaires. Accepter cette explication revient à considérer la crise comme une crise « des débouchés ». On pourrait donc, selon les « régulationnistes », surmonter la crise par une meilleure répartition de la « valeur ajoutée », c’est-à-dire par une augmentation des salaires des ouvriers au détriment des dividendes pour les actionnaires. Cela « régulerait » l’accumulation capitaliste en rééquilibrant production et consommation. Nous reparlerons de cette thèse au chapitre 4.
Mais déjà, on peut dire que ce raisonnement utilise la catégorie « production », laquelle est inopérante si on ne l’entend pas pour ce qu’elle est concrètement, c’est-à-dire production de plus-value. Et si on l’entend bien comme telle, on ne peut plus parler d’excès des profits distribués en les séparant de leur insuffisance ainsi qu’il vient d’être dit. Il est clair qu’une augmentation des salaires au détriment des profits ne saurait résoudre le problème de cette insuffisance qui est cause de la crise.
Pour en rester à l’histoire récente du capitalisme, on observera que les nombreuses crises qui se sont succédées au cours de ces trente dernières années ont pu être circonscrites et surmontées assez facilement. Elles n’ont pas, comme celle d’aujourd’hui, dégénéré en crise systémique généralisée parce que le capitalisme a pu mettre en œuvre plusieurs contre-tendances à la baisse du taux de profit. Ces contre-tendances ont des noms. Elles s’appellent défaites des prolétaires, mondialisation et extension du crédit:
1°) Les défaites des prolétaires dans ce qu’étaient jusque-là leurs plus vieux et leurs plus solides bastions (sidérurgie, charbonnages, chemins de fer, etc.) ont été marquées par l’effritement des « acquis sociaux » d’après-guerre sous les coups de boutoir des gouvernements Reagan, Thatcher, Mitterrand et autres. Ces attaques ont permis à la bourgeoisie d’entamer une longue période de destruction des anciens rapports de production, souvent appelés « le compromis fordiste ». Ces anciens rapports ont été remplacés progressivement par de nouveaux rapports « précaires », ou « libéraux » selon la terminologie officielle. Nous montrerons au chapitre 5 le contenu, l’importance et les limites de cette transformation.
2°) La mondialisation, dans sa 3ème phase historique, a accompagné ces transformations. Elle ne sera évoquée que très brièvement ici car elle a déjà fait l’objet d’un ouvrage particulier23. Rappelons simplement qu’elle a puissamment contribué à l’aggravation de l’exploitation des prolétaires et à la mise en place des rapports de précarité, tout en élargissant l’aire de valorisation et d’accumulation du capital.
3°) L’extension considérable, d’une ampleur inouïe et sans précédent, du crédit. Ce point fera l’objet des chapitres 2 et 3.
Ce n’est que vers la deuxième moitié des années 90 que la tendance à la baisse du taux de profit a commencé à reprendre résolument le dessus. Au point qu’on a pu lire ce genre de commentaire d’un « expert » financier français: « La baisse sensible de la rentabilité du capital, constatée aux USA à partir de 1997, semble redonner une certaine actualité à la théorie de la baisse tendancielle du taux de profit de Marx… L’accumulation de capital productif aux USA entre 1992 et 2000 a provoqué, à partir de 1997, une baisse forte de la rentabilité du capital, due sans doute aux rendements décroissants »24.
Mais pour rendre compte de la grande crise généralisée et « systémique » ouverte dans les années 2007-2008, nous commencerons par expliquer les raisons de l’hypertrophie du crédit et le rôle de celui-ci dans la crise. On nous en rebat les oreilles pour nous faire croire que la crise ne serait due qu’à ce dérèglement financier, qu’il s’agirait seulement d’exagérations dues à un trop grand laxisme des Etats « libéraux », aux paradis fiscaux ou à quelques financiers trop gloutons avides de bonus, de stock-options et de parachutes dorés. On essaie de nous faire croire qu’il serait possible de s’opposer à tout cela par une politique d’intervention étatique qui remettrait à l’ordre du jour la réglementation et le contrôle, ou même un peu d’ordre et de morale dans un capitalisme par ailleurs sain et ne demandant qu’à prospérer pour le bien de tous. Une fois que tous ces arguments, qui encombrent le champ de l’analyse et l’obscurcissent, auront été démontés et évacués, il sera plus aisé de passer aux choses sérieuses: les vraies solutions possibles à partir des vraies causes de la crise.
Note :
Cc, capital constant.
Cv, capital variable (salaire)













 L’Unesco a officiellement inscrit le Manifeste du Parti communiste ainsi que le premier livre du Capital, de Karl Marx, sur la liste du patrimoine de l’humanité. Voilà une belle et légitime consécration pour l’auteur qui a le mieux su analyser le capitalisme, et tracer la voie pour en finir avec ce système. Cette nouvelle ne doit cependant pas réjouir les grands de ce monde, pour qui Marx est l’incarnation du plus grand danger : celui de voir les travailleurs s'unir et se soulever pour se libérer des chaînes du capital. Puisse ce patrimoine continuer à inspirer les travailleurs du monde.
L’Unesco a officiellement inscrit le Manifeste du Parti communiste ainsi que le premier livre du Capital, de Karl Marx, sur la liste du patrimoine de l’humanité. Voilà une belle et légitime consécration pour l’auteur qui a le mieux su analyser le capitalisme, et tracer la voie pour en finir avec ce système. Cette nouvelle ne doit cependant pas réjouir les grands de ce monde, pour qui Marx est l’incarnation du plus grand danger : celui de voir les travailleurs s'unir et se soulever pour se libérer des chaînes du capital. Puisse ce patrimoine continuer à inspirer les travailleurs du monde.