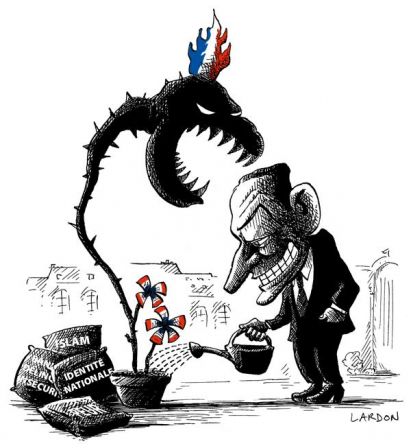B — Le capitalisme monopoliste ou impérialisme
Chapitre 18 — L’impérialisme, stade suprême du capitalisme — La loi économique fondamentale du capitalisme monopoliste
18.1. Le passage à l’impérialisme.
Le capitalisme prémonopoliste avec la domination de la libre concurrence a atteint le point culminant de son développement vers les années 1860-1870. Au cours du dernier tiers du 19e siècle s’est opéré le passage du capitalisme prémonopoliste au capitalisme monopoliste. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, le capitalisme monopoliste s’est définitivement constitué.
Le capitalisme monopoliste ou impérialisme est le stade suprême et ultime du capitalisme, dont le trait distinctif essentiel est que la libre concurrence fait place à la domination des monopoles.
Le passage du capitalisme prémonopoliste au capitalisme monopoliste — à l’impérialisme — a été préparé par tout le processus de développement des forces productives et des rapports de production de la société bourgeoise.
Le dernier tiers du 19e siècle a été marqué par de grandes transformations techniques, le progrès de l’industrie et sa concentration. Dans la métallurgie se sont répandues largement de nouvelles méthodes de production de l’acier (procédés Bessemer, Thomas, Martin). La diffusion rapide des nouveaux types de moteurs — moteurs à combustion interne, turbines à vapeur, moteurs électriques — a accéléré le développement de l’industrie et des transports. Les acquisitions de la science et de la technique ont permis de produire l’énergie électrique en grande quantité dans des centrales thermiques, puis dans des centrales hydroélectriques de grande puissance. L’utilisation de l’énergie électrique a amené la création d’une série de nouvelles branches de l’industrie chimique et de la métallurgie. L’emploi des procédés chimiques s’est étendu dans de nombreuses branches et processus de production. Le perfectionnement des moteurs à combustion interne a contribué à l’apparition et à l’extension des transports automobiles, et ensuite de l’aviation.
Vers le milieu du 19e siècle, l’industrie légère tient encore une place prédominante dans l’industrie des pays capitalistes. De nombreuses entreprises d’importance relativement faible appartenaient à des propriétaires individuels, la part des sociétés par actions était relativement peu importante. La crise économique de 1873 a frappé à mort beaucoup de ces entreprises et donne une impulsion vigoureuse à la concentration et à la centralisation du capital. Le rôle primordial dans l’industrie des principaux pays capitalistes passa alors à l’industrie lourde, avant tout à la métallurgie et aux constructions mécaniques, de même qu’à l’industrie minière extractive, dont le développement nécessitait d’immenses capitaux. La grande extension des sociétés par actions a augmenté encore la centralisation du capital.
Le volume de la production industrielle mondiale a triplé de 1870 à 1900. La production mondiale de l’acier est passée de 0,5 million de tonnes en 1870 à 28 millions de tonnes en 1900, et la production mondiale de fonte de 12,2 millions de tonnes à 40,7 millions. Le développement de la production d’énergie, de la métallurgie et de la chimie a déterminé l’augmentation de l’extraction mondiale de charbon (de 218 millions de tonnes en 1870 à 769 millions de tonnes en 1900) et du pétrole (de 0,8 million de tonnes à 20 millions de tonnes). Le progrès de la production industrielle était étroitement lié au développement des transports ferroviaires. En 1835, dix ans après la construction de la première voie ferrée, il y avait dans le monde entier 2 400 kilomètres de voies ferrées ; en 1870, on en comptait plus de 200 000 et en 1900, 790 000. De grands navires propulsés par des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne furent mis en service sur les voies maritimes.
Au cours du 19e siècle, le mode de production capitaliste s’est rapidement étendu à tout le globe. Vers 1870, le plus vieux pays bourgeois — l’Angleterre — produisait encore plus de tissus, de fonte et de charbon que les États-Unis d’Amérique, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Russie et le Japon réunis. C’est l’Angleterre qui se classait première dans la production industrielle mondiale et détenait un monopole absolu sur le marché mondial. À la fin du 19e siècle, la situation change radicalement. Les pays capitalistes neufs ont leur grande industrie. Cela a fait perdre à l’Angleterre la primauté industrielle et sa situation de monopole sur le marché mondial. Pour le volume de la production industrielle, les États-Unis tiennent le premier rang dans le monde, et l’Allemagne en Europe. La Russie a avancé rapidement sur la voie du développement industriel malgré les obstacles dressés par les nombreuses survivances du servage dans le régime économique et social du pays et par le régime tsariste totalement pourri.
Au fur et à mesure que l’on passe à l’impérialisme, les contradictions entre les forces productives et les rapports de production du capitalisme prennent des formes de plus en plus aiguës. La subordination de la production à la course des capitalistes au profit maximum dresse de nombreuses barrières sur le chemin du développement des forces productives. Les crises économiques de surproduction deviennent plus fréquentes, leur force destructrice augmente, l’armée des chômeurs grandit. Avec l’accroissement de la misère et du dénuement des masses travailleuses des villes et des campagnes, la richesse, accumulée entre les mains d’une poignée d’exploiteurs, augmente comme jamais auparavant. L’aggravation des contradictions de classes inconciliables entre la bourgeoisie et le prolétariat aboutit au renforcement de la lutte économique et politique de la classe ouvrière.
Lors du passage à l’impérialisme, les plus grandes puissances capitalistes se sont emparées, par la violence et la duperie, de vastes possessions coloniales. Les cercles dirigeants des pays capitalistes développés ont transformé la majorité de la population du globe en esclaves coloniaux, qui haïssent leurs oppresseurs et se dressent pour lutter contre eux. Les conquêtes coloniales ont élargi considérablement le champ de l’exploitation capitaliste ; en même temps le degré d’exploitation des masses laborieuses ne cesse d’augmenter. L’aggravation extrême des contradictions du capitalisme trouve son expression dans les guerres impérialistes dévastatrices, qui emportent des multitudes de vies humaines et détruisent d’immenses richesses matérielles.
Le mérite historique de l’analyse marxiste de l’impérialisme, comme stade suprême et ultime du développement du capitalisme et comme prélude à la révolution socialiste du prolétariat, appartient à Lénine. Dans son ouvrage classique L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme et dans plusieurs autres écrits datant surtout des années de la première guerre mondiale, Lénine a fait le point du développement du capitalisme mondial au cours du demi-siècle écoulé depuis la parution du Capital de Marx. S’appuyant sur les lois découvertes par Marx et Engels sur la naissance, le développement et la décadence du capitalisme, Lénine a fait une analyse scientifique exhaustive de la nature économique et politique de l’impérialisme, de ses lois et de ses contradictions insolubles.
Suivant la définition classique de Lénine les caractères économiques fondamentaux de l’impérialisme sont :
1) concentration de la production et du capital parvenue à un degré de développement si élevé qu’elle a créé les monopoles, dont le rôle est décisif dans la vie économique ;
2) fusion du capital bancaire et du capital industriel, et création, sur la base de ce «capital financier», d’une oligarchie financière ;
3) l’exportation des capitaux, à la différence de l’exportation des marchandises, prend une importance toute particulière ;
4) formation d’unions internationales monopolistes de capitalistes se partageant le monde,
et 5) fin du partage territorial du globe entre les plus grandes puissances capitalistes.
V. Lénine, « L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme », Œuvres, t. 22, p. 287.
18.2. La concentration de la production et les monopoles. Les monopoles et la concurrence.
La libre concurrence qui régnait au stade prémonopoliste du capitalisme avait déterminé un processus rapide de concentration de la production dans des entreprises de plus en plus grandes. L’action de la loi de la concentration et de la centralisation du capital a amené infailliblement la victoire des grandes et des très grandes entreprises, à côté desquelles les entreprises petites et moyennes jouent un rôle de plus en plus subalterne. À son tour la concentration de la production a préparé le passage du règne de la libre concurrence à la domination des monopoles, qui anéantissent la liberté de la concurrence et en même temps rendent la lutte pour la concurrence dans le monde capitaliste particulièrement acharnée et dévastatrice.
En Allemagne, les entreprises occupant plus de 50 travailleurs groupaient, en 1882, 22 % de la totalité des ouvriers et des employés ; en 1895, 30 % ; en 1907, 37 % ; en 1925, 47,2 % et en 1939, 49,9 %. La part des très grandes entreprises (occupant plus de 1 000 travailleurs) dans l’ensemble de l’industrie est passée de 1907 à 1925, pour le nombre des ouvriers occupés, de 9,6 à 13,3 %, pour la puissance des moteurs, de 32 à 41,1 %. En 1952, en Allemagne Occidentale, dans les entreprises employant 50 ouvriers et plus étaient concentrés 84,6 % de l’ensemble des ouvriers et employés, et dans les plus grandes entreprises (employant 1 000 ouvriers et plus) 34,1 %.
Aux États-Unis d’Amérique, en 1904, les plus grandes entreprises dont la production dépasse un million de dollars représentaient 0,9 % du nombre total des entreprises ; ces entreprises occupaient 25,6 % de l’ensemble des ouvriers, et elles fournissaient 38 % de la production globale de l’industrie. En 1909, les plus grandes entreprises, représentant 1,1 % de la totalité des entreprises, comptaient 30,5 % de tous les ouvriers occupés et fournissaient 43,8 % de la production globale. En 1939, les plus grandes entreprises, formant 5,2 % de la totalité des entreprises, concentraient 55 % de tous les ouvriers occupés et 67,5 % de la production globale de l’industrie. Un groupe encore plus restreint de sociétés industrielles géantes, au capital de plus de 100 millions de dollars chacune, produisait en 1954 47 % de la production industrielle totale et obtenait 63 % de la masse générale des profits.
En France, en 1952, plus de 48 % des salaires étaient payés par de grandes entreprises qui ne représentaient que 0,5 % du nombre total des entreprises.
L’industrie de la Russie se distinguait par un haut degré de concentration. En 1879, les grandes entreprises (occupant plus de 100 ouvriers ; formaient 4,4 % de toutes les entreprises et concentraient 54,8 % de la production totale. En 1903, les grandes entreprises concentraient déjà 76,6 £ ; des ouvriers industriels et fournissaient la plus grande partie de la production industrielle.
La concentration de la production est plus rapide dans l’industrie lourde et dans les nouvelles branches d’industrie (produits chimiques, électrotechnique, automobile, etc.) ; elle est plus lente dans l’industrie légère qui, dans tous les pays capitalistes, compte de nombreuses entreprises petites et moyennes.
Une des formes de la concentration de la production est la forme combinée, c’est-à-dire la réunion dans une seule entreprise de plusieurs branches de la production, qui ou bien constituent des stades successifs de la transformation de la matière brute (par exemple, les combinats métallurgiques comprenant l’extraction des minerais, la coulée de la fonte et de l’acier, le laminage), ou bien jouent un rôle auxiliaire les unes par rapport aux autres (par exemple, l’utilisationdes déchets de la production). La forme combinée donne aux grandes entreprises un avantage encore plus important dans la concurrence.
À un certain degré de son développement, la concentration de la production conduit tout droit au monopole. Il est plus facile à quelques dizaines d’entreprises géantes de parvenir à un accord entre elles qu’à des centaines et des milliers de petites entreprises. D’autre part, dans la lutte pour la concurrence entre les plus grandes entreprises, celles qui l’emportent sont les entreprises géantes qui disposent de masses énormes de profit, et c’est le monopole qui assure le profit élevé. Ainsi, la libre concurrence fait place au monopole. C’est l’essence économique de l’impérialisme. La formation du monopole qu’entraîne la concentration de la production est une loi au stade actuel du développement du capitalisme.
Le monopole est une entente ou une union de capitalistes qui concentrent entre leurs mains la production et l’écoulement d’une partie considérable de la production d’une ou de plusieurs branches d’industrie, en vue de fixer des prix élevés sur les marchandises et de s’attribuer un profit élevé de monopole. Les monopoles peuvent être constitués parfois par certaines très grandes firmes particulières qui occupent une position dominante dans une branche particulière de la production.
Les accords à court terme sur les prix de vente sont les formes les plus simples du monopole. Ils ont des appellations différentes : conventions, corners, rings, etc. Les formes plus développées du monopole sont les cartels, les syndicats, les trusts et les consortiums. Le cartel est une union monopoliste dont les membres se concertent sur les conditions de vente, les délais de paiement, se partagent les débouchés, déterminent la quantité de marchandises à produire, fixent les prix. La quantité de marchandises que chacun des participants d’un cartel est eu droit de produire et de vendre, s’appelle la quote-part ; en cas de non-observation de la quote-part, une amende est versée à la caisse du cartel. Le syndicat est une organisation monopoliste dans laquelle la vente des marchandises, et parfois aussi l’achat des matières premières s’effectuent par un comptoir commun. Le trust est un monopole dans lequel la propriété de toutes les entreprises est réunie, et leurs propriétaires sont devenus des actionnaires percevant un dividende au prorata du nombre des parts ou des actions qui leur appartiennent. À la tête du trust, se trouve un conseil d’administration qui dirige l’ensemble de la production, l’écoulement des articles fabriqués et les finances des entreprises antérieurement indépendantes. Les trusts font souvent partie de groupements plus vastes, dits consortiums. Le consortium groupe plusieurs entreprises de diverses branches d’industrie. des firmes commerciales, des banques, des compagnies de transports et d’assurances, sur la base d’une dépendance financière commune par rapport à un groupe déterminé de gros capitalistes.
Les monopoles occupent les postes de commande de l’économie des pays capitalistes. Ils englobent l’industrie lourde, ainsi que de nombreuses branches de l’industrie légère, les transports par fer et par eau, les assurances, le commerce intérieur et extérieur, les banques ; ils exercent leur domination sur l’agriculture.
Dans la sidérurgie des États-Unis d’Amérique dominent huit monopoles sous le contrôle desquels, en 1963, se trouvaient 83 % du potentiel de production d’acier du pays ; les deux plus puissants d’entre eux, la U.S. Steel Corporation et la Bethleem Steel Corporation disposaient de 49 % de tout le potentiel de production. Le monopole le plus ancien des États-Unis est la Standard Oil. Dans l’industrie automobile trois firmes jouent un rôle déterminant : la General Motors, Ford et Chrysler. Dans l’industrie électrotechnique le rôle dominant appartient à deux firmes : la General Electric et Westinghouse. L’industrie chimique est contrôlée par le consortium Dupont de Nemours, l’industrie de l’aluminium par le consortium Mellon.
En Angleterre, le rôle des groupements monopolistes a particulièrement grandi après la première guerre mondiale, où des cartels firent leur apparition dans l’industrie du textile et celle du charbon, dans la sidérurgie et dans une série de nouvelles branches d’industrie. Le trust Impérial chemical Industries contrôle près des 9/10e des produits chimiques essentiels, près des 2/5e de la production des colorants et presque toute la production de l’azote du pays. Il est étroitement lié aux principales branches de l’industrie anglaise et, notamment, aux consortiums militaires.
En Allemagne, les cartels sont largement répandus depuis la fin du siècle dernier. Dans l’entre-deux-guerres, l’économie du pays est dominée par le trust de l’acier (Vereinigte Stahlwerke) qui occupe près de 200 000 ouvriers et employés, le trust des produits chimiques (Interessen-Gemein-schaft Farbenindustrie) avec 100 000 ouvriers et employés, les monopoles de l’industrie houillère, le consortium des canons Krupp, les consortiums électrotechniques, la Société générale d’électricité (A.E.G.) et Siemens. En Allemagne Occidentale, les grandes compagnies par actions (au capital de plus de 10 millions de marks) possédaient en 1952 74 % de la totalité du capital des compagnies par actions. En 1955, elles totalisaient 80 % de ce capital. Dans l’industrie minière, les grandes entreprises possèdent 90 % du capital par actions, 81 % dans la sidérurgie, 99 % dans l’industrie du pétrole. Les capitaux des trois compagnies qui ont hérité de l’I.G. Farbenindustrie sont trois fois plus élevés que ceux de toutes les autres compagnies chimiques de l’Allemagne Occidentale. Dans l’industrie électrotechnique, huit grandes compagnies possèdent 82 % du capital par actions. Les deux plus importantes, la Société générale d’électricité (A.E.G.) et Siemens, avec les firmes qu’elles contrôlent, détiennent 75 % du capital par actions de l’industrie chimique.
En France, à l’heure actuelle, la totalité de la production d’aluminium est concentrée dans les mains d’un seul groupe. Une seule firme contrôle 80 % de la production des colorants. Deux sociétés possèdent 75 % des chantiers navals. Trois sociétés contrôlent 72 % de l’industrie des ciments ; trois autres 90 % des pneumatiques ; trois autres 65 % de l’industrie du sucre. 96 % de la production des automobiles sont concentrés entre les entreprises de quatre sociétés. Cinq grandes sociétés détiennent 70 à 75 % de la production de l’acier ; cinq autres 90 % de l’industrie du raffinage du pétrole ; cinq autres 50 % de l’industrie cotonnière.
En Italie, au Japon et môme dans de petits pays tels que la Belgique, la Suède, la Suisse, les organisations monopolistes occupent les postes de commande de l’industrie.
En Russie, avant la Révolution, les grands monopoles englobèrent tout d’abord les branches maîtresses de l’industrie lourde. Le syndicat Prodamet (groupement pour la vente de la production des entreprises métallurgiques), formé en 1902, dirigeait l’écoulement de plus des 4/5e des métaux ferreux. En 1904 a été fondé le syndicat Prodwagon, qui monopolisait presque entièrement la fabrication et la vente des wagons. Un syndicat analogue groupait les usines de construction de locomotives. Le syndicat Prodougol, créé en 1904 par les plus grandes entreprises houillères du bassin du Donetz, qui appartenaient au capital franco-belge, contrôlait les trois quarts de toutes les extractions de charbon de ce bassin.
Les économistes bourgeois, désireux de présenter le capitalisme actuel sous un jour favorable, prétendent que l’extension des monopoles aboutit à guérir le régime bourgeois de maux tels que la concurrence, l’anarchie de la production, les crises. En réalité, l’impérialisme est non seulement impuissant à supprimer la concurrence, l’anarchie de la production et les crises, mais il aggrave encore davantage toutes les contradictions du capitalisme.
Lénine disait que l’impérialisme ne peut réformer le capitalisme de fond en comble. Malgré le rôle dominant des monopoles, il subsiste de nombreuses entreprises moyennes et petites, ainsi qu’une masse de petits producteurs, paysans et artisans, dans tous les pays capitalistes. Le monopole, qui se crée dans une série de branches de l’industrie, accentue le chaos propre à l’ensemble de l’économie capitaliste.
[…] les monopoles n’éliminent pas la libre concurrence dont ils sont issus ; ils existent au-dessus et à côté d’elle, engendrant ainsi des contradictions, des frictions, des conflits particulièrement aigus et violents.
V. Lénine, « L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme », Œuvres, t. 22, p. 286-287.
Premièrement, la concurrence subsiste à l’intérieur des monopoles. Les membres des syndicats et des cartels luttent entre eux pour des débouchés plus avantageux, pour une plus grande quote-part dans la production et la vente. Dans les trusts et les consortiums, la lutte se poursuit pour les postes de direction, pour le contrôle de l’affaire, pour la répartition des profits.
Deuxièmement, la concurrence a lieu entre les monopoles : tant entre les monopoles d’une même branche d’industrie qu’entre ceux des différentes branches qui s’approvisionnent en marchandises les unes les autres (par exemple, les trusts de l’acier et de l’automobile) ou qui produisent des marchandises susceptibles de se remplacer les unes les autres (charbon, pétrole, énergie électrique). Étant donné la capacité restreinte du marché intérieur, les monopoles produisant les objets de consommation, se font une guerre à outrance pour l’écoulement de leurs marchandises.
Troisièmement, la concurrence a lieu entre les monopoles et les entreprises non monopolisées. Les branches d’industrie monopolisées se trouvent dans une situation privilégiée par rapport aux autres branches. Les monopoles prennent toutes mesures utiles pour étouffer les entreprises « en marge », les « outsiders », qui ne font pas partie des groupements monopolistes.
La domination des monopoles confère à la concurrence un caractère particulièrement destructeur et rapace. Les monopoles pour étouffer l’adversaire mettent en jeu tous les procédés possibles de violence directe, de corruption et de chantage ; ils recourent aux machinations financières les plus compliquées et utilisent largement l’appareil d’État.
La domination des monopoles entraîne une socialisation plus poussée de la production. Mais les fruits de cette socialisation reviennent à un petit nombre de monopoles, dont le joug sur le reste de la population devient particulièrement lourd. C’est ’aggravation continue de la contradiction fondamentale du capitalisme — celle qui existe entre le caractère social de la production et la forme privée de l’appropriation capitaliste ; aussi les crises deviennent-elles encore plus dévastatrices.
18.3. La concentration et les monopoles dans les banques. Le nouveau rôle des banques.
On ne saurait avoir une idée suffisamment complète de la puissance et de l’importance réelles des monopoles actuels, si l’on ne tient pas compte du rôle que jouent les banques. Là, de même que dans l’industrie, il y a concentration du capital et passage de la libre concurrence au monopole.
Au début, les banques servaient principalement d’intermédiaire dans les paiements. Avec le développement du capitalisme, s’accroît l’activité des banques en tant que marchands de capitaux. L’accumulation du capital et la concentration de la production dans l’industrie ont amené la concentration dans les banques d’énormes fonds disponibles qui cherchent un emploi lucratif. La part des grandes banques dans la masse globale des chiffres d’affaires bancaires n’a cessé de croître.
Dans le système bancaire, de même que dans l’industrie, la concentration conduit au monopole. Les plus grandes banques, en accaparant les actions, en consentant des crédits, etc. mettent la main sur les petites. Détenant une situation de monopole, les grosses banques passent entre elles des accords pour le partage des zones d’influence. Il se crée des unions monopolistes de banques. Chacune de ces unions contrôle des dizaines et parfois des centaines de banques moins importantes qui deviennent, de fait, leurs filiales. Un réseau serré de succursales permet aux grandes banques de réunir dans leurs caisses les fonds d’un grand nombre d’entreprises. Presque tout le capital-argent de la classe capitaliste et les épargnes des autres couches de la population sont à la disposition de petits groupes de brasseurs d’affaires des banques.
Au cours des trente-trois années qui précédèrent la première guerre mondiale (1880-1913), le seul accroissement des dépôts dans les systèmes bancaires des quatre plus grands États capitalistes — États-Unis d’Amérique, Allemagne, Angleterre et France — a atteint 127 milliards de marks. Depuis, l’accroissement des dépôts a été encore plus rapide ; dans une période deux fois plus courte — de 1913 à 1928 — les dépôts dans ces pays se sont accrus de 183 milliards de marks.
Aux États-Unis, la part des 20 plus grandes banques était en 1900, de 15 % ; en 1929, de 19 % ; en 1939, de 27 % et en 1952 de 29 % de la totalité des dépôts dans toutes les banques des États-Unis. Le nombre total des banques commerciales aux États-Unis est passé de 30 100 en 1920 à 14 400 a la fin de 1954. En Angleterre, la somme des bilans des cinq plus grandes banques était en 1900, de 28 % ; en 1916, de 37 % ; en 1929, de 73 % et en 1952, de 79 % de la somme globale des bilans de toutes les banques de dépôt britanniques. En France, la part de six banques de dépôt, en 1952, était de 66 % de la somme globale des dépôts dans toutes les banques françaises. En Allemagne, à la veille de la première guerre mondiale, les grandes banques de Berlin concentraient près de la moitié des dépôts existant dans toutes les banques allemandes ; en 1929-1932, les deux tiers.
La concentration de l’industrie et la constitution des monopoles bancaires amènent une modification radicale des rapports entre les banques et l’industrie. Avec l’agrandissement des entreprises, une importance sans cesse accrue s’attache aux gros crédits à long terme que les banques consentent aux capitalistes industriels. L’accroissement de la masse des dépôts dont disposent les banques ouvre de larges possibilités pour le placement à long terme des fonds bancaires dans l’industrie.
La forme la plus répandue de l’investissement des fonds bancaires dans l’industrie est l’achat d’actions de telles ou telles entreprises. Les banques contribuent à la formation d’entreprises par actions en se chargeant de la réorganisation des entreprises capitalistes isolées en sociétés par actions, ainsi que de la création de nouvelles sociétés par actions. La vente et l’achat des actions se font de plus en plus par l’intermédiaire des banques.
Les intérêts des banques et des entreprises industrielles s’entremêlent de plus en plus étroitement. Lorsqu’une banque consent des avances à plusieurs grandes entreprises d’une branche d’industrie donnée, elle a intérêt à une entente monopoliste entre elles et elle y contribue. C’est ainsi que les banques renforcent et accélèrent le processus de concentration du capital et la formation des monopoles.
La transformation des banques, de modestes intermédiaires en une poignée de monopoles tout-puissants, constitue l’un des processus fondamentaux de la transformation du capitalisme de l’époque de la libre concurrence en capitalisme monopoliste.
18.4. Le capital financier et l’oligarchie financière.
Lorsque les banques deviennent copropriétaires d’entreprises industrielles, commerciales et de transport, en achetant leurs actions et obligations, et que les monopoles industriels possèdent, de leur côté, des actions des banques qui sont liées aux entreprises en question, cette interpénétration de capitaux bancaires monopolistes et de capitaux industriels monopolistes donne naissance à une nouvelle forme de capital, le capital financier. Le capital financier est le capital fusionné des monopoles bancaires et industriels. L’époque de l’impérialisme est celle du capital financier.
Définissant le capital financier, Lénine en a souligné trois aspects importants :
Concentration de la production avec, comme conséquence, les monopoles ; fusion ou interpénétration des banques et de l’industrie, voilà l’histoire de la formation du capital financier et le contenu de cette notion.
V. Lénine, « L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme », Œuvres, t. 22, p. 245.
La fusion du capital bancaire et du capital industriel apparaît nettement dans l’union personnelle des dirigeants des monopoles bancaires et industriels. Les mêmes personnes sont à la tête des plus grands groupements monopolistes du système bancaire, de l’industrie, du commerce et des autres branches de l’économie capitaliste.
En Allemagne, à la veille de la première guerre mondiale, les six plus grandes banques berlinoises avaient leurs représentants aux postes de directeurs dans 344 entreprises industrielles et comme membres des conseils d’administration, dans 407 autres entreprises, au total 751 sociétés. D’autre part, faisaient partie des organismes de direction de ces six banques, 51 gros industriels. Plus tard, cette union personnelle a pris un développement encore plus grand. En 1932, faisaient partie des organismes de direction des trois principales banques de Berlin 70 grands représentants de l’industrie. Aux États-Unis, en 1950, un petit groupe comptant 400 industriels et banquiers occupait un tiers des 3 705 postes de directeurs dans les 250 plus grandes sociétés par actions, qui possédaient 42 % de tous les capitaux du pays.
Dans chaque pays capitaliste, des groupes peu nombreux de grands banquiers et d’industriels monopolistes détiennent toutes les branches vitales de l’économie, disposant à leur gré de l’immense masse des richesses sociales. L’activité des monopoles capitalistes devient inéluctablement la domination d’une oligarchie financière (le mot oligarchie signifie littéralement « domination d’un petit nombre »). L’impérialisme est caractérisé par la toute-puissance des trusts et des syndicats monopolistes, des banques et de l’oligarchie financière dans les pays capitalistes développés.
La domination de l’oligarchie financière dans le domaine économique s’exerce tout d’abord par ce qu’on appelle le « système de participation ». Il consiste en ce qu’un grand financier ou un groupe de brasseurs d’affaires a en main la principale société par actions (la « société-mère » ), qui est à la tête du consortium ; cette société, grâce aux actions qu’elle possède (participation de contrôle), exerce à son tour sa domination sur les « sociétés filiales » qui en dépendent ; celles-ci font la loi à leur tour dans leurs « sociétés-filiales », etc. Au moyen de ce système, les brasseurs d’affaires de la finance ont la possibilité de disposer d’immenses sommes de capitaux appartenant à d’autres personnes.
Au moyen d’un système de participation largement ramifié, les huit plus puissants groupes financiers des États-Unis — Morgan, Rockefeller, Kuhn-Loebe, Mellon, Dupont, les groupes de Chicago, de Cleveland et de Boston — occupent une position prédominante dans l’ensemble de l’économie nationale. La zone d’influence de Morgan embrassait, vers 1948, des banques et des sociétés au capital de 55 milliards de dollars ; celle des Rockefeller, 26,7 milliards ; celle des Dupont, 6,5 milliards et celle des Mellon, 6 milliards de dollars. En 1952 aux États-Unis les sociétés étaient an nombre de 660 000. Plus de 75 % de la somme des capitaux de ces sociétés étaient contrôlées, grâce à un système de participation, par 66 sociétés milliardaires (c’est-à-dire avec un capital de 1 milliard de dollars au moins), qui disposaient directement de 28,3 % de la somme totale des capitaux.
L’oligarchie financière, qui jouit d’un monopole de fait, réalise des profits exorbitants provenant de la fondation de sociétés par actions, de l’émission d’actions et d’obligations, du placement des emprunts d’État, de commandes avantageuses de l’État. Le capital financier, concentré entre les mains d’un petit nombre, lève un tribut toujours croissant sur la société.
L’oligarchie financière a également la haute main sur le domaine politique. La politique intérieure et extérieure des États bourgeois est subordonnée aux intérêts cupides des plus grands monopoles.
18.5. L’exportation des capitaux.
L’exportation des marchandises était caractéristique du capitalisme prémonopoliste, sous le règne de la libre concurrence. Le capitalisme impérialiste, sous le règne des monopoles, est caractérisé par l’exportation des capitaux.
L’exportation des capitaux à l’étranger se fait en vue d’obtenir le profit maximum. Elle présente deux formes essentielles : ou bien consentement d’emprunts aux gouvernements, villes ou banques d’autres pays, ou bien création à l’étranger d’entreprises industrielles, commerciales ou bancaires, concessions, construction de voies ferrées, et aussi le rachat à vil prix d’entreprises existantes dans des pays affaiblis (par exemple à la suite d’une guerre).
L’exportation des capitaux est déterminée, premièrement, par la domination des monopoles dans tous les pays capitalistes développés et, deuxièmement, par la situation de monopole qu’occupe le petit nombre des pays les plus riches, où l’accumulation des capitaux est immense. Dans ces pays, au seuil du 20e siècle, il s’est formé un vaste « excédent de capitaux ».
L’ « excédent de capitaux » dans les pays capitalistes développés a un caractère relatif, car dans ces pays le bas niveau de vie des masses dresse des obstacles au développement de la production, accentue le retard de l’agriculture sur l’industrie et, d’une façon générale, l’inégalité du développement des différentes branches de l’économie. Si le capitalisme pouvait relever l’agriculture, améliorer le niveau de vie des masses travailleuses, il ne saurait être question d’ « excédent de capitaux». Mais alors le capitalisme ne serait point le capitalisme, car l’inégalité de développement et la sous-alimentation des masses de la population sont les conditions essentielles et préalables de ce mode de production.
La nécessité de l’exportation des capitaux est due à la « maturité excessive » du capitalisme dans certains pays où (l’agriculture étant arriérée et les masses misérables) les placements « avantageux » font défaut au capital.
V. Lénine, « L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme », Œuvres, t. 22, p. 261.
Dans sa course au profit maximum, le capital « excédentaire » se déverse à l’étranger. Il est exporté principalement vers les pays retardataires, dans lesquels les capitaux sont peu nombreux, les salaires bas, les matières premières bon marché, le prix de la terre relativement peu élevé. Dans ces pays, la possibilité s’offre au capital monopoliste de toucher, et il les touche effectivement, des profits énormes. L’exportation des capitaux est étroitement rattachée au développement de l’exportation des marchandises : les monopoles qui exportent des capitaux ont l’habitude d’imposer au pays débiteur leurs marchandises à des conditions avantageuses pour eux. Les monopoles étrangers s’emparent des débouchés et des sources de matières premières dans les pays débiteurs.
Outre les pays retardataires, le capital est exporté aussi dans les pays industriels développés. Cela a lieu pendant les périodes de développement rapide de ces pays, qui exigent un afflux de capitaux venant du dehors (par exemple, aux États-Unis avant la première guerre mondiale), ou bien dans une période d’affaiblissement dû à la guerre (l’Allemagne après la première guerre mondiale, les pays capitalistes d’Europe occidentale après la deuxième guerre mondiale).
Les économistes et les hommes politiques bourgeois présentent l’exportation des capitaux comme une « aide » et un « bienfait » qu’apporteraient les pays capitalistes développés aux peuples retardataires. En réalité, l’exportation des capitaux, tout en accélérant le développement des rapports capitalistes dans les pays retardataires, conduit en même temps à l’asservissement et au pillage systématique de ces pays par les monopoles étrangers. L’exportation des capitaux constitue une des bases du système de l’oppression impérialiste, dans lequel de riches pays-usuriers exploitent une grande partie du globe. Par suite de l’exportation des capitaux, le monde est partagé en une poignée d’États-usuriers et une immense majorité d’États-débiteurs.
L’exportation des capitaux a de graves conséquences pour les pays. D’une part, les pays en question multiplient leurs-richesses et renforcent leur position sur le marché mondial. Il leur arrive du dehors un afflux constant de plus-value sous forme d’intérêts sur les emprunts ou de profit provenant de leurs entreprises à l’étranger. D’autre part, il se produit souvent une stagnation de l’industrie du pays exportateur de capitaux. Un des résultats les plus importants de l’exportation des capitaux est l’accentuation de la rivalité entre les puissances, la lutte pour les sphères d’investissement des capitaux les plus avantageuses.
Avant la première guerre mondiale, les principaux pays exportateurs de capitaux étaient l’Angleterre, la France et l’Allemagne. Leurs investissements à l’étranger s’élevaient de 175 à 200 milliards de francs : 75 à 100 milliards pour l’Angleterre, 60 milliards pour la France, 44 milliards pour l’Allemagne. L’exportation des capitaux des États-Unis ne jouait pas encore un grand rôle, et elle s’élevait à moins de 10 milliards de francs.
Après la guerre de 1914-1918, des changements radicaux se sont produits dans l’exportation mondiale des capitaux. L’Allemagne avait perdu ses capitaux à l’étranger. Les investissements à l’étranger avaient notablement diminué pour l’Angleterre et la France, et l’exportation de capitaux des États-Unis avait fortement augmenté. En 1929, les États-Unis atteignent à peu près au même niveau que l’Angleterre pour l’étendue de leurs investissements à l’étranger.
Après la deuxième guerre mondiale, l’exportation des capitaux des États-Unis s’est encore accrue. À la fin de 1949, les investissements de capitaux américains à l’étranger dépassaient la somme des investissements à l’étranger de tous les autres États capitalistes réunis. La somme totale des capitaux américains investis à l’étranger est passée de 11,4 milliards de dollars en 1939 à 39,5 milliards à la fin de 1953. La somme totale des investissements de capitaux anglais à l’étranger est passée de 3,5 milliards de livres sterlings en 1938 à 2 milliards en 1951.
18.6. Le partage économique du monde entre les unions de capitalistes. Les monopoles internationaux.
À mesure que se développe l’exportation des capitaux et que s’étendent les liens et les « zones d’influence » des plus grands monopoles, des conditions favorables se créent pour le partage du marché mondial entre eux. Il se constitue des monopoles internationaux.
Les monopoles internationaux sont des ententes entre les plus gros monopoles des différents pays pour le partage des marchés, la politique des prix, le volume de la production. La formation des monopoles internationaux marque un degré nouveau, infiniment plus élevé que les précédents, de la concentration de la production et du capital. Beaucoup de monopoles internationaux sont créés avec la participation effective des États capitalistes, et ils sont l’un des moyens essentiels de leur expansion économique.
Les défenseurs des monopoles internationaux s’attachent à les présenter comme un instrument de paix, en prétendant que les ententes internationales des monopolistes peuvent par des moyens pacifiques régler les contradictions qui surgissent entre les groupes et les pays impérialistes. Ces affirmations sont tout à fait contraires à la réalité. En effet, le partage économique du monde par les monopoles internationaux se fait en fonction de la puissance des parties engagées ; or la puissance des différents groupes monopolistes varie. Chacun d’eux poursuit une lutte incessante pour l’augmentation de sa part, pour l’élargissement de sa sphère d’exploitation monopoliste. Les changements dans le rapport des forces entraînent inévitablement l’accentuation de la lutte pour un nouveau partage des marchés, l’aggravation des contradictions entre les divers groupes et les États qui les soutiennent. Les ententes monopolistes internationales se distinguent par leur fragilité et recèlent une source de conflits inéluctables.
Les monopoles internationaux ont fait leur apparition vers 1860-1880. À la fin du siècle dernier, leur nombre total ne dépassait pas 40. À la veille de la première guerre mondiale, on comptait dans le monde entier environ 100 cartels internationaux, et avant la deuxième guerre mondiale, leur nombre dépassait 300.
Dès avant la première guerre mondiale, le marché du pétrole était pratiquement partagé entre la Standard Oil américaine de Rockefeller et la Royal Dutch Shell, où le capital anglais exerçait une influence prépondérante. Le marché des articles électrotechniques était partagé entre deux firmes monopolistes: la Société générale d’électricité (A.E.G.) allemande et la Generai Electric américaine, contrôlée par le groupe Morgan.
Les ententes monopolistes internationales se sont même étendues à des domaines tels que la fabrication des armements. Les plus grandes firmes, qui fabriquaient les armements — Vickers-Armstrong Ltd., en Angleterre, Schneider-Creusot en France, Krupp en Allemagne, Bofors en Suède, — sont de longue date unies entre elles par une multitude de liens.
Les monopoles internationaux ont joué un grand rôle dans la préparation de la deuxième guerre mondiale. Les plus grands monopoles des États-Unis, de l’Angleterre et de la France, liés par des conventions avec les trusts allemands, ont animé et orienté la politique des milieux dirigeants de ces pays, politique d’encouragement et d’excitation à l’agression hitlérienne, qui a entraîné la guerre.
Après la deuxième guerre mondiale a été créée une série de monopoles internationaux, qui garantissent les intérêts économiques et militaires de l’impérialisme américain. C’est le rôle que joue en particulier « la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier » (CECA) qui englobe l’Allemagne Occidentale, la France, l’Italie, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg.
18.7. L’achèvement du partage territorial du globe entre les grandes puissances et la lutte pour un nouveau partage.
Parallèlement au partage économique du monde entre les groupements de capitalistes et en liaison avec ce partage, on assiste au partage territorial du globe entre les États bourgeois, à la lutte pour la mainmise sur les terres d’autrui et pour les colonies et les semi-colonies.
Les colonies sont des pays dépourvus d’indépendance nationale ; elles sont les possessions d’États-métropoles impérialistes. On appelle semi-colonies des pays sous-développés, en butte à l’exploitation coloniale de puissances impérialistes, sous la dépendance économique et politique desquelles ils se trouvent, tout en conservant une indépendance formelle. À côté des colonies et des semi-colonies, il existe à l’époque de l’impérialisme divers types de pays dépendants, dont le degré de dépendance est différent et est sujet à toutes sortes de variations.
Cette époque n’est pas seulement caractérisée par les deux groupes principaux de pays : possesseurs de colonies et pays coloniaux, mais encore les formes variées de pays dépendants qui, nominalement, jouissent de l’indépendance politique, mais qui, en réalité, sont pris dans les filets d’une dépendance financière et diplomatique.
V. Lénine, « L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme », Œuvres, t. 22, p. 284.
Les défenseurs de la bourgeoisie présentent la domination impérialiste sur les colonies comme une « mission civilisatrice », ayant soi-disant pour objet d’amener les peuples retardataires sur la voie du progrès et d’un développement autonome. En réalité, l’impérialisme voue les pays coloniaux et dépendants au retard économique, et les centaines de millions d’habitants de ces pays à une oppression et à une servitude sans nom, à la privation de droits et à la misère, à la famine et à l’ignorance. La mainmise des impérialistes sur les colonies entraîne un accroissement sans précédent de l’oppression nationale et de la discrimination raciale. Selon la définition de Lénine, le capitalisme, de libérateur des nations qu’il était dans la période de lutte contre le féodalisme, est devenu, au stade de l’impérialisme, un monstrueux oppresseur des nations.
Dès le milieu du 18e siècle, l’Angleterre a asservi l’Inde, pays aux très riches ressources naturelles et dont la population, numériquement, est de plusieurs fois supérieure à celle de la métropole. Au milieu du 19e siècle, les États-Unis d’Amérique se sont emparés de vastes territoires appartenant à leur voisin le Mexique, et, au cours des décennies suivantes, ils ont établi leur domination sur plusieurs pays de l’Amérique latine.
Vers 1860-1870, les possessions coloniales des pays européens n’occupaient encore qu’une partie relativement faible des territoires d’outre-mer.
Au cours du dernier quart du 19e siècle, pendant la période du passage au stade monopoliste du capitalisme, la carte du monde a subi des modifications radicales. À la suite de l’ancienne puissance coloniale — l’Angleterre — tous les pays capitalistes développés s’engagent dans la voie des annexions territoriales. La France devient, vers la fin du 19e siècle, une grande puissance coloniale dont les possessions s’étendent sur 3,7 millions de milles carrés. L’Allemagne s’est annexé un million de milles carrés de territoire avec une population de 14,7 millions d’habitants ; la Belgique, 900 000 milles carrés avec 30 millions d’habitants ; les États-Unis se sont emparés d’un point d’appui très important dans le Pacifique, les Philippines, ainsi que de Cuba, de Porto-Rico, de Guam, des îles Hawaï, de Samoa et ils ont établi leur domination de fait sur plusieurs pays de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud.
De 1876 à 1914, les « grandes puissances » se sont emparées de près de 25 millions de kilomètres carrés de territoire, soit une superficie une fois et demie supérieure à celle des métropoles. Plusieurs pays se trouvaient placés dans une dépendance semi-coloniale vis-à-vis des États impérialistes : la Chine dont la population forme à peu près le quart de celle de l’humanité, ainsi que la Turquie et la Perse (Iran). Vers le début de la première guerre mondiale, plus de la moitié du genre humain était sous la domination des puissances coloniales.
Les impérialistes établissent et maintiennent leur pouvoir sur les colonies en recourant aux mensonges et à la violence, en utilisant la supériorité de leur matériel de guerre. L’histoire de la politique coloniale présente une chaîne ininterrompue de guerres de conquête et d’expéditions punitives contre les peuples asservis, ainsi que de conflits sanglants entre les pays possesseurs de colonies. Lénine qualifiait la guerre des États-Unis contre l’Espagne en 1898 de première guerre de type impérialiste, marquant le début de l’époque des guerres impérialistes. L’insurrection du peuple philippin contre l’envahisseur a été férocement écrasée par les troupes américaines.
Au début du 20e siècle, le partage du globe était achevé. La politique coloniale des pays capitalistes avait amené la conquête de toutes les terres qui n’étaient pas encore occupées par les impérialistes. Il ne restait plus de terres « vacantes », et la situation était telle que chaque nouvelle conquête supposait que le possesseur était dépouillé de son territoire. L’achèvement du partage du monde a mis à Tordre du jour la lutte pour un nouveau partage. La lutte pour un nouveau partage du inonde déjà entièrement partagé est l’un des principaux traits distinctifs du capitalisme monopoliste. Cette lutte dégénère en définitive en une lutte pour la domination mondiale et entraîne infailliblement des guerres impérialistes à l’échelle mondiale.
Les guerres impérialistes et la course aux armements causent aux peuples des pays capitalistes d’énormes privations et coûtent des millions de vies humaines. En même temps, les guerres et la militarisation de l’économie constituent pour les monopoles une source de profits particulièrement élevés.
18.8. La loi économique fondamentale du capitalisme monopoliste.
Comme on l’a déjà dit, l’essence économique de l’impérialisme consiste à substituer la domination des monopoles à la libre concurrence. Les monopoles qui fixent des prix de monopole se proposent, selon la définition de Lénine, d’obtenir des profits élevés de monopole qui dépassent sensiblement le profit moyen. L’obtention de ces profits par les monopoles découle de la nature même de l’impérialisme ; elle résulte d’une exploitation inouïe de la classe ouvrière par les monopoles, du dépouillement de la paysannerie et des autres petits producteurs, de l’exportation des capitaux vers les pays retardataires qui sont saignés à blanc, des conquêtes coloniales et des guerres impérialistes, véritable mine d’or pour les monopoles. Dans ceux de ses ouvrages où Lénine s’attache à analyser l’essence économique et politique de l’impérialisme, sont exposées les thèses initiales de la loi économique fondamentale du capitalisme monopoliste. Partant de ces thèses fondamentales de Lénine, Staline a formulé la loi économique fondamentale du capitalisme actuel. Les principaux traits et exigences de la loi économique fondamentale du capitalisme monopoliste consistent en ceci :
assurer le profit capitaliste maximum par l’exploitation, la ruine et l’appauvrissement de la majorité de la population d’un pays donné, par l’asservissement et le pillage systématique des peuples des autres pays, surtout des pays arriérés, et enfin par les guerres et la militarisation de l’économie nationale utilisées pour assurer les profits les plus élevés.
J. Staline, « Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S. », Derniers écrits, p. 128, Éditions sociales, Paris, 1953.
Ainsi, la loi économique fondamentale du capitalisme — la loi de la plus-value — poursuit sous l’impérialisme son développement et sa concrétisation. Sous le régime du capitalisme prémonopoliste, la libre concurrence aboutissait à une égalisation du taux de profit des capitalistes ; c’était le règne de la loi du taux moyen du profit. Dans le cadre de l’impérialisme, les monopoles s’assurent un profit élevé de monopole, le profit maximum. C’est lui le moteur du capitalisme monopoliste. Au stade du capitalisme monopoliste aussi il y a transfert de capitaux de certaines branches dans d’autres et tendance à l’égalisation des profits. Mais cette tendance se heurte à l’action de la loi économique fondamentale du capitalisme monopoliste, la loi du profit capitaliste maximum. À l’époque de l’impérialisme, dans les branches monopolisées, les marchandises sont vendues essentiellement à des prix de monopole, qui sont supérieurs aux prix de production et qui assurent le profit élevé de monopole, tandis que dans les branches non monopolisées, les marchandises sont souvent vendues à des prix inférieurs aux prix de production, ce qui ne procure même pas aux entrepreneurs le profit moyen.
Les conditions objectives pour réaliser le profit maximum sont créées par l’établissement de la domination des monopoles dans telles ou telles branches de la production. Au stade de l’impérialisme, la concentration et la centralisation des capitaux atteignent le plus haut degré. De ce fait, l’élargissement de la production nécessite d’immenses investissements de capitaux. D’autre part, en période de capitalisme monopoliste, la concurrence se poursuit avec acharnement entre des entreprises géantes. De cette lutte sortent victorieux les monopoles les plus forts qui disposent d’immenses capitaux et touchent le profit maximum.
Grâce à ces immenses profits, la possibilité s’offre aux monopoles d’assurer leur domination dans le monde capitaliste. La course des monopoles au profit maximum accentue à l’extrême toutes les contradictions du capitalisme.
La base générale du profit maximum des monopoles capitalistes, comme de tout profit capitaliste, est la plus-value extorquée aux ouvriers exploités dans le cours de la production. Les monopoles poussent à l’extrême l’exploitation de la classe ouvrière. En appliquant des systèmes de surmenage de toute sorte dans l’organisation et la rémunération du travail, ils arrivent à une intensification du travail exténuante, qui a pour effet tout d’abord d’augmenter énormément le taux et la masse de la plus-value extorquée aux ouvriers. Ensuite, l’intensification du travail a pour résultat qu’un nombre considérable d’ouvriers excédentaires va grossir l’armée des chômeurs et n’a plus aucun espoir de retrouver un emploi dans la production. Les entreprises jettent dehors aussi tous les ouvriers qui ne peuvent résister à l’accélération excessive des procédés de fabrication.
Aux États-Unis, le taux de la plus-value dans l’industrie minière et dans l’industrie de transformation, calculé sur la base des chiffres officiels, était en 1889, de 145 % ; en 1919, de 165 % ; en 1929, de 210 % ; en 1939, de 220 % ; en 1947, d’environ 260 %.
Ainsi, en moins de soixante ans, le taux de la plus-value a été multiplié par 1,8.
D’autre part, le salaire réel est en baisse par suite du renchérissement de la vie et du poids croissant des charges fiscales. À l’époque de l’impérialisme, l’écart entre le salaire de l’ouvrier et le prix de sa force de travail s’élargit encore davantage. Cela signifie que la loi générale de l’accumulation capitaliste, qui détermine la paupérisation relative et absolue du prolétariat, renforce son action. L’exploitation accrue de la classe ouvrière au cours de la production se double de la spoliation des travailleurs en tant que consommateurs ; les ouvriers sont forcés de payer en supplément des sommes importantes aux monopoles qui fixent des prix de monopole élevés sur les marchandises qu’ils produisent et vendent.
Dans le cadre du capitalisme monopoliste, les marchandises fabriquées par les monopoles ne sont plus vendues au prix de production, mais à des prix sensiblement plus élevés, à des prix de monopole.
Le prix de monopole est égal aux frais de production plus le profit maximum qui dépasse sensiblement le profit moyen ; le prix de monopole est supérieur au prix de production et, en règle générale, dépasse la valeur des marchandises. Cependant le prix de monopole, comme Marx l’indiquait déjà, ne peut supprimer les limites déterminées par la valeur des marchandises. Le niveau élevé des prix de monopole ne modifie pas la somme totale de la valeur et de la plus-value produites dans l’économie capitaliste mondiale. Une des sources du profit maximum, que touchent les monopoles, est la redistribution de la plus-value, qui a pour résultat une baisse sensible du niveau du profit des entreprises non monopolisées. En maintenant les prix à un niveau plus élevé que celui de la valeur des marchandises, les monopoles s’approprient le fruit de la productivité croissante du travail et de la baisse des frais de production. Ce qui est un gain pour les monopoles est une perte pour les ouvriers, les petits producteurs, la population des pays dépendants.
Un instrument important du gonflement des prix de monopole est la politique douanière des États bourgeois. À l’époque de la libre concurrence, c’étaient surtout les pays faibles, dont l’industrie avait besoin de se préserver de la concurrence étrangère, qui recouraient aux droits de douane élevés. À l’époque de l’impérialisme, au contraire, les droits élevés sont pour les monopoles un moyen d’attaque, de lutte pour s’emparer de nouveaux débouchés. Les droits de douane élevés permettent de maintenir les prix de monopole à l’intérieur du pays.
Afin de conquérir de nouveaux marchés extérieurs, les monopoles pratiquent largement le dumping, c’est-à-dire la vente des marchandises à l’étranger à vil prix, sensiblement au-dessous des prix du marché intérieur, souvent même au-dessous des frais de production. L’extension de la vente à l’étranger, grâce au dumping, permet de maintenir les prix élevés à l’intérieur du pays sans réduire la production, et les pertes causées par l’exportation de dumping sont couvertes en augmentant les prix sur le marché intérieur. Après avoir conquis un marché extérieur donné les monopoles y procèdent à la vente des marchandises à des prix de monopole.
L’exploitation des masses essentielles de la paysannerie par les monopoles se traduit tout d’abord par le fait que la domination de ces derniers engendre un écart croissant entre les prix des denrées agricoles et ceux des marchandises industrielles ; c’est ce qu’on appelle les « ciseaux » des prix : tout en écoulant leurs marchandises à des prix gonflés, les monopoles accaparent les produits des paysans à des prix réduits (bas prix d’achat de monopole). Instrument servant à extorquer les ressources financières de l’économie rurale, les prix de monopole en entravent le développement. Un des leviers les plus puissants, destiné à ruiner les exploitations paysannes, est le crédit hypothécaire. Les monopoles accablent les paysans de dettes pour, ensuite, s’approprier à vil prix leur terre et leurs biens.
Par les hypothèques, les escroqueries des forbans de la finance, par les hauts impôts et les taxes, par le prix élevé des baux, et surtout par la concurrence des grandes exploitations foncières capitalistes, la bourgeoisie ruine les moyens et les petits paysans.
Maurice Thorez, « La politique du Parti communiste à la campagne », Œuvres, t. 3, p. 201, Éditions sociales, Paris, 1951.
L’achat par les monopoles des produits des exploitations paysannes à des prix très bas, ne signifie nullement que le consommateur des villes bénéficie de vivres à bon marché. Entre le paysan et le consommateur urbain se trouvent des intermédiaires, marchands groupés dans des organisations monopolistes, qui ruinent les paysans et écorchent les consommateurs de la ville.
Ensuite, une source du profit maximum pour les monopoles est l’asservissement et le pillage des pays économiquement retardataires et dépendants par la bourgeoisie des États impérialistes. Le pillage systématique des colonies et des autres pays retardataires, la transformation d’une série de pays indépendants en pays dépendants constitue un trait inaliénable du capitalisme monopoliste. L’impérialisme ne peut vivre ni se développer sans l’afflux ininterrompu du tribut prélevé sur les pays étrangers.
Les monopoles tirent des revenus considérables tout d’abord de leurs investissements de capitaux dans les pays coloniaux et dépendants. Ces revenus sont le résultat de l’exploitation la plus féroce et la plus inhumaine des masses laborieuses du monde colonial. Les monopoles s’enrichissent grâce à des échanges non équivalents, c’est-à-dire par la vente dans les pays coloniaux et dépendants de leurs marchandises à des prix qui dépassent notablement leur valeur, et par achat des marchandises produites dans ces pays à des prix excessivement bas, qui ne couvrent pas leur valeur. Parallèlement, les monopoles touchent dans les colonies des profits élevés sur les opérations de transport, d’assurance et de banque.
Enfin, les guerres et la militarisation de l’économie sont un des moyens de garantir les profits maximums des monopoles. Les guerres enrichissent démesurément les magnats du capital financier, qui, dans les intervalles entre les guerres, s’attachent à maintenir le niveau élevé de leurs profits grâce à une course effrénée aux armements. Les guerres et la militarisation de l’économie apportent aux monopolistes de riches commandes militaires, payées par le Trésor à des prix exorbitants, une abondance de prêts et de subventions prélevés sur le budget de l’État. En temps de guerre toutes les lois sur le travail sont abolies, les ouvriers sont déclarés mobilisés, les grèves sont interdites. Tout cela permet aux capitalistes d’élever le degré d’exploitation en intensifiant systématiquement le travail. En même temps, le niveau de vie des masses laborieuses décroît par suite de l’accroissement des impôts et de la vie chère.
Ainsi, la militarisation de l’économie capitaliste, en temps de guerre comme en temps de paix, se traduit par l’exploitation accrue des masses laborieuses dans l’intérêt de l’accroissement du profit maximum des monopoles.
La loi économique fondamentale du capitalisme actuel, qui détermine tout le cours du développement du capitalisme à son stade impérialiste, permet de comprendre et d’expliquer l’inéluctabilité de la montée et de l’aggravation des contradictions insolubles qui lui sont inhérentes.
Résumé du chapitre 18
-
L’impérialisme, ou capitalisme monopoliste, est le stade suprême et ultime du développement du mode de production capitaliste. Le passage du capitalisme prémonopoliste au capitalisme monopoliste s’est opéré au cours du dernier tiers du 19e siècle. L’impérialisme s’est définitivement constitué au début du 20e siècle.
-
Les principaux indices économiques de l’impérialisme sont :
1o la concentration de la production et du capital, parvenue à un degré de développement si élevé qu’elle engendre les monopoles dont le rôle est décisif dans la vie économique ;
2o la fusion du capital bancaire et du capital industriel et la formation, sur cette base, du capital financier, de l’oligarchie financière ;
3o l’exportation des capitaux, qui, contrairement à l’exportation des marchandises, prend une importance particulière ;
4o la formation d’unions monopolistes internationales de capitalistes qui se partagent le monde ;
5o l’achèvement du partage territorial du globe par les plus grandes puissances impérialistes. L’achèvement du partage territorial du monde aboutit à la lutte pour un nouveau partage, lutte qui engendre infailliblement des guerres impérialistes à l’échelle mondiale.
-
La loi économique fondamentale du capitalisme monopoliste consiste à assurer le profit capitaliste maximum par l’exploitation, la ruine et l’appauvrissement de la majeure partie de la population d’un pays donné ; par l’asservissement et le pillage systématiquees peuples des autres pays, notamment des pays retardataires ; enfin, par les guerres et la militarisation de l’économie nationale.